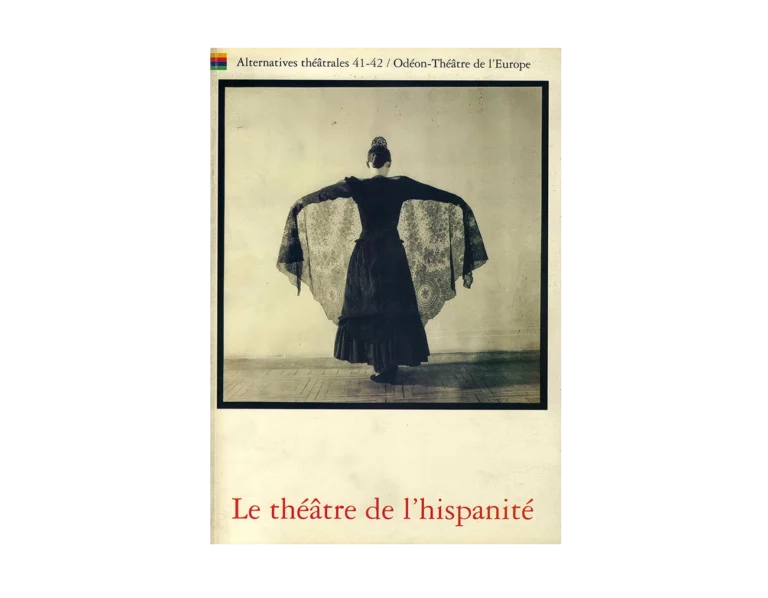L’ESPAGNE tient une place très importante dans le répertoire et l’œuvre théâtrale de Charles Dullin, plus importante qu’on ne l’a en général souligné. On la trouve au principe du Théâtre de l’Atelier. Avant même que celui-ci n’ouvre ses portes, Dullin met en répétition plusieurs pièces du Siècle d’or espagnol. Au printemps 1922 sont créés successivement trois « intermèdes » espagnols : LES OLIVES, de Lope de Rueda, L’HÔTELLERIE, de Francisco de Castro1, VISITES DE CONDOLÉANCES, de Calderón, ainsi que LA VIE EST UN SONGE, du même auteur, spectacle dont « le succès artistique et matériel », d’après ce qu’affirme Dullin lui-même, « affermit l’œuvre naissante »2. À la même époque sont créées deux autres pièces, sinon espagnoles, du moins inspirées de l’Espagne : MORIANA ET GALVAN, un mimodrame tiré du Romancero mauresque par Alexandre Arnoux et L’OCCASION, de Mérimée qui fait partie de ce « Théâtre de Clara Gazul » que son auteur a placé sous le patronage de Calderón et de Cervantes. Toutes ces pièces étaient des créations, donc des révélations pour le public. Avec L’OCCASION, Dullin poursuivait l’œuvre de Copeau qui venait de mettre en scène au Vieux Colombier LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT avec un vif succès (il avait du reste projeté de monter aussi L’OCCASION) et de prouver par là qu’on pouvait jouer avec bonheur un théâtre réputé injouable. Dullin reviendra à Mérimée avec LE CIEL ET L’ENFER, créé sans beaucoup de succès au Théâtre de Paris le 16 novembre 1940. Mais surtout il monta deux autres drames du Siècle d’or : LE MÉDECIN DE SON HONNEUR, de Calderón, créé à l’Atelier en février 1935 et LES AMANTS DE GALICE, adapté par Jean Camp du MEILLEUR ALCADE EST LE ROI, de Lope de Vega, créé au Théâtre de la Cité3 en mai 1942. Dullin était aussi ouvert au répertoire espagnol contemporain, puisqu’il créa en février 1923 une pièce de Jacinto Grau qui n’avait pas été encore représentée même en Espagne : M. DE PYGMALION (il projeta de monter vers la même époque une autre pièce de cet auteur : LE COMTE ALARCOS). Enfin, le thème de l’Espagne était encore présent dans une pièce de Pierre Frondaie : LE FILS DE DON QUICHOTTE, « pièce misérable », selon Morvan Lebesque, mais où Dullin créa un « extraordinaire Don Quichotte, qu’il figura génialement par une simple danse, lance au poing »4.
Sans doute faut-il voir dans cette prédominance du répertoire espagnol, notamment dans les débuts du Théâtre de l’Atelier, l’influence d’Alexandre Arnoux, le traducteur de LA VIE EST UN SONGE et du MÉDECIN DE SON HONNEUR, comme il l’a luimême affirmé : « J’avais insufflé, je puis sans me flatter le dire, mon penchant pour les comédies d’Espagne, si brutalement précieuses, si primitives et si habiles, si réalistement lyriques, à Dullin ; et elles correspondaient merveilleusement à sa nature »5. Mais, en fait, Dullin avait eu un contact direct avec l’Espagne par un voyage accompli en compagnie d’Élise Jouhandeau pendant l’été 1914, au cours duquel il visita Madrid, Tolède, Grenade, Séville et Cordoue. Ce voyage réalisait un désir très vif en lui, comme se le rappelle Élise Jouhandeau : « Charles souhaitait frénétiquement de connaître l’Espagne, mieux accordée qu’aucun autre pays à son imagination pittoresque. De toutes .les superstitions et rêveries religieuses qui imprégnaient encore cette noble race, il rêvait. Et puis, c’était le berceau de Cervantes, du Greco, de Goya, de Sainte-Thérèse que Charles aimait pour la violence de leur passion et la sublimité de leur œuvre »6. « Épris du pittoresque théâtral de ce pays dont il prenait leçon », il en visite les sites : l’Escurial, l’Alhambra, la demeure de Cervantes, celle de Greco pour qui « il avait une véritable dévotion »7. Au Prado, il contemple longuement Velasquez et Murillo, peintres dont un critique de l’époque décèlera l’influence dans le traitement des personnages de LA VIE EST UN SONGE, tandis qu’un autre évoque L’HÔTELLERIE comme « une pochade à la Goya » et un troisième décrit « LE MÉDECIN DE SON HONNEUR tourmenté, austère et compassé comme un Greco ».