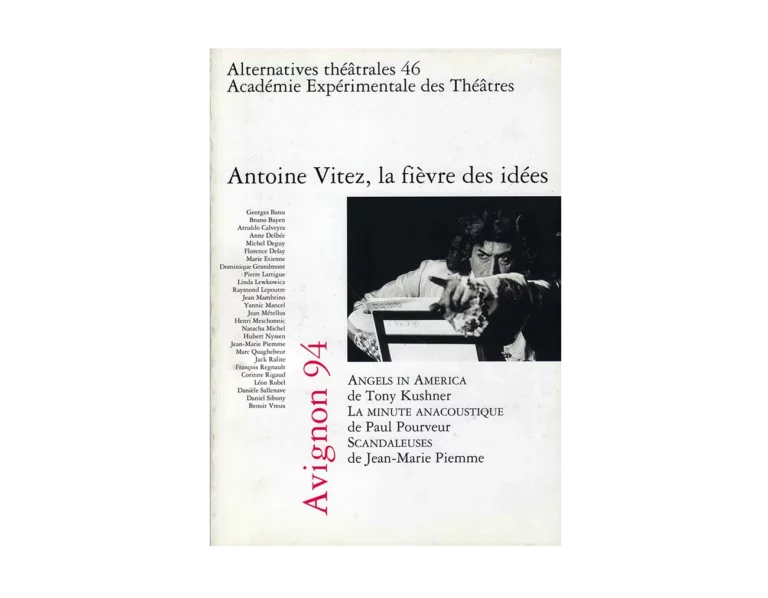LA CRÉATION française d’ANGELS IN AMERICA de Tony Kushner est une « coproduction » — le mot est affreux, mais l’aventure artistique parfois très belle — du Théâtre National de la Communauté Française de Belgique avec le Théâtre de la Commune Pandora, Centre Dramatique National d’Aubervilliers. Après l’accueil de LA PLACE ROYALE de Corneille en octobre 1992, Philippe van Kessel avait en effet exprimé le souhait d’engager les deux théâtres dans la réalisation d’un projet commun. Lorsque Brigitte Jaques et François Regnault vinrent lui proposer, un mois plus tard, la première mouture de la traduction de Gérard Wajcman, la pièce n’était pas encore consacrée par un prix Pulitzer, un triomphe à Broadway, plusieurs Tony Awards, et la couverture médiatique exceptionnelle qu’on lui connaît aujourd’hui. Mais pour qui connaît un peu l’histoire du théâtre américain et son évolution récente, elle n’avait pas besoin de telles récompenses pour apparaître immédiatement, de par sa forme et ses contenus, comme un événement important. Non pas, comme on l’a trop souvent dit, parce qu’elle parle du sida, de l’homosexualité, de l’Amérique puritaine et du maccarthysme — d’autres l’avaient fait avant elle — mais d’abord, me semble-t-il, parce qu’elle rompt radicalement avec l’intimisme naturaliste très « Actor’s Studio » qui, ces derniers temps, de Shepard à Mamet, faisait s’entre-déchirer dans des lieux clos stéréotypés, chambres de motel de la côte Ouest ou livings de Manhattan au confort très design, trois ou quatre personnages rapidement gagnés par la névrose ou l’‘hystérie.
La forme d’ANGELS IN AMERICA, au contraire, se veut résolument épique, au sens médiéval et littéraire du terme. De nombreux personnages, une vingtaine, dont les actions et les trajectoires narratives se tissent et s’entrecroisent au fur et à mesure que se construit la pièce, nous rappellent tout à la fois l’ambition de multitude des drames historiques shakespeariens1 et l’influence des sagas romanesques du XIXe siècle sur le théâtre d’Eugene O’Neill, le premier à avoir osé ces grandes fresques à mi-chemin du mythe et de l’histoire que furent L’ÉTRANGE INTERMEDE ou LE DEUIL SIED À ELECTRE.
Une fantaisie épique et baroque
Épique, ANGELS IN AMERICA l’est aussi dans l’acception brechtienne du mot : loin de toute tentation manichéenne ou schématique, la fable, jusque dans ses moindres répliques, y est irriguée d’une pensée dialectique en mouvement, et travaillée par le regard critique que l’auteur nous invite à porter sur la réalité politique et sociale de son pays. Il est difficile de résumer l’intrigue de la pièce tant elle est foisonnante et complexe dans son architecture. Pourtant, si l’on y regarde de plus près, un quintet de personnages semble bien en constituer le canevas initial : deux couples et un homme seul. De ces deux couples, le premier, homosexuel, sera déstabilisé par l’irruption tragique du sida ; le second, hétérosexuel et puritain — ils sont mormons —, ébranlé par les impératifs d’urgence liés à la carrière professionnelle de l’homme et par l’oisiveté dépressive de la femme cloftrée au foyer, sera quant à lui irrémédiablement déstructuré lorsque le mari recevra de l’un des hommes du premier couple la révélation de son homosexualité. Quant au cinquième personnage, il n’a rien de fictif, et Tony Kushner l’avait découvert dans un livre que son père lui avait offert pour ses douze ans, LA DÉCENNIE DU CAUCHEMAR, un essai historique sur la « chasse aux sorcières » aux ÉtatsUnis dans les années 50 : il s’agit de Roy Cohn, cet avocat juif dont le sénateur Mac Carthy avait fait tout à la fois son éminence grise et son exécuteur des basses besognes. C’est lui notamment qui, en toute illégalité, avait intrigué dans les couloirs de la Cour Suprême pour obtenir la condamnation à la chaise électrique d’Ethel et Julius Rosenberg. C’est également lui, ce défenseur farouche des valeurs morales les plus traditionalistes, qui, atteint du sida en 1985, se vit ainsi contraint de révéler au monde une homosexualité débridée qu’il avait pu jusque-là tenir secrète. L’intrusion d’un personnage historique au caractère aussi complexe et aussi fortement connoté confère à la fiction un ancrage politique qui non seulement situe les années Reagan comme un héritage idéologique direct du maccarthysme, mais nous autorise aussi à lire l’ensemble de la pièce, séquences oniriques comprises, comme une immense parabole de l’ Amérique contemporaine.
C’est d’ailleurs ce à quoi nous invite le sous-titre « Fantaisie gay sur des thèmes nationaux », sur la sémantique duquel il est intéressant de s’arrêter quelques lignes. « Gay », dans une ambiguïté joliment ludique, désigne d’abord, comme épithète de « fantaisie », la dimension comique et humoristique de la pièce, dont le rire oscille en permanence entre une désinvolte légèreté et un cynisme très sarcastique : c’est ainsi par exemple que l’entend l’un des personnages anachroniques de la fable, un vieil ancêtre du XIIIe siècle, qui ne lui soupçonne pas d’autre acception (III, 1). Mais aujourd’hui, avec son irréductible « y » en traduction française, Le mot évoque surtout le militantisme homosexuel des parades et des associations new-yorkaises qui, dans ce melting-pot de plus en plus complexe et parcellisé, s’affirment comme une des minorités Les plus actives, les plus vigilantes et les plus revendicatives en matière de respect des droits de l’homme et de défense des valeurs démocratiques, au même titre que naguère les communautés noires, juives et féministes, également représentées dans la pièce. Pour Tony Kushner comme pour beaucoup d’homosexuels et de sociologues américains, il ne fait aucun doute que les combats en faveur de l’accompagnement des malades, de la prévention et de la recherche contre le sida, au même titre que la lutte pour la reconnaissance d’un statut social des homosexuels, désignent des objectifs par lesquels peuvent et doivent se renouveler les idéaux philosophiques de la démocratie et du progrès. Le choix de Roy Cohn, homme de loi, juif, maccarthyste, homosexuel, aujourd’hui mort du sida, est à ce titre tout à fait emblématique, comme en témoigne à sa façon le carré de tissu qui, dans le « quil », ce patchwork géant déployé en 1987 à Washington, perpétue sa mémoire avec la mention : « Lâche, salaud, victime ».
On comprend mieux ainsi comment le thème « gay » s’intègre et s’articule aux autres thèmes « nationaux », tout en s’en distinguant, et comment la confusion des valeurs, dont témoigne l’intrication complexe de tous ces thèmes, ne pouvait s’exprimer, loin de toute tentation réaliste, que par le biais de la « fantaisie », au sens shakespearien du terme, une « fantaisie » qui combine les notions étymologiques de fantasme, d’onirisme, d’hallucinations et d’apparitions spectrales, certes, dont la pièce est très féconde, mais aussi de liberté d’imagination et de légèreté ludique, même lorsque le propos touche à la gravité ou au tragique.
Rêves américains
Grand lecteur de Shakespeare et traducteur récent d’une nouvelle version anglaise de L’ILLUSION COMIQUE de Corneille, Tony Kushner nous rappelle ainsi que le « songe » (baroque) et le « rêve » (freudien), loin de s’opposer à la vie, au réel et à la matière, en font au contraire partie intégrante. On reconnaît là la formation philosophique acquise à la Columbia University de New-York dans la fréquentation assidue des penseurs de l’École de Francfort, tous préoccupés d’articuler le matérialisme historique de Marx et les théories de Freud sur le rêve et l’inconscient. Peut-être d’ailleurs ne faut-il voir dans ces allers-et-retours entre le rêve et la réalité, aussi souples et fluides que des fondus-enchaînés cinématographiques, qu’une métaphore supplémentaire de la confusion des valeurs et de la crise d’identité qui feront chanceler chacun des personnages sur les décombres de leurs anciennes certitudes : c’est vrai pour Harper, la jeune femme frustrée et désœuvrée qui, avec la complicité sournoise du valium, fera tour à tour apparaître dans ses fantasmes un agent de voyages un peu trouble (Mr Lies — alias « Mensonges » ou « Bobards » — le bien nommé), puis Prior, le jeune malade du sida qu’elle n’a pourtant jamais rencontré auparavant, et même un Esquimau sur la banquise… C’est vrai aussi pour Prior, à qui ses ancêtres des XIIIe et XVIIIe : siècles, tous deux emportés par la peste, viendront rendre visite sur son lit d’hôpital ; pour Roy Cohn lui-même, enfin, que vient relancer le spectre d’Ethel Rosenberg, porteuse d’un pardon et d’une commisération encore plus accablants que la vengeance (II, 6). Mais l’apparition qui subsume toutes les précédentes et leur donne sens est assurément celle, annoncée par le titre, de l’ange, dont le bruissement d’ailes et les messages sibyllins ponctuent chacun des moments critiques du calvaire de Prior, jusqu’à l’extase mystique finale, entre orgasme et trépas, comme si la petite mort et la grande étaient enfin réunies dans un effet spécial tapageusement spectaculaire, identifié par Prior lui-même, dans un ultime souffle d’humour et de dérision, comme « très Steven Spielberg ».
L’ange de l’énonciation