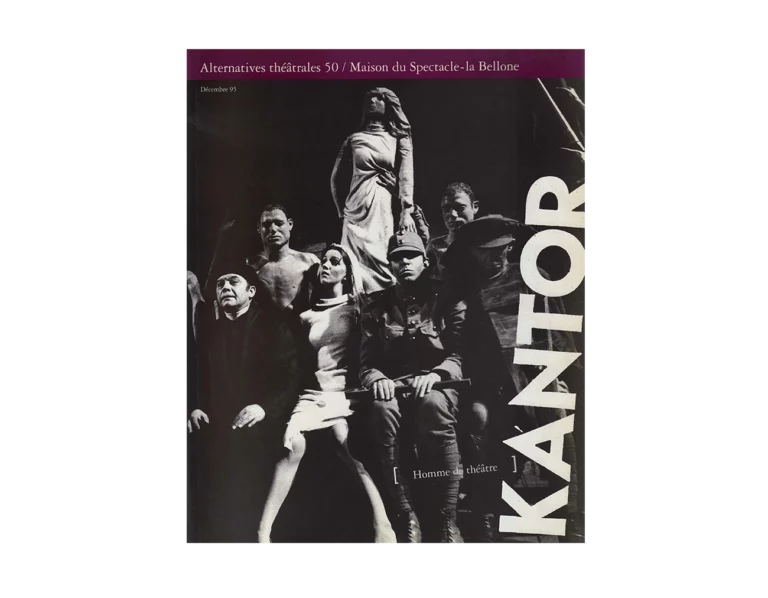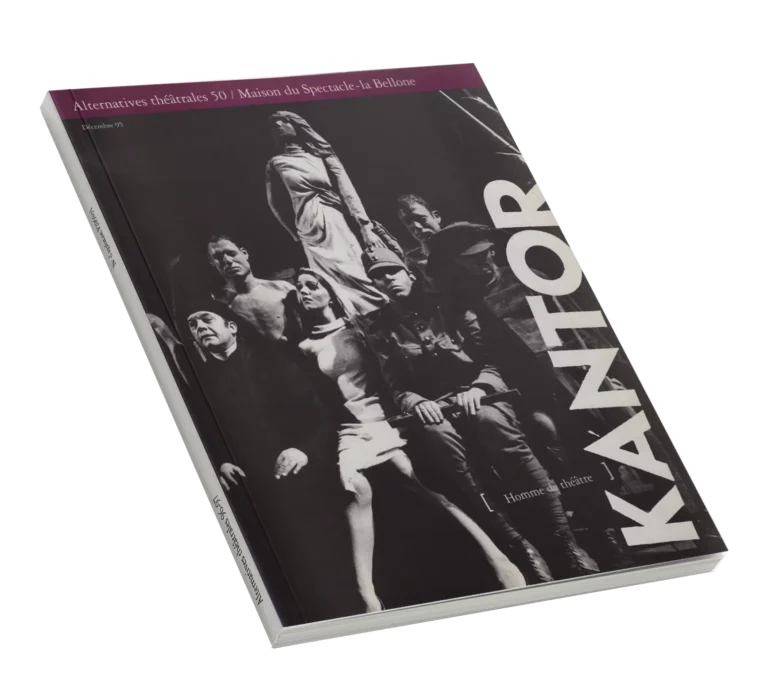Au début déjà, dans mon
credo, l’art n’était pas l’effigie
ni le reflet de la réalité
de la vie, il ne l’est toujours pas.
C’est là une foi naïve,
une théorie du naturalisme
et du matérialisme.
L’art est
une réponse
à la réalité.
Cet impérieux besoin
de réponse est sans doute
au cœur de la création.
Plus tragique était
cette réalité,
plus forte se faisait cette
«injonction » intérieure de réponse,
de création
d’une réalité « autre »,
libre, autonome,
capable de remporter une victoire morale
sut l’autre,
de triompher,
de restituer à notre époque
une dignité spirituelle.
C’était en accord avec ma
nature,
ma volonté de révolte et de
protestation.
Cette situation dans laquelle
une réalité inhumaine
suscitait en moi
une extraordinaire injonction de
réponse
m’a donné
la force et l’obstination
si nécessaires à la création
d’une grande œuvre.
Et cette grandeur
m’importait beaucoup.
Sans doute ai-je éclairci
suffisamment
le rôle de la réalité
dans laquelle il m’échut
de vivre
et à laquelle inlassablement
je suis revenu, en dépit
de toute logique,
en dépit du bon
sens.
Cette réalité de la vie,
déjà suffisamment décrite
et située — et en elle, ou en face
d’elle,
mon théître,
ma peinture,
l’œuvre d’art,
réalité — autre —
autonome
et libre
Comme je l’ai dit déjà,
elle n’était pas, ne devait pas être
une effigie
ni un reflet de cette réalité-là.
En aucun cas
un reflet narratif
ou documentaire
ayant l’intention de blâmer,
de porter plainte
devant le tribunal de la postérité
et de l’Histoire.
Cette méthode
de réalisation d’un spectacle,
d’application générale
aujourd’hui, où l’on peut dire désormais
toute la vérité (qui sans doute
joue un important rôle
social) —
m’était étrangère.
Je visais bien plus haut
et. plus « large ».
Cela signifie quoi ?
Cela signifie que les plans
de ma « bataille » ne se limitaient
pas au champ de la réalité
polonaise, mais
qu’ils s’ingéraient
dans la pensée mondiale
s’exprimant
dans l’art
(ce qui passa souvent,
dans mon pays,
pour un manque de patriotisme).
Au début déjà, j’étais
lié aux idées
de l’avant-garde radicale.
Le radicalisme avait pour
moi le charme du risque,
les idées d’avant-garde étaient
universelles, mondiales,
dépassaient les frontières et les destinées
des contrées natales.
Les idées bien définies de l’avant-garde
ne se référaient pas à une
discipline, elles pénétraient
l’art tout entier, la poésie, la peinture,
la musique, le théâtre.
J’étais sensibilisé à la logique
du comportement artistique,
aussi accordais-je
une grande importance
à la science approfondie
de l’art, à la réflexion,
à la définition et à
la méthode.
C’est pourquoi je me comportais
et je me comporte
de façon très critique
à l’égard des théâtres ou plutôt
des groupes théâtraux qui apparaissent
en si grand nombre ces dernières
décennies
et qui de manière
superficielle, pour l’effet
pur,
sans engagement
de connaissance
ont exploité
les grandes « découvertes »
du surréalisme, du happening,
etc.
Je divulgue les détails de mon
attitude, qui sortent
des opinions reçues.
Les opinions reçues se révèlent être,
d’ordinaire, des préjugés.
Je continue sur cette voie.
Dans la réalité de l’après-guerre
(décrite déjà en détail),
la condition et la position
des contestataires,
des dissidents,
des émigrés politiques,
était presque vénérée.
Bien sûr, je les vénérais aussi,
mais en même temps ces conditions
m’étaient |
étrangères.
Il me semblait
ridicule de considérer
mes idées
comme une contestation
de ce bourbier intellectuel, de tous
ces policiers
de la culture et de la vie
humaine.
Le concept d’émigration
était contraire à ma
nature de révolte, de protestation,
à mon besoin de l’existence d’un « mur »
contre lequel
je puisse me taper
la tête. Ce qui signifiait pour moi
créer.
Je continue.
La clandestinité,
la conjuration,
cette tendance romantique
au « clandestin »
et cet excès
dans l’appréciation
de l’activité clandestine
me semblaient alors, horreur!,
artificiels
en quelque sorte.
L’état humain
naturel, c’était
le contact avec le monde,
la volonté de contact.
À tout prix.
Dans les années 50, j’ai peint
de très nombreux tableaux
en étant conscient que
je ne pourrais pas Les exposer.
Mais j’avais beau les peindre « pour moi »,
parce que je devais peindre,
peindre ainsi et pas
autrement,
je n’ai jamais tenu cela pour
«clandestin ».
À travers cette peinture,
j « entrais en contact »
avec le monde entier. Le monde libre.
Avec sa pensée et ses idées.
Je croyais qu’un temps viendrait
où mes tableaux seraient
contemplés.
Quelle serait leur fonction ?
À cette époque, je n’en étais guère
conscient. Il suffisait
qu’au moment où je les peignais
dans mon atelier clos,
ils me donnent. la liberté.
Je veux parvenir à la vérité,
à sa couche la plus profonde, à sa couche
brute,
en rejetant, refusant
tous les
«ornements »
dont on veut
l’habiller, la revêtir, la parer.
Je dois dire ouvertement
que cette nécessité
de créer un théâtre
et une peinture
différents
de la réalité
de terreur politique et de surveillance
policière
ne provenait pas chez moi
d’un sentiment d’obligation
de créer
un Mouvement de Résistance
ni d’un quelconque patriotisme
ni d’un héroïsme de lutte
clandestine.
Cette création d’une réalité
différente,
autre,
dont la liberté n’est pas
limitée par les lois
d’un système
de vie,
cette création proche de
l’acte démiurgique
ou du rêve, je crois
qu’elle est le but essentiel
du comportement en art.
Je reviens ainsi
obstinément à ces questions,
car je prévois
qu’à l’époque, qui se rapproche,
du « printemps des peuples »,
de lutte pour la liberté
politique et sociale,
ce concept
de liberté suprême
qu’exige
l’art
sera incompréhensible
et peut-être même
jugé
inutile.
La liberté de l’art n’est
pas un cadeau
de la politique ni du pouvoir.
Ce n’est pas des mains du pouvoir
que l’art reçoit
la liberté.
La liberté existe en nous,
nous devons combattre
pour la liberté avec nous-mêmes,
dans notre for intérieur
le plus intime,
dans la solitude
et la souffrance.
C’est la matière
la plus délicate qui soit.
La sphère de l’esprit.
C’est pourquoi
je ne me fie guère
aux théâtres
ni en général aux « comportements
artistiques » qui
sont apparus si nombreux
en ces dernières années
de « dictature du prolétariat »,
avec leur programme (d’a priori)
de lutte pour la liberté politique,
la liberté religieuse,
la liberté patriotique.
C’était encore pis si
sous ces mots d’ordre on glissait
des prétentions d’avant-garde.