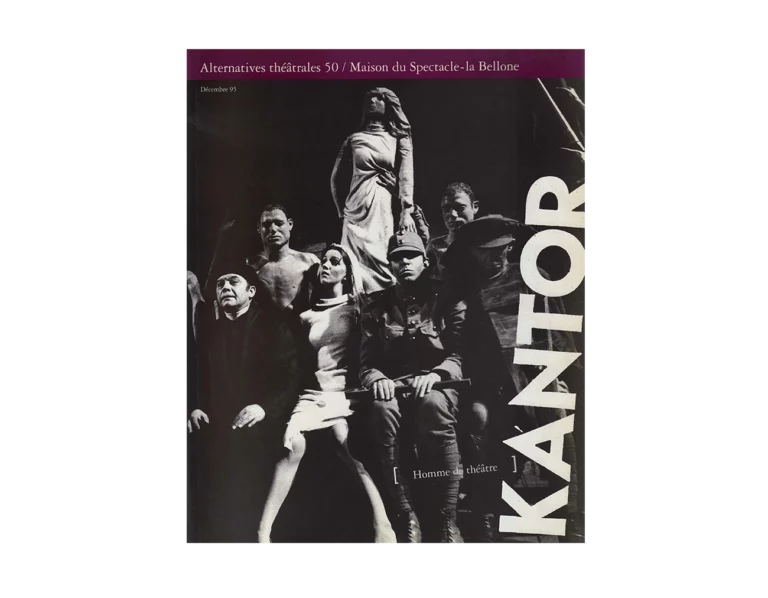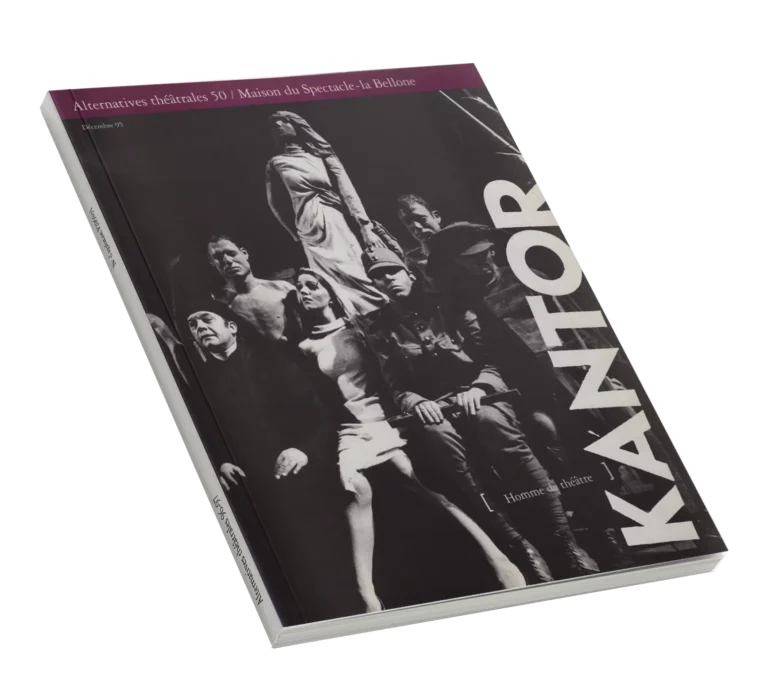*. Tadeusz Kantor, MA CRÉATION, MON VOYAGE, Paris, Éditions Plume, 1991, p.24.
« LES ‘OBJETS’ puisqu’on les nomme ainsi sont pour moi des lieux d’éternité ; sans eux les comédiens n’existeraient pas. »1
Dès le début de son travail, Kantor refuse de considérer l’«objet » comme un simple « accessoire » de scène. L’objet est le partenaire — ou adversaire — de l’acteur quand il n’est pas une partie même de l’acteur —«dans le cas le plus radical, l’acteur doit constituer avec l’objet un seul organisme. J’ai appelé ce cas BIO-OBJET ».2
Mais l’objet chez Kantor connaît de nombreuses évolutions. À côté des « objets trouvés », c’est-à-dire de la « matière arrachée à la vie »3 (table, chaises, planche), apparaissent des objets beaucoup plus sophistiqués, construits, fabriqués (les « organes du pouvoir » dans son dernier spectacle AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE), sortis de l’imagination de Kantor et qui révèlent un autre univers esthétique, une autre conception de l’objet.
Il est impossible en quelques feuillets d’élaborer une histoire de l’objet chez Kantor. Mais il est néanmoins intéressant à travers un seul objet — la planche, objet ô combien mythique, présent dans tous les spectacles — de tenter de définir la théorie de l’objet selon Kantor.
La planche « morceau de la réalité »
1944 : le Théâtre Clandestin Indépendant monte LE RETOUR D’ULYSSE : une planche sale « arrachée à la vie », fragment d’une vieille clôture abîmée, constitue l’un des éléments de l’espace scénique.
1990 : fin des répétitions d’AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE :une très longue planche « trouvée » dans un chantier de démolition barre l’image finale.
Entre ces deux dates, quarante-six années de recherches autour de l’objet pauvre, dégradé, de « l’objet trouvé » qui prennent comme point de départ cette planche. Non pas « les planches de bois qui semblent avoir un passé et qui sont fabriquées de toutes pièces »4 mais la planche authentique, vestige d’un passé ignoré (« l’objet sans passé ni avenir enlevé à sa quotidienneté »5), rescapée d’un sort qui la vouait à la poubelle.
« Les idées artistiques changent
L’abstraction cède sa place à l’objet
L’illusion est remplacée
par la réalité — réalité prise directement dans la vie,
La réalité brutale,
dépourvue d’esthétique.
Dans le champ d’action de ‘l’œuvre d’art’
on met
les morceaux de la réalité
répugnants
brutaux
lun morceau de bois pourri, cordage rouillé, la roue
de la voiture maculée de boue, décombres, de
vieilles caisses recouvertes de poussière, un
uniforme authentique, bruit d’une mitrailleuse6. »
En 1944, les éléments de la réalité sont les décombres de la guerre. LE RETOUR D’ULYSSE ne peut s’effectuer que sur ce fond de destruction, de pauvreté, de dégradation. Kantor rejette les notions d’illusion, de « décor ».
Intrusion de la réalité : la planche est et restera ce morceau de réel :
« 1944. Cette reconnaissance de la RÉALITÉ ‘brute’ non transformée par l’art a provoqué (…) le rejet de ‘l’objet artistique’ traînant derrière lui les notions de recréation, de représentation, de fiction — et son remplacement par l’OBJET RÉEL, arraché à la vie, tiré de ses fonctions et de ses conditionnements quotidiens.
L’objet est devenu ACTEUR »7.
Dans LE RETOUR D’ULYSSE, la planche EST et signifie Le réel, « la réalité du rang le plus bas ». Elle ne « joue » pas. Dans Les spectacles suivants, elle deviendra véritablement partenaire de l’acteur.
La planche, objet rituel
« Les Hassidim sont liés par la planche
dans une housse noire.
Elle est comme leur prolongement.
Elle les unit et les sépare en même temps.
Elle les terrorise.
Ils se frottent contre elle.
Ils la tiennent convulsivement (comme ‘la dernière
planche de Salut”)».8
La planche n’est plus seulement là comme référence au monde réel. Dans LA POULE D’EAU, elle s’inscrit dans le jeu prenant une autre dimension. Elle est indissociable des deux Hassidim et acquiert un statut d’objet rituel : elle est d’ailleurs recouverte d’une étoffe noire (les objets du culte juif sont entourés d’une enveloppe de protection appelée dans le langage populaire « manteau ») qui renforce son caractère sacré. Elle n’est pourtant jamais utilisée comme objet culturel mais, dit Kantor, « comme la dernière planche du Salut » (l’expression issue d’un terme de théologie chrétienne « Après le naufrage, la pénitence est la planche qui peut encore nous sauver »9 est prise ici dans son sens littéral). Elle joue le rôle de repère : les Hassidim sont solidaires de cette planche qui les isole du monde. N’est-elle pas le symbole du judaïsme qui unit les juifs à travers la diaspora et les empêche de disparaître malgré les épreuves car lorsque les Hassidim de LA POULE D’EAU chancellent « la planche dans une housse noire s’élève au-dessus du reste ».10
Dans WIELOPOLE-WIELOPOLE, la planche (les planches, elles sont au nombre de deux trouvées dans un chantier de démolition proche de Santa Maria à Florence et laissées dans leur état d’origine) intervient à nouveau dans un contexte religieux : l’‘Ultima Cena. Ces deux planches sont apportées dans la confusion par les deux jumeaux qui étaient les deux Hassidim de LA POULE D’EAU. Elles passent au-dessus des têtes, mouvantes et menaçantes : le prêtre est renversé. Ce n’est que recouvertes de la nappe blanche et immaculée qu’elles figureront la table de l’Eucharistie. Mais la Cène ne s’accomplira pas, la table sacrée redeviendra, après le pliage de la nappe, ce qu’elle n’avait jamais cessé d’être : deux simples planches de bois brut.
La planche, double esthétique et biographique
Dans AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE, la planche est présente dans une grande partie du spectacle : on pourrait même dire qu’elle est l’élément principal de cette autobiographie de Kantor : « le spectacle sera très autobiographique, très centré sur moi. Le premier acte, ce sera moi avant ma naissance. Il y aura peut-être aussi une séquence qui se situera après ma mort.…».11
La planche accompagnera ce cycle de la vie. Elle est, dès l’acte 1, la table de l’anniversaire (pendant les répétitions à Toulouse en octobre 1990, elle était recouverte d’une nappe blanche qui accentuait le côté célébration). La planche est lieu de fête et de réjouissances : l’oncle Stasio joue du violon en la prenant pour estrade. Puis la guerre fait irruption dans l’univers familial — la table-refuge (la famille s’abrite même sous elle) est piétinée, bafouée par les soldats. Mais solide, la planche résiste et la famille ne se déplace plus que solidement accrochée à elle : elle redevient cette « planche du dernier Salut » qu’elle était pour les Hassidim, mais elle perd tout caractère sacré.
Dans le dernier acte, la planche réapparaît :
« S’avancent au milieu du cimetière
la Famille, les ‘Chers Absents’
portant comme un cercueil
LA PLANCHE ».
La planche-cercueil retrouve dans l’image finale sa fonction de table, celle des funérailles. La mort de Kantor rend cette dernière séquence définitive. L’autobiographie prend fin : la planche en a scandé les épisodes.
Révélatrice de l’univers esthétique de Kantor dans LE RETOUR D’ULYSSE, elle est un double biographique dans AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE. Elle y est aussi, à l’instar de la présence de Kantor sur scène dans ce spectacle,
« un Magnifique condensé de [sa]
Théorie et de [sa] méthode ».12
À la frontière entre illusion et réalité. Présente dans le cadre du tableau où la cantonne son rôle d’objet d’art, elle retrouve dans l’image finale sur le devant de la scène, son statut d’objet réel, arraché à la vie.
- Tadeusz Kantor, entretien avec Philippe du Vignal, in Ari Press n° 95, Paris, 1985, p. 9. ↩︎
- Tadeusz Kantor, LEÇONS DE MILAN, Paris, Âctes-Sud Papiers, 1990, p. 55. ↩︎
- Tadeusz Kantor, entretien avec Chantal Meyer Plantureux, Cracovie, 14 novembre 1990. ↩︎
- Brunella Eruli, « WielopoleWielopole », in LES VOIES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE, vol. XI, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1983, p. 235. ↩︎
- Tadeusz Kantor, entretien avec Chantal Meyer-Plantureux, Cracovie, 14 novembre 1990. ↩︎
- Tadeusz Kantor, notes inédites citées par Denis Bablet, in LES VOIES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE, Op.cit., p. 27. ↩︎
- Théâtre Cricot 2, programme de LA CLASSE MORTE, Cracovie, 1975. ↩︎
- Tadeusz Kantor, LA POULE D’EAU, partition, in Travail théâtral, n°VI, Paris, 1972, p. 90. ↩︎
- Jean-Baptiste Massillon, « Carême » cité dans le LITTRÉ, p. 4750 (au mot planche). ↩︎
- Tadeusz Kantor, LA POULE D’EAU, partition, in Travail théâtral, op.cit., p. 91. ↩︎
- Tadeusz Kantor, « Ce qu’ils appellent la liberté », entretien avec Guy Scarpetta », in La Règle du jeu, n°1, Paris, mai 1990, p. 156. ↩︎
- Tadeusz Kantor, ibidem, p. 170. ↩︎