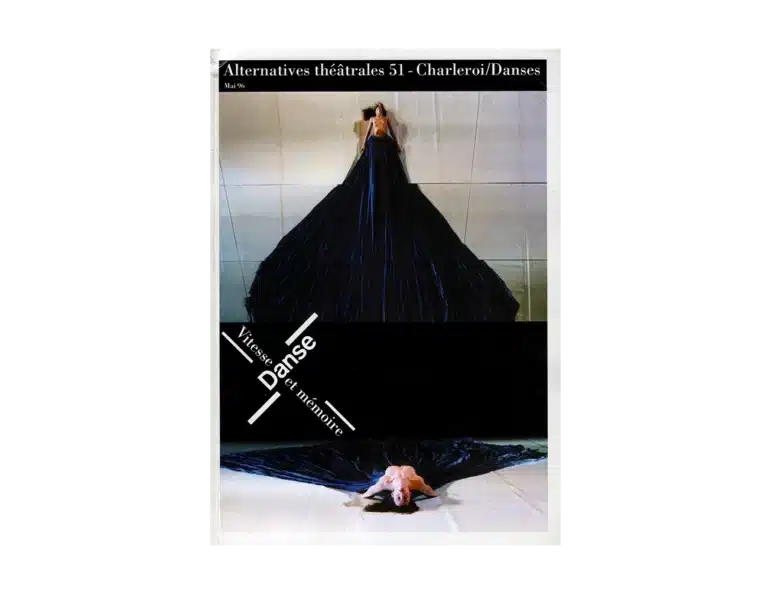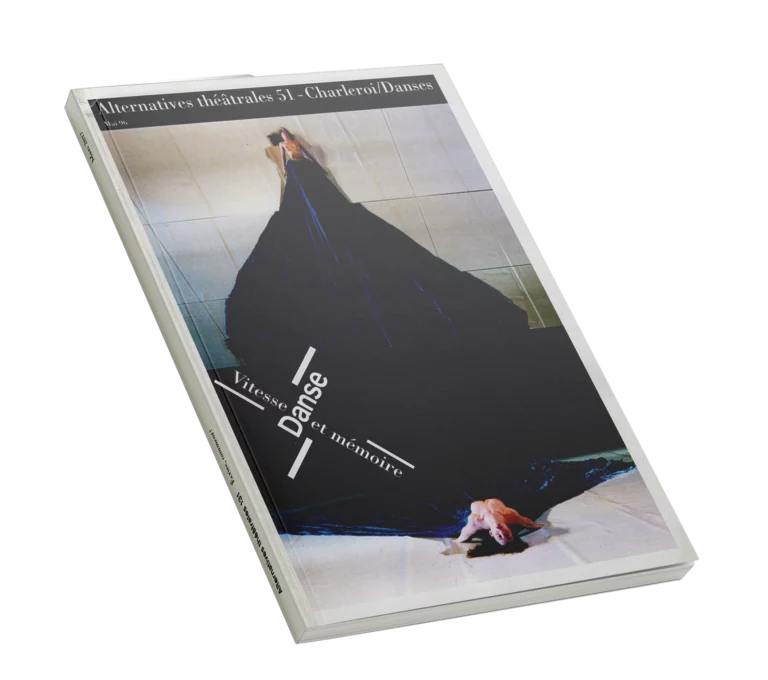BERNARD DEGROOTE : Vous avez une manière particulière de vous inscrire par rapport à la mémoire, en accordant de l’importance à la notation chorégraphique. La notation est-elle la première étape du processus de travail ou intervient-elle après la construction du mouvement avec les danseurs ?
Angelin Preljocaj : Elle vient en fin de parcours. Elle est là comme un instrument de stockage d’informations.
B. D.: Pourquoi la notation chorégraphique plutôt que la mémorisation par la vidéo par exemple ?
A. P.: Parce que je considère que la vidéo n’est pas la mémoire d’une chorégraphie, mais la mémoire d’une interprétation. Quand les danseurs étudient le mouvement à partir d’une notation, ce qu’ils apprennent, c’est le matériau. S’ils essaient de reconstituer le mouvement à partir de la vidéo, ils n’arrivent pas à faire la part de l’interprétation du danseur et de la chorégraphie. Et cela, c’est un grand problème pour la transmission.
B. D.: La notation chorégraphique est-elle une manière d’échapper au caractère éphémère du spectacle vivant ou s’agit-il uniquement d’un instrument de travail ?
A. P.: C’est surtout un instrument de travail, au même titre que les ordinateurs pour les services techniques de ballet. C’est un outil pour les chorégraphes, pour les danseurs, pour une compagnie de ballet qui a des contraintes de répétitions rapides, qui doivent être cohérentes, efficaces, simples. Il y a quelque chose de l’ordre de la transmission directe. C’est une courroie de transmission.
B. D.: Et avec les danseurs, vous travaillez sur base d’improvisations ?
A. P.: C’est un peu plus complexe. En général, quand je travaille sur un thème, je commence par quelques semaines d’improvisations avec les danseurs, mais je les utilise rarement telles quelles dans le spectacle. Après les séances d’improvisations, je commence à travailler. C’est comme si j’allais voir les improvisations en spectateur, et ensuite, chargé de tout ça, je commence à travailler une gestuelle sur mon propre corps. Consciemment ou inconsciemment, tout ce que j’ai vu est passé dans ma mémoire, dans mon cerveau, ma sensibilité, et ressort ensuite, retraité, dans le spectacle.
B. D. : Comme si vous utilisiez les danseurs comme des prolongements de votre propre corps ?
A. P.: Oui, c’est ça, et c’est aussi une manière d’évacuer des choses que je ne veux pas voir et que je ne veux pas faire dans mes spectacles. C’est-à-dire que pendant les périodes d’improvisations, apparaît aussi tout ce que je ne veux pas. Les périodes d’improvisations sont un moment important de réflexion artistique. Et après, je peux commencer à travailler. Alors ressortent ou ne ressortent pas des choses qui sont arrivées lors des improvisations, mais elles m’auront mené vers un processus de création.
B. D.: L’ANOURE, un de vos derniers spectacles, a été créé en collaboration avec un écrivain, Pascal Quignard. Il y avait donc un texte, et même un livret. Ÿ a‑t-il eu de votre part la volonté de faire se confronter plusieurs types d’écriture ?
A. P.: Absolument. Ce que j’aimais, c’était de voir comment on pouvait entremêler, entrelacer les éléments de manière à parvenir à une nouvelle texture. Comme si la littérature, la musique, la chorégraphie, la lumière et Le décor pouvaient être mêlés à un tel point que l’ensemble produise une matière nouvelle.
B. D.: Comment s’est organisée la confrontation dans ce spectacle particulier ?
A. P.: J’ai demandé à Pascal Quignard d’écrire une nouvelle. Puis, j’ai commencé à travailler chorégraphiquement. Ensuite, nous nous sommes vus, le musicien, l’écrivain et moi-même, et nous avons fait un synopsis commun, en plusieurs séquences, à partir duquel nous avons chacun retravaillé séparément. Nous avons remis les choses ensemble à nouveau et nous avons fait en sorte que les trois apports s’interpénètrent.
B. D.: La notation chorégraphique, c’est aussi une manière de faire durer les choses. Comment vous situez-vous par rapport à l’éphémère de la représentation chorégraphique, à cette idée de fête, de rassemblement à un moment précis dans un espace précis, qu’il est impossible de reproduire
A. P.: On dit beaucoup cela à propos de la danse, et on en parle très peu par rapport à la musique, alors que finalement, c’est la même chose. Qu’est-ce que donner une partition à un musicien ? C’est lui donner la structure, ce qui reste de l’œuvre. Ça ne veut pas dire pour autant qu’on est devant l’œuvre. Ensuite, l’œuvre, il faut la faire vivre. Et c’est le rôle de l’interprète, du danseur, de donner chair à l’œuvre, de donner son interprétation et de donner donc corps à cette structure. Alors évidemment, quand on est dans le spectacle vivant, il faut chaque fois recommencer. Et c’est très bien que ce soit toujours différent. Ce que j’aime dans la notation, c’est cette grande liberté qu’elle apporte à l’interprète. Comme je vous le disais au départ, l’interprète n’est pas en charge de l’image de son prédécesseur. Il est juste en charge de la structure de l’œuvre et tout le reste, c’est lui qui l’apporte, en corrélation avec le chorégraphe, le directeur artistique. Je crois qu’il y a autant de versions d’une œuvre qu’il y a d’interprétations et ça, c’est formidable.