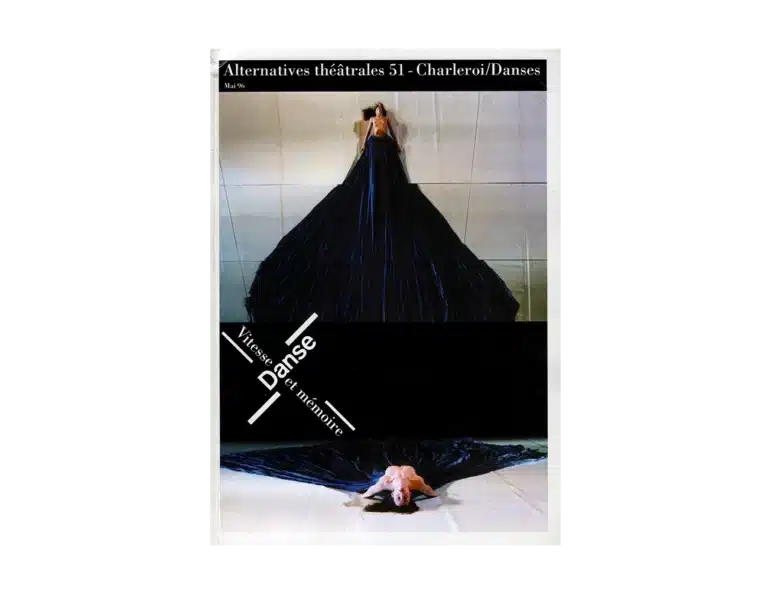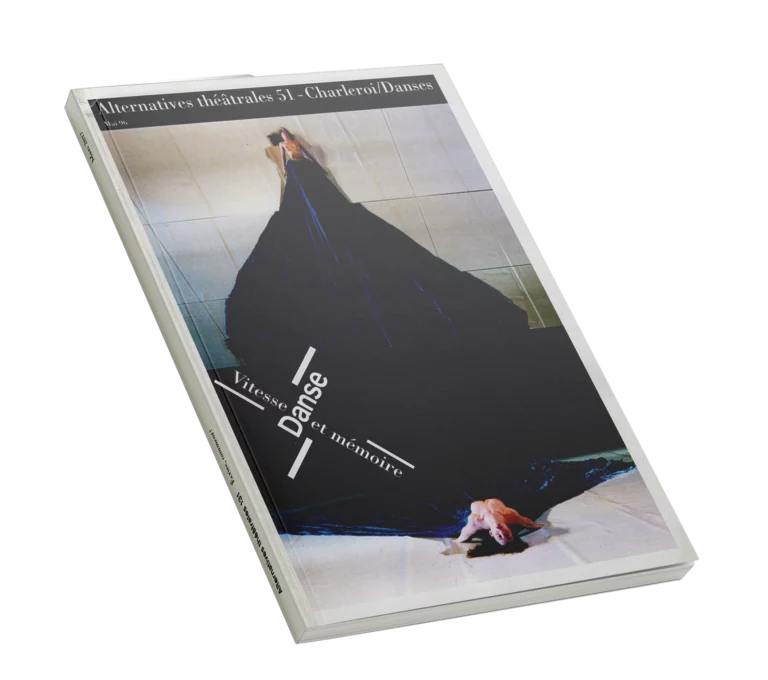NI PROTAGONISTE PRÉÉMINENT, ni simplement figurant, dans la hiérarchie d’une distribution, le rôle muet n’a rien de subalterne. Bien que réduit au silence, il reste présent la plupart du temps sur le plateau, maïs cela tient plutôt de l’absence/présence. Son mutisme trouble car, compact et opaque, le rôle muet creuse une faille, un abîme, dans le territoire de la parole. Sans se livrer à une enquête exhaustive, quelques figures exemplaires se détachent et confirment la portée dramaturgique du rôle muet. Que veut-il dire ? Que peut-il dire ? Et, surtout, comment le jouer ?
À Laurent, si souvent sacrifié, Roger Planchon a accordé un statut étrange à côté de Tartuffe. Molière l’a réclamé, mais les mises en scène ont écarté le plus souvent ce point aveugle, ce personnage muet qui accompagne le maître sans dire mot. Parce que dépourvu de paroles, Laurent se présente comme être de tous les possibles, espion ou amant, traître ou messager, et son interprète d’alors, Michel Raskine, alternait l’apparition inattendue et le passage furtif. Laurent est là sans être là. Le personnage muet se place sur les bords de la scène comme s’il souhaitait ne pas être absorbé par le dedans pour mieux dialoguer avec le dehors. Le jeu cultive ici l’effacement, vertu de la surveillance ou impératif d’un amour illicite. Ne serait-ce pas une référence à Laurent le double qui accompagne cette fois-ci un libertin déclaré, le Casanova de Fellini ?
Il faut distinguer entre les personnages de proximité — les confidents, les amis — qui se définissent par la rareté, voire l’économie extrême de paroles, et le personnage muet. Les premiers sont réduits à un silence de circonstance, silence social, silence partiel, qui témoigne de leur statut car la partition réduite dont ils disposent est le signe de la position secondaire qu’ils occupent. Le personnage muet, parce qu’interdit d’accès à la parole, ou simplement dépourvu, a encore moins d’incidence sur les choix et les actes dont il est souvent exclu. Il participe au cours des événements sans l’affecter pour autant. Ainsi la Mère de SIx PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR… Pour l’actrice qui l’interprète, la question se pose : comment jouer l’implication dans la tragédie familiale et en même temps la dépossession de tout discours ? La mère n’éprouve nul attrait pour l’extérieur, bien au contraire, elle voudrait parler et pourtant, parce que le père parle, elle en est empêchée. Dans une mise en scène récente de Catalina Buzoianu au Théâtre Boulandra à Bucarest, l’interprète de la mère, Mirela Gorea, fascine parce qu’elle commue le silence imposé en langage plastique : les mains serrées, le cou décentré, les yeux éplorés…., elle devient Madone. La comédienne use d’un répertoire de signes picturaux tout en évoquant un monde primitif où, faute de mots, les gestes se chargent de communiquer le drame. Gestes rares, essentiels, gestes d’une plasticité aux pouvoirs expressifs extrêmes. Là où les autres s’égarent dans le dédale des mots, elle se dresse comme une idole de la douleur. Le manque se convertit en langage du corps et le mutisme en éloquence discrète d’une Marie égarée dans le monde bavard du théâtre.
Un personnage, cette fois-ci physiquement muet, est Catherine, la fille de Mère Courage. Invalide, elle rêve d’intégration et cherche désespérément à dialoguer, à surmonter sa condition. Armée d’un tambour et juchée sur un toit, elle annonce, dans une scène célèbre, l’avancée des soldats ennemis. À force de le vouloir, Catherine finit par se faire entendre et les battements affolés de son tambour rappellent un beau poème où l’homme qui avait perdu un bras, parce qu’il s’est battu pour le remplacer, se voit récompensé par une aile… Iben Nagel Rasmussen, l’actrice fétiche d’Eugenio Barba, travailla plusieurs années sur Catherine pour dire le combat de la jeune femme avec le mutisme. Elle ne s’inspira pas de la peinture mais trouva appui dans une chorégraphie violente où borborygmes et coups de pied donnés au sol se constituaient en un pathétique prélangage. Faute de parler, Catherine danse… Danse lourde, désarticulée et brisée car toujours déployée sur fond de combat avec un manque non assumé. Les mots trouvent un équivalent gestuel, imparfait et dramatique, car Catherine se vit telle une Eve chassée du paradis de la parole. D’ailleurs, comme Lavinia, la fille de Titus Andronicus, à laquelle des monstres arrachent la langue. C’est sur le sable qu’elle écrira leur nom.
À l’opposé intervient le mutisme délibéré du personnage de Gombrowicz, Yvonne, princesse de Bourgogne, qui décide de ne pas parler pour affirmer ainsi son désir opiniâtre de non-intégration dans le monde adulte. Ici la comédienne n’a plus à convertir en langage gestuel le silence qu’elle adopte : il faut le jouer, avec tout ce qu’il comporte comme résistance explicite. Volontairement muette, Yvonne radicalise le mutisme initial de Cordélia et refuse le langage. Cette fois-ci, la rhétorique des gestes n’a pas de raison de se déployer et seule compte la présence. Irréductible et grosse de son aversion du monde, Yvonne se tait. Son silence s’érige en rejet et se constitue en programme. L’actrice doit jouer cela… C’est ce que fit avec un bonheur jamais égalé depuis Nathalie Bécue dans la mise en scène de Jacques Rosner. Le mutisme comme résistance.