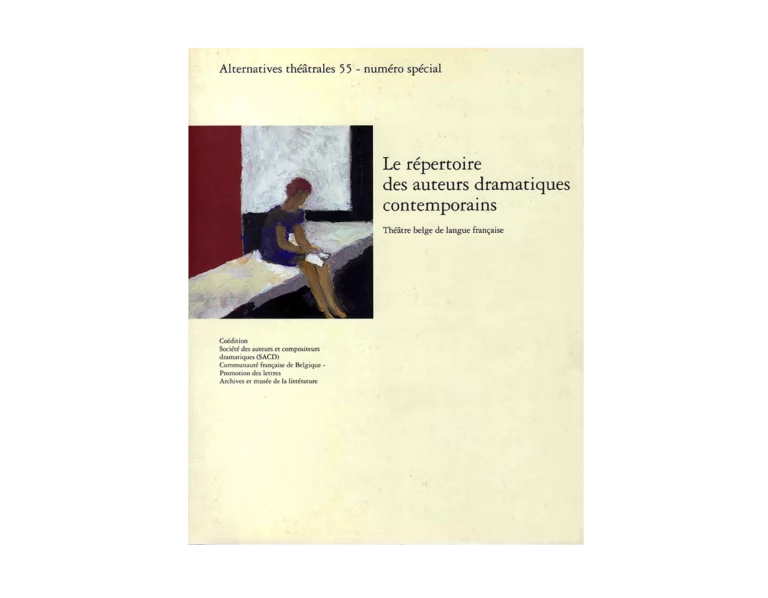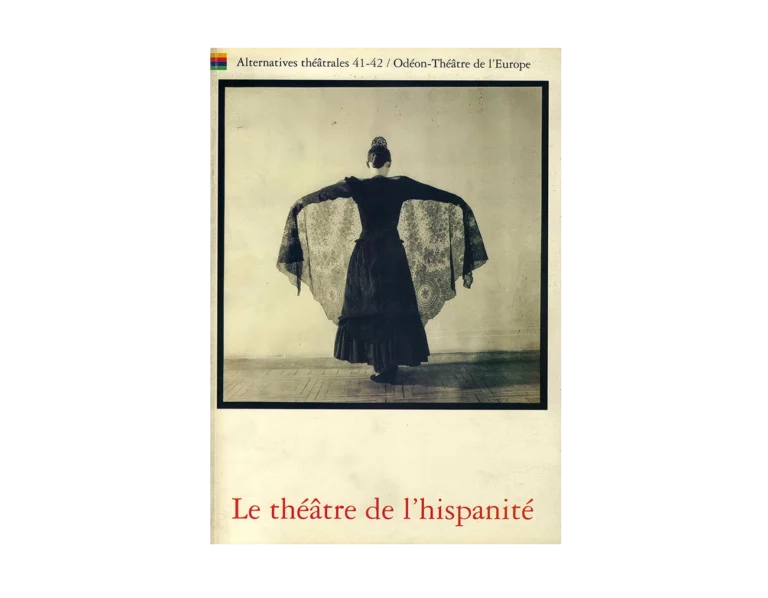HABITANTS D’UN PAYS à l’ancrage culturel complexe et multiple, pays de Régions et de Communautés, carrefour de cultures francophone, néerlandophone, germanophone, en continuelle interaction, les dramaturges belges francophones ont plongé dans le labyrinthe. Pour se trouver, pour se perdre à nouveau et continuer, ils ont tissé par leur écriture un jeu de reflets, de miroirs et de dédoublements. Réponse théâtrale, bien sûr, à une quête d’identité qui se dérobe indéfiniment. Mais ces masques, ces fantoches, ces pantins, ces personnages vides qui n’existent qu’au miroir de l’autre ou dans le flux ininterrompu de leurs propres paroles, traversent le théâtre francophone de Belgique, de Michel de Ghelderode à Paul Emond. On les retrouve dans les pièces de Paul Willems comme dans certains textes de Jean-Marie Piemme. Cette omniprésence chez des auteurs si différents semble traduire une question prégnante dans l’inconscient collectif : si « le monde est un théâtre », de quoi est faite notre toile de fond ?Et lorsque Philippe Blasband, Leïla Houari ou Layla Nabulsi font naître les images de leur culture d’origine, ces auteurs ajoutent encore et encore des facettes à ce questionnement. Notre ancrage culturel si pluriel ouvre-t-il la perspective jusqu’au vertige ? Jusqu’à convoquer sur scène la mort, les morts et tous les signes, les indices d’une mémoire qui permettraient de construire une assise, même bancale, même éphémère, pour avancer ? Le procédé revient dans les pièces de Jean Louvet, d’Émile Hesbois comme dans celles d’auteurs plus récemment apparus, Thierry Debroux ou Isabelle Bats, par exemple. Ce qui reste incontrôlable, insaisissable, il faut le détruire, le déconstruire pour, sans fin, recréer d’autres formes.
Au début de son histoire, le théâtre belge francophone est principalement un divertissement, un moment de loisir, un phénomène de prestige. Mélodrames, vaudevilles, opérettes et revues font le succès des quelques salles de la capitale, salles luxueuses où le public vient applaudir des vedettes souvent françaises. Pourtant, l’État, si jeune encore, cherche à forger son autonomie et son identité. Déjà les tentatives se multiplient pour créer une scène nationale où des auteurs prendraient en charge une épopée de la nation. Le second aspect de cette aspiration reste aujourd’hui encore à venir !
Première célébrité de ce théâtre, Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) n’écrit pas un théâtre belge. Il doit sa reconnaissance à un critique français, Octave Mirbeau, et sa renommée internationale au rayonnement du symbolisme belge à travers des revues comme La Jeune Belgique. Opposé au théâtre-divertissement, il engage l’écriture dramatique dans la voie du théâtre d’art. Sa pièce PELLÉAS ET MÉLISANDE inaugure le Théâtre de l’Œuvre de Lugné-Poe, tandis que l’ensemble de son œuvre contribue à créer à l’étranger une mode septentrionale, une impression « brumes du Nord » qui collera longtemps à notre théâtre. Univers onirique recouvert d’un voile de brumes, compositions en clair-obscur, harmonie des sons, des rythmes et des gestes, le théâtre de Maeterlinck orchestre la tragédie
de personnages écrasés par la fatalité de la mort ou de la passion amoureuse. Des personnages réduits au silence ou à l’impuissance, vidés de psychologie, marionnettes dans le théâtre de la condition humaine. Omniprésentes dans cet enfermement, corollaires de la claustration métaphysique, l’aspiration à un ailleurs, l’échappée onirique ou magique que l’on retrouve, plus tard, dans l’œuvre de Paul Willems.
Avec Maeterlinck s’affirme la quête d’un théâtre plus audacieux, davantage tourné vers la recherche. Ce contrepoint au théâtre de divertissement va se déployer dans les années vingt, à travers diverses tentatives qui auront des répercussions sur l’écriture dramatique. Ainsi, l’expérience du Théâtre du Marais, fondé par Jules Delacre, renforce le statut littéraire du genre théâtral. Delacre adopte comme ligne de conduite la promotion exclusive des œuvres et renie tout texte dépourvu de qualités littéraires. Il accueille les pièces de jeunes auteurs belges tels Odilon-Jean Périer ou Henry Soumagne. Comme l’explique Paul Aron1, les petites scènes et les troupes qui se multiplient à l’époque rejoignent souvent les avant-gardes littéraires surréalistes et dadaïstes. Si elles n’insufflent pas directement une nouvelle théâtralité, elles créent cependant les conditions de son épanouissement. Cette nouvelle théâtralité, il faut davantage la rechercher chez Fernand Crommelynck (1886 – 1970) et Michel de Ghelderode (1898 – 1962).
Le langage théâtral qu’inventent, dans leur style respectif, ces deux auteurs, s’ouvre largement à la performance d’acteur et au langage scénique. Tous deux conduisent l’imagination du lecteur vers les gestes et les attitudes, vers les mouvements et les déplacements, les équilibres et Les ruptures d’équilibre en jeu sur un plateau de théâtre. Les silences, chez Maeterlinck, étaient ceux de personnages peu à peu aliénés par la peur, l’angoisse, écrasés par la fatalité, par la mort. Dans le théâtre de Crommelynck et dans celui de Ghelderode, les ellipses, les phrases interrompues, les onomatopées, les cris, les répétitions, les variations de rythme sont aussi un langage « troué » qui appelle l’action, la présence physique, l’incarnation. La matérialité des êtres et des choses s’affirme. Métaphysiques chez Maeterlinck, les vides du discours théâtral deviennent physiques chez Crommelynck et Ghelderode. Mais la matière finit par devenir encombrante, excédentaire, excessive, elle déborde, dévale du corps des personnages comme de la scène, elle charrie les énormités, les excès, les outrances caractéristiques de ces écritures.
Fernand Crommelynck connaît la scène, il appartient à une famille de comédiens et anime, un temps, sa propre troupe. Il écrit ses pièces (LES AMANTS PUÉRILS, LE COCU MAGNIFIQUE, TRIPES D’OR…) entre Paris et Bruxelles et est bientôt traduit et joué dans le monde entier de Tokyo à Moscou, où Meyerhold met en scène LE COCU MAGNIFIQUE. S’il reprend des archétypes comme l’avare (TRIPES D’OR) ou le jaloux (LE COCU MAGNIFIQUE), Crommelynck conduit leur logique hors du vraisemblable, vers la démesure et le grotesque : le jaloux dénude le sein de sa femme sous les regards des autres hommes et l’avare mange son or… Perte des limites, perte des frontières entre soi et l’autre, entre soi et l’objet (dans LE COCU, la femme n’est qu’un objet) et bientôt, dans un paroxysme, perte définitive de soi à soi. Indissociables désormais, le comique, la farce et Le tragique s’interpénètrent. Dans la recherche désespérée de l’unité, de la vérité, le personnage de Crommelynck se heurte aux reflets et aux miroirs. « C’est vrai, parfois, je ne démêle plus les fils embrouillés du rêve et de la réalité…» reconnaît le Cocu2. Il s’y confronte et se perd dans le labyrinthe des créations de son esprit, des méandres de son imagination. Seul, définitivement coupé des autres et du monde, privé de points de repères, il tourne sur lui-même et grossit, se gonfle de violence.
Cette aliénation de l’être, cette déperdition se retrouve au cœur de l’œuvre de Michel de Ghelderode. Toutes les pièces de l’auteur (ESCURIAL, BARABBAS, MAGIE ROUGE…) ont, comme toile de fond, la mort. Elle est cette présence permanente, parfois incarnée sur scène, ce tourment, cette angoisse de chaque instant que seul le langage, le discours semblent pouvoir conjurer ou contenir un moment. L’excès, le burlesque, Le grotesque, l’alliance baroque du trivial et du tragique, les mascarades, les danses macabres tentent une réponse à la peur-panique de la mort qui plonge l’existence dans une profonde absurdité. Réponse dérisoire, théâtre éphémère, comme l’indiquent les multiples échanges de rôles entre les personnages, théâtre dans le théâtre et théâtre du théâtre puisque la vie, pour Ghelderode, n’est rien de plus.
Pour ne rien dépenser, Hieronymus (dans MAGIE ROUGE) offre à sa femme, en guise de nourriture, la contemplation d’une nature morte avec fruits ; en guise de baiser, il l’effleure et la laisse vierge pour ne pas détruire ce trésor inestimable. Tétanisé par la peur de perdre, d’entamer l’unité à laquelle il croit (la sienne), à laquelle il s’accroche (ses biens), Hieronymus vit dans le simulacre. Mais, enfermé dans son palais des glaces, le personnage, chez Ghelderode, devient une conscience malheureuse qui ne s’appartient plus, un être dessaisi de lui-même. Ainsi, le Roi (dans ESCURIAL) ordonne la mort de ses chiens et de son bouffon et regrette aussitôt cette perte.
Perdu, aliéné, le personnage de Ghelderode assume la mascarade, la violence grotesque comme une manière de rester en vie, de rester humain. Comme un espace — sauvé de l’absurde parce qu’absurde — subsistant pour l’action. Simplement dérisoire dans un monde absurde, l’être de théâtre est une incarnation du fatalisme. Michel de Ghelderode, par l’amplification et l’excès, conduit au-delà, vers l’agression peut-être, vers la réaction, certainement.
D’abord joué par un théâtre flamand en traduction, Ghelderode connaîtra un énorme succès en France et une renommée internationale. Son écriture témoigne de son intérêt pour les différentes formes de théâtralité, du cirque aux marionnettes (pour lesquelles il écrira plusieurs textes). Il utilise aussi des procédés expérimentés par le théâtre d’avant-garde à qui il confie d’ailleurs certaines de ses pièces.
Ainsi relayées en partie par des auteurs reconnus, les recherches de l’avantgarde ont exercé une certaine pression et ont forcé un questionnement sur la place du théâtre dans la société. Autour de 1930, se marque la volonté d’utiliser le théâtre à des fins politiques, souvent pour gagner un large public potentiel à une idéologie, à des valeurs. Les textes militants écrits pour l’agit-prop, les fêtes de scouts, les théâtres ambulants, se multiplient. Cet ancrage plus large du théâtre dans la société génèrera diverses entreprises institutionnelles d’encouragement des auteurs. Le dramaturge devient un enjeu politique, mais dans le même temps, est présenté comme celui qu’il faut protéger et promouvoir.
Paradoxalement, la guerre et l’occupation allemande, en paralysant les contacts avec Paris, favorisent la naissance de compagnies au rôle fondateur. En 1941, Jacques et Maurice Huisman créent Les Comédiens Routiers, une compagnie d’amateurs issus du mouvement scout. Leur rayonnement est tel qu’ils se verront confier la direction d’un théâtre national en 1945. En 1943, Claude Étienne crée le Rideau de Bruxelles et, avec LA MATRONE D’ÉPHÈSE de Georges Sion, inaugure une politique de découverte d’auteurs. Tout au long de sa vie, il encouragera l’écriture pour le théâtre. Il commandera des pièces à Paul Willems, Liliane Wouters, Jacques De Decker ou Marie Destrait entre autres. Peu à peu, le théâtre se dessine comme un instrument efficace pour refaçonner l’esprit national après les ravages de la guerre. Quant aux dramaturges de l’immédiat après-guerre — Suzanne Lilar, Charles Bertin, Jean Mogin, Georges Sion — ils se rattachent à la tendance néo-classique par les thèmes, la précision dans l’analyse des sentiments, la rigueur stylistique. Ils défendent un théâtre littéraire recentré sur des préoccupations métaphysiques et humanistes. Il n’est donc pas étonnant de voir Suzanne Lilar ou Charles Bertin s’intéresser à des personnages historiques ou mythiques et plus particulièrement, relire le mythe de Don Juan.
Suzanne Lilar n’écrira que trois pièces avant de devenir l’auteur de LA CONFESSION ANONYME (adapté au cinéma par André Delvaux sous le titre BENVENUTA) ou de poursuivre sa quête de la fusion des contraires dans des essais. Son théâtre (LE BURLADOR, TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU CIEL, LE ROI LÉPREUX) revient sans cesse sur la question de la transcendance ou plutôt interroge les chemins de la transcendance. Amour profane/physique ou amour sacré, humilité ou don de soi jusqu’au sacrifice ou l’humiliation. Suzanne Lilar cherche à dépasser les oppositions en créant d’autres voies vers l’absolu. Le point de vue est essentiellement celui des femmes, mais c’est en elles, par elles aussi que l’auteur semble vouloir fondre ces dualismes. Sans exclure la souffrance acceptée, assumée. L’abandon qui succède, un peu inexorablement, à l’éveil de la sensualité n’est pas synonyme de rupture, de nouveaux conflits. Les héroïnes de Suzanne Lilar semblent accéder à une autre forme de l’amour, un amour transcendant.
Charles Bertin, lui, maintient davantage le poids du destin et de la fatalité qui pèse sur ses héros. « Je suis né pour détruire », telle est la dernière réplique lancée par Don Juan3. Et l’auteur de renvoyer chacun des personnages à la solitude intrinsèque de l’être humain.
Tandis que cette période voit aussi débuter deux auteurs majeurs, Paul Willems et Jean Sigrid, la scène belge vibre des échos de la mutation esthétique qu’appelle le « théâtre de l’absurde » ou « nouveau » théâtre. La mise en question du discours et de son mode de relation au réel suscite le soupçon à l’égard du texte de l’auteur. Rien dorénavant n’est moins sûr que le discours supposé vrai de l’auteur sur le monde. L’œuvre s’en trouve sérieusement affectée dans son universalité. Le théâtre se tourne vers d’autres systèmes signifiants. Il cherche de nouvelles perspectives, il explore le corps de l’acteur, expérimente le rapport à l’espace, étudie les potentialités de la mise en scène, intègre l’image, s’autoanalyse.. Le texte-argument, le collage, Le pré-texte deviennent un des matériaux du spectacle où bien souvent ils se fondent. Riche en recherches sur les moyens scéniques, la décennie 70 – 80 génère de grands créateurs qui ne se revendiquent pas comme auteurs dramatiques.
Fondé par Frédéric Baal en 1969, le Théâtre Laboratoire Vicinal ouvre en Belgique la voie du théâtre gestuel dans une perspective inaugurée par Henri Chanal. Sans abandonner le texte, mais en le mettant radicalement en question sous l’influence d’Artaud et des travaux de Grotowski, les premiers spectacles du groupe (SABOO, REAL REEL, CHAMAN HOOLIGAN, I…) font éclater les codes traditionnels. Ce théâtre « pauvre » entend retrouver, en-deçà du langage oppresseur, dans l’expression par le corps notamment, une nature originaire, un art plus brut, plus élémentaire. La parole émane des improvisations d’acteurs à partir d’éléments — signes, indices — présents sur scène. Elle doit se fondre au spectacle, devenir un élément parmi d’autres. Frédéric Baal cherchait à s’émanciper de la conception humaniste en posant qu’«il n’y a pas d’histoire à raconter parce qu’il n’y a pas d’histoires ni de destin du monde »4. Lorsque le groupe éclate, quelques-uns de ses membres dont Frédéric Flamand fonderont le Plan K qui poursuivra l’expérience d’un théâtre gestuel sans texte. En 1991, Frédéric Flamand prendra la direction du Centre chorégraphique de la Communauté française à Charleroi. Parmi les autres groupes dont le travail s’élabore essentiellement à paitir du geste et du corps, les membres de Dur-An-Ki proposent d’abord des spectacles silencieux avant de retrouver le langage verbal (les textes de Claire Jaumain notamment). Avec son Théâtre Impopulaire (fondé en 1977), Alain Populaire fera le trajet inverse. Au rang des premières réalisations de son théâtre figure la création du REMPART DE BABYLONE de Gaston Compère. Cette écriture baroque, traversée de références à la musique, laisse sa marque sur les premiers textes que Populaire écrit pour des spectacles associant la peinture, la danse et la musique. Il abandonnera ensuite le discours pour une esthétique influencée par l’œuvre de Tadeusz Kantor. Les premiers spectacles de Brigitte Kaquet, le travail de Nicole Mossoux et Patrick Bonté portent eux aussi l’empreinte de toutes ces recherches.