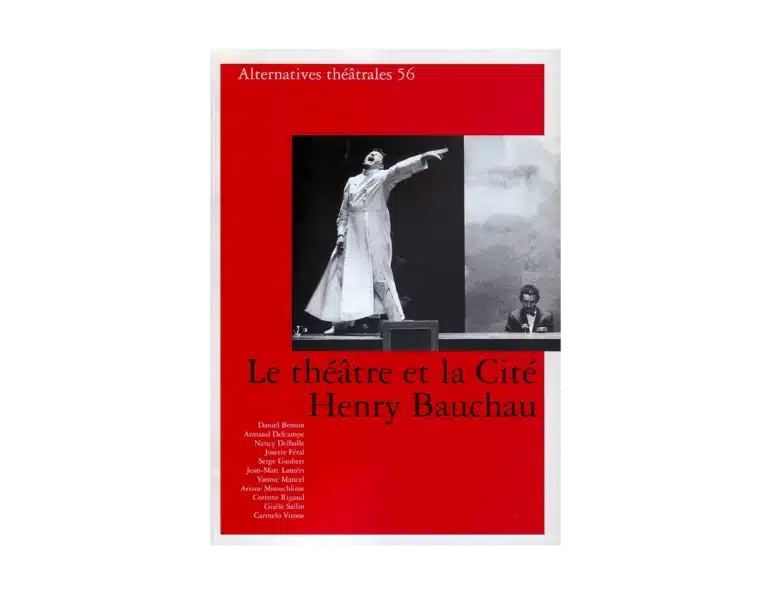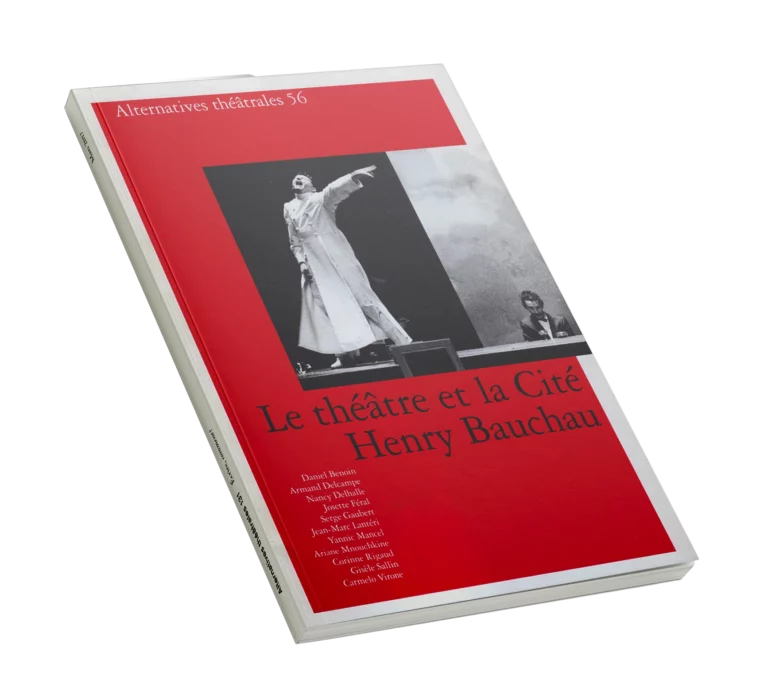JE VOUDRAIS d’abord préciser que ce livre n’est pas une suite d’ŒDIPE SUR LA ROUTE. Sur Antigone, telle que je la voyais en 1989 et dans les années précédentes, j’avais tout dit dans ŒDIPE SUR LA ROUTE, je pensais que c’était une étape franchie et désirais écrire d’autres choses. Il me semblait aussi que la mort d’Antigone et son conflit avec Créon avaient été portés sur la scène par Sophocle d’une façon complète et inégalable.
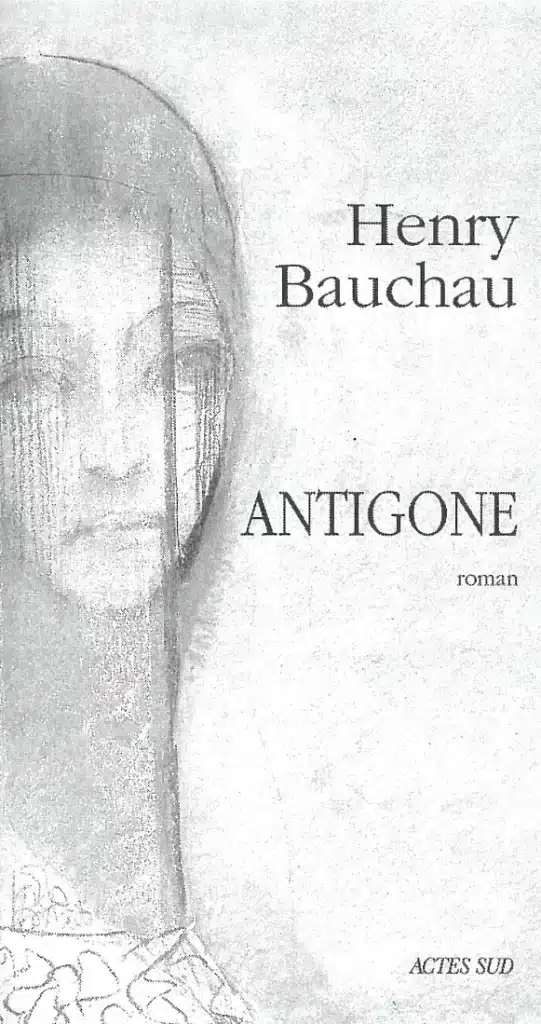
Au cours des années suivantes le personnage d’Antigone n’a pas cessé de m’habiter. Au milieu de mes autres travaux, je lui ai consacré plusieurs poèmes dont « Sophocle sur la route » et « Regards sur Antigone ». J’ai écrit sur elle cinq récits, dont deux ont été tirés de versions initiales d’ŒDIPE SUR LA ROUTE.
C’est après avoir récrit un de ces récits : L’‘ARBRE FOU, que je me décide, pendant l’été 92, à commencer vraiment l’ANTIGONE actuelle.
Au cours des trois années qui viennent alors de s’écouler, le personnage d’Antigone s’est modifié en moi : son rôle auprès d’Œdipe est terminé et la force qu’elle a acquise — et qu’elle ignore — au cours de son périple de dix ans avec lui, va lui permettre de faire face à d’autres épreuves. À ce moment, je ne vois qu’un personnage et ses premiers affrontements. J’entends les reproches qu’elle subit : ceux de Clios, ceux de sa sœur Ismène, je rencontre avec elle l’incompréhension de Créon, d’Étéocle et de Polynice. Œdipea finison parcours en redevenant voyant et en traversant glorieusement les siècles. Je vois Antigone aller d’échec en échec, avant d’être enterrée vivante sur l’ordre de Créon ; je ne vois rien de plus à ce moment, je n’ai pas d’autre projet, le personnage d’Antigone m’appelle, je le suis sans trop savoir et en m’interrogeant.
Au printemps 93, on m’invite à un colloque sur la poésie. Je suis déjà bien accroché à l’œuvre nouvelle, je ne peux pas m’en détourner, je refuse. On me dit que je pourrais parler d’Antigone et de la naissance de la poésie dramatique. J’accepte et j’écris LE CRI, texte repris en partie dans le roman actuel. Je dis là que les noms réunis de Sophocle et d’Antigone « trouveront le lieu qui manque, ils découvriront le langage qui, en n’étant pas la vie, devient plus fort et plus vivant que la vie. » Ce langage, celui du poème, celui du théâtre, permet à ceux qui voudront s’y exposer de mieux comprendre ce qu’ils vivent dans leur monde intérieur et dans leur existence collective.
C’est au cours de cette année 93, en Touraine au mois d’août, que je termine la première version de mon livre en écrivant, avec peine et chagrin, la mort d’Antigone. En 1991, dans L’ENFANT DES A LA MINE, j’avais montré Sophocle au même moment, dans l’écriture de sa tragédie. Sophocle aime Antigone, il ne peut supporter sa mort, il lutte contre son poème pour trouver une autre issue. Désespéré, il va voir son ami Périclès qui lui dit : « Ce qui importe, Sophocle, ce n’est pas qu’elle demeure vivante sut la scène, c’est qu’elle continue à vivre dans nos cœurs. »
Quand j’ai terminé d’écrire la mort d’Antigone, je sens le besoin de me distraire, de penser à autre chose. Cela marche quelques jours puis, peu avant mon retour à Paris, je passe une nuit affreuse. Le matin je m’éveille avec un considérable vertige et en voulant, par une étrange aberration, aller voir comme chaque jour le soleil levant sur la Vienne, je fais plusieurs chutes au cours de mon parcours en vélo. Vers le soir, je commence à comprendre quel a mort d’Antigone a été un événement intérieur que je n’ai pu vivre pleinement. Comme je l’écris dans mon journal : « J’avais écrit avec courage, avec foi, cette mort qui m’éprouvait tant. » Mais courage et foi ne suffisaient pas, St Paul l’avait fait remarquer avec justesse aux Corinthiens : « Quand j’aurais la foi qui soulève les montagnes, si l’amour me manque, je ne suis rien. » C’est l’amour qui m’avait manqué, ma première version achevée, j’avais tenté d’occulter la mort d’Antigone au lieu de continuer à la vivre et à l’aimer. Je ne voulais plus souffrir et Antigone s’était révoltée dans mon corps contre cet homme qui ne pouvait plus rien pour elle. Elle m’avait ainsi révélé son existence devenue indépendante en moi et ma propre fragilité.
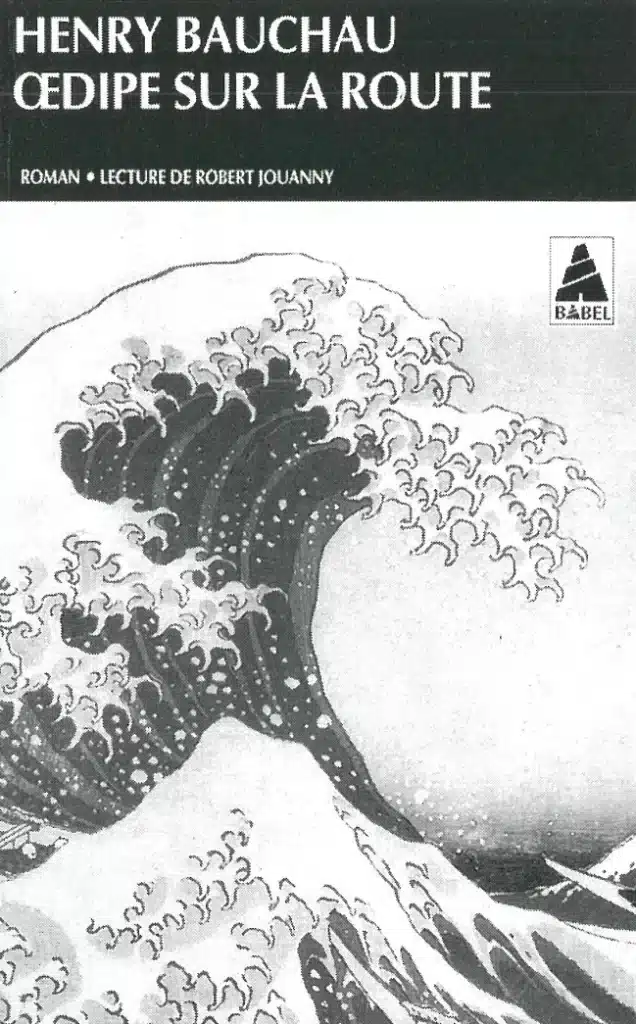
C’est à ce moment, en relisant l’ensemble de ce que j’avais écrit que j’ai ressenti un malasie de l’avoir fait à la troisième personne. J’ai écrit le premier chapitre à la première personne et j’ai été frappé par le naturel du « Je ». Ce n’est pourtant qu’au cours de l’été 94, en abordant le chapitre 12, celui de Polynice, que j’ai décidé de reprendre tout mon livre à la première personne. Pourquoi ai- je fait cela ? Je ne me souviens pas d’en avoir vraiment débattu, c’est dans le texte que c’est advenu. Antigone, peu à peu, m’est devenue si proche dans les mots — dans les mots et les maux — que la distanciation du « il » m’aparu factice et finalement impossible. Cela signifie-t-il que je me suis identifié à elle ?
Je ne le crois pas. Cela ne tient pas en tous cas à la différence d’époque cat pour moi Antigone est un personnage du présent. Elle est présente dans notre passé, notre avenir et surtout dans notre aujourd’hui.
Ce qui a empêché l’identification, c’est que tout en la sentant très proche, je n’ai jamais cessé de percevoir en elle le mystère de la femme pour l’homme. Pour suivre Antigone, pour la comprendre, j’ai fait appel à la part féminine qui existe en moi, comme en tout homme qui ne se contente pas de développer son ego. J’ai fait appel aussi, dans Antigone, à la part virile existant en elle comme en toute femme. En me relisant, il me semble que j’ai poussé Antigone, comme le fait la société occidentale pour beaucoup de femmes, vers une certaine image androgyne. Je le constate sans me souvenir de l’avoir voulu.
Pendant que j’écrivais ANTIGONE, j’ai assisté à un débat entre Georges Dubyet l’historien polonais Geremek. Ils se sont accordés pour dire que la plus importante révolution du 208 siècle était la révolution des femmes. Je le crois comme eux mais je pense aussi qu’en notre siècle les femmes, en assumant de nombreuses responsabilités jusque là réservées aux hommes, se sont le plus souvent conformées au modèle masculin, qui demeure dominant. Les hommes ont évolué mais ne se sont pas du tout approchés dans la même mesure de la façon de penser et de sentir des femmes. C’est là qu’Antigone paraît très importante pour notre temps. Deux très grandes figures féminines ont éclairé le monde occidental, celle de la Vierge Marie et celle d’Antigone. La Vierge est tout acceptation, patience, recueillement, elle est celle qui dit oui et qui parle et agit à travers son fils.
Antigone est celle qui dit non. Non au malheur d’Œdipe, non à la folie de ses frères, non au pouvoir absolu et injuste de Créon. Ce non pourtant défend les droits et les valeurs qui permettent d’accéder à un oui très vaste. Antigone, capable de penser et d’agir, indépendamment du modèle masculin, dit sa propre parole.
Dans mon livre, elle cherche le lieu où l’action et la parole, les siennes, celles des autres, celles aussi de l’événement, échappant aux servitudes de l’actualité, à son perpétuel glissement dans l’oubli ou la banalité, peuvent être vues et entendues avec suffisamment de force et de recul. Ce lieu qui manque deviendra le théâtre. À la fin de mon ouvrage, Antigone ayant entendu Lo raconter, vivre et chanter son aventure, comprend que dorénavant la véritable Antigone est l’Antigone d’Io et de toutes celles qui lui succéderont sur la scène. Elle-même peut mourir et retourner dans le grand mouvement anonyme auquel nous appartenons tous.
Maintenant que mon livre est terminé, je vois qu’il se dirige vers le théâtre, vers le poème tragique et la transmission.
En commençant, je ne voyais pas si loin, je voulais seulement montrer Antigone autrement, dans sa liberté, sa grandeur et sa faiblesse.
Pour cela j’ai donné une large place à ses frères, à Ismène, à Hémon et à des personnages nouveaux : K. le messager de la musique ou de la vie mystique, Vasco personnage ambigu et Timour qui découvre qu’Antigone a le don redoutable de l’arc. Antigone déteste la pensée et les absurdes ambitions guerrières de ses frères. Mais elle les aime et les admire d’être si sauvagement natifs de leur propre pensée et de refuser — comme elle fait elle-même — Les vérités qui ne sont pas les leurs.
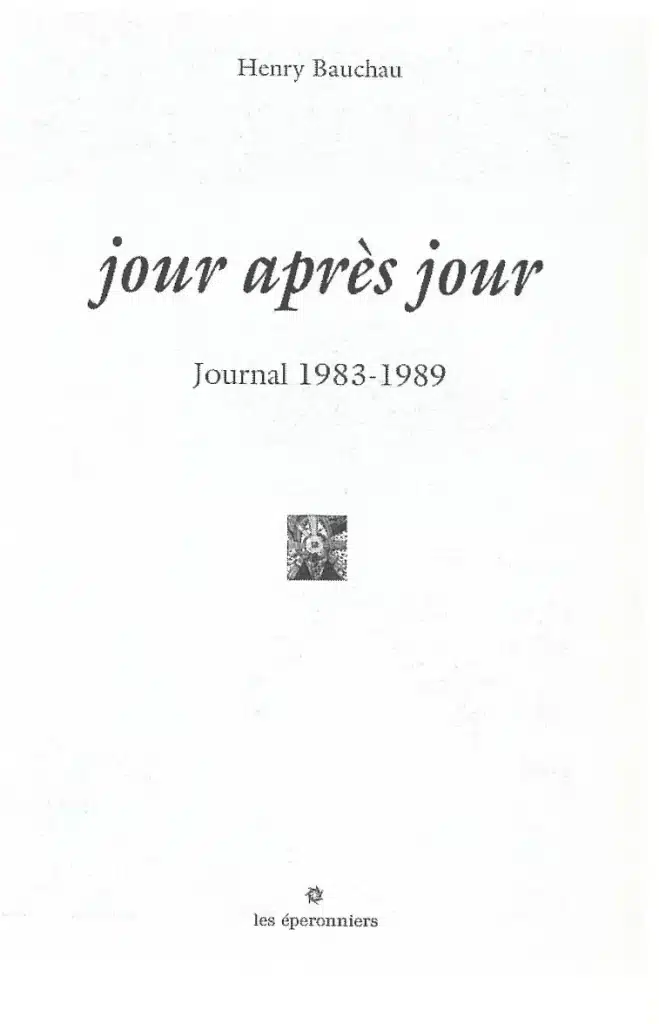
Antigone se déroule pendant la guerre civile entre Étéocle et Polynice, il se termine sous la menace d’une autre guerre civile entre Créon et son fils Hémon. Cette guerre serait causée par Antigone et elle veut l’éviter à tout prix. Les événements les plus marquants de ma vie ont été les deux guerres mondiales que l’on peut aujourd’hui tenir en partie pour des guerres civiles. J’ai écrit les premières versions d’Antigone pendant la guerre de Bosnie et il est vrai que le thème de la guerre civile domine mon roman LE RÉGIMENT NOIR, se retrouve dans l’Histoire des Hautes Collines dans ŒDIPE SUR LA ROUTE et maintenant dans ANTIGONE.
Je n’ai pas accordé au personnage de Créon la même stature que Sophocle et je n’ai pas donné la même importance que lui à l’affrontement décisif entre Antigone et lui. Je pense que Sophocle a donné à voir et à entendre, de façon insurpassable ce conflit, je n’ai pas tenté de refaire ce qu’il a exprimé avec tant de profondeur, de force et de sobriété. Mon Antigone n’est pas un personnage de tragédie mais de roman, elle n’est pas la femme d’un acte, d’un débat, d’un refus. Elle est la femme d’un monde nouveau qui, à travers une longue initiation, trouve le courage d’agir et de penser sans modèle.
ANTIGONE a été influencé par la maladie de ma femme qui a accompagné son écriture. Le caractère inéluctable de son destin a été tracé par Sophocle mais il reflète l’incapacité où nous sommes encore de lutter contre la maladie d’Alzheimer. L’effacement de la personne d’Antigone devant l’Antigone d’Io, celle du mythe, du théâtre et de la transmission correspond à l’action de la maladie qui efface mémoire et parole.
À ce moment on découvre que la vie, dépouillée des précieux attributs de la personnalité, demeure le vrai trésor et que sa lumière, voilée par les nuages du temps et de l’épreuve, nous éclaire toujours.
Il y a beaucoup d’aventures dans ce livre, je ne les ai pas inventées, j’ai dû les voir pour écrire, c’est pourquoi ce livre m’a pris tant de temps. Il faut ce temps, il faut l’attente et l’espoir pour que l’aventure s’apprivoise un peu et accepte de se laisser voir. Antigone a été une chance peut-être, une douleur parfois, un bonheur sûrement dans mon existence.
Extrait d’une lettre à Bertrand Py, directeur éditorial aux Éditions Actes Sud
DIOTIME ET LES LIONS, récit, Actes Sud, 1991 ; Babel (Labor) 1997.