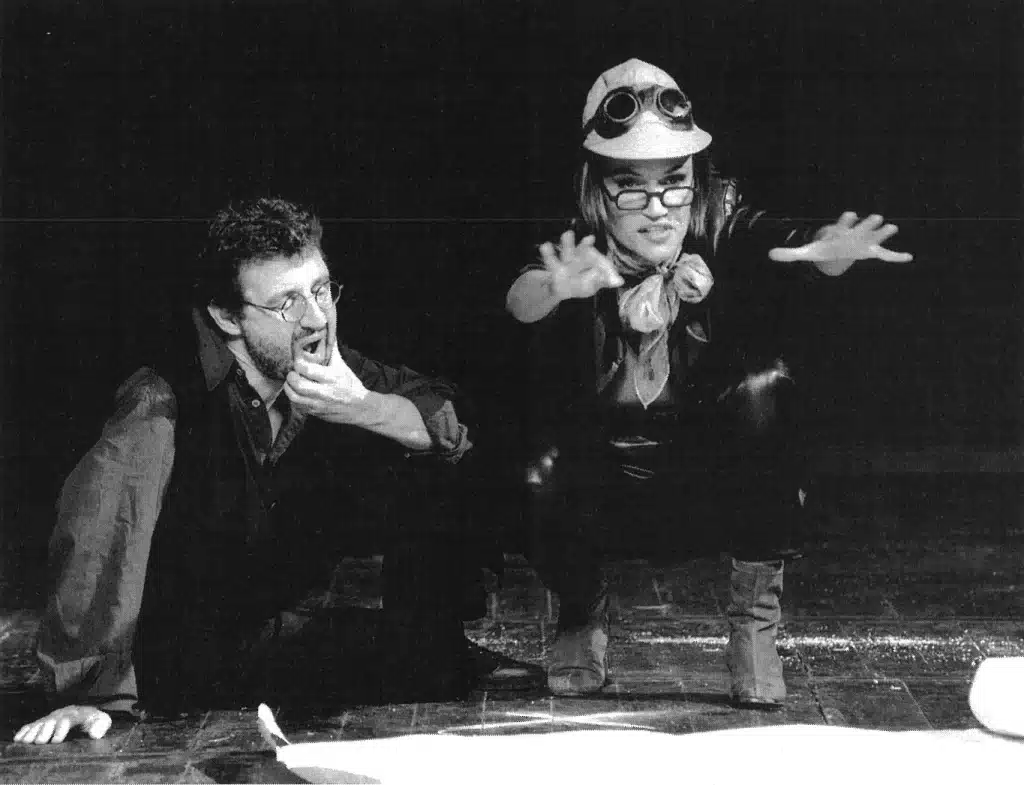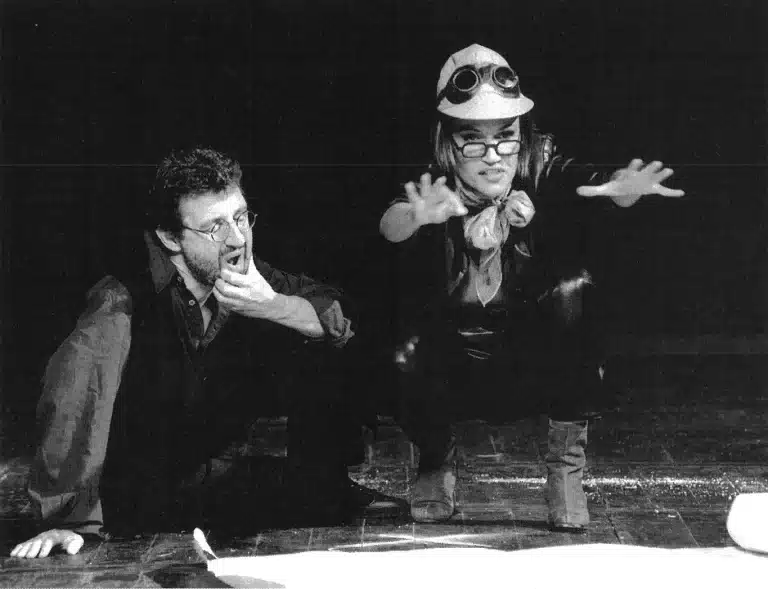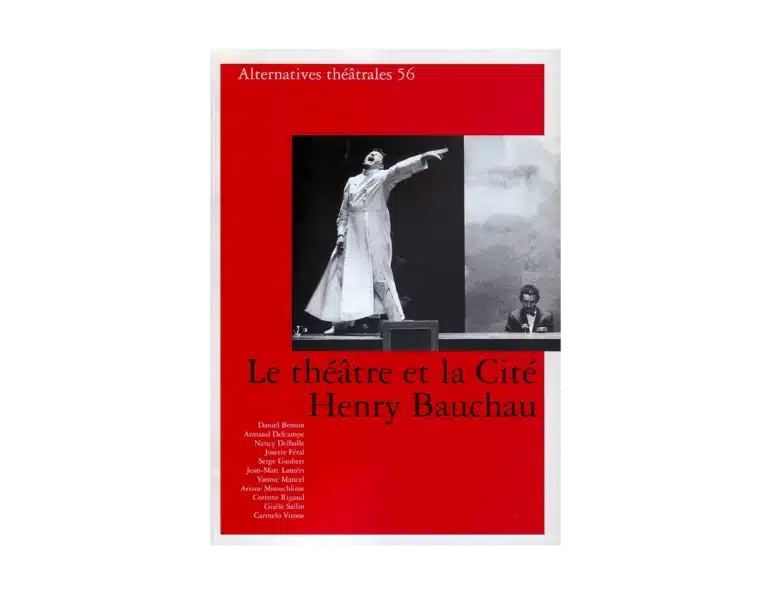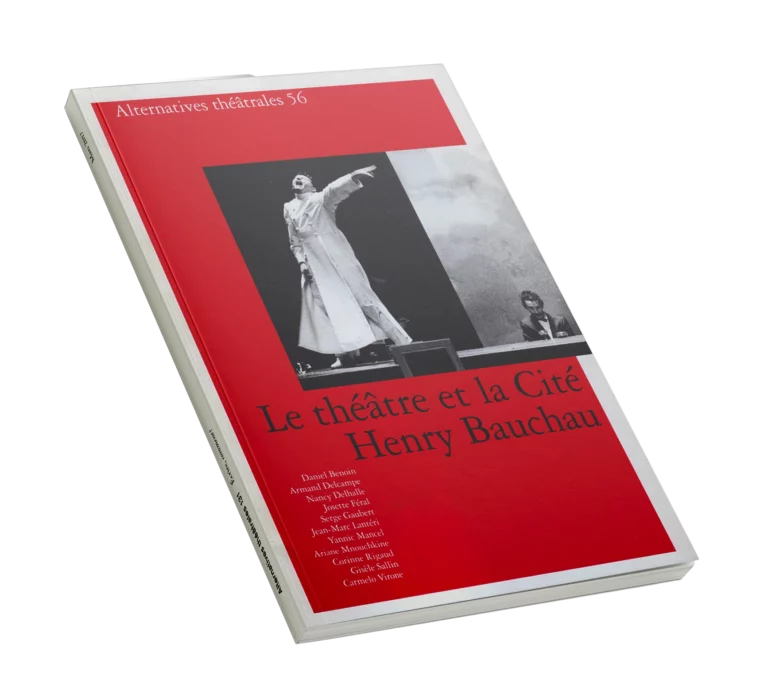CORINNE RIGAUD : Il y a un certain nombre de questions d’ordre du pratique que je me pose et auxquelles j’aimerais que vous répondiez avant de vous entretenir de la problématique du théâtre service public, dans le cadre de la Comédie de SaintÉtienne. Je voudrais savoir, par exemple, si VOUS avez toujours le même contrat qui vous lie au Ministère de la Culture ; c’est-à- dire le contrat de décentralisation dramatique.
Daniel Benoin : Le contrat est toujours de trois ans. Il est toujours sous les mêmes principes généraux mais il a beaucoup évolué en ce qui concerne le contrôle. À l’époque du premier contrat, la philosophie de l’État consistait, pour résumer, à confier un Centre Dramatique à un artiste afin qu’il puisse réaliser son travail dans une structure dont l’identité était liée à une région. Aujourd’hui, le contrat est toujours un peu sur le même schéma mais les contraintes sont plus nombreuses : par exemple, il faut créer des auteurs contemporains, il faut aider des compagnies et accueillir des spectacles — nous le faisons depuis toujours mais aujourd’hui, on nous l’impose — en revanche, on ne nous demande plus de nous inscrire dans une région spécifique. Les règles du contrat s’alignent sur celles de la réalité. Si le nombre de contrôles a augmenté, c’est aussi parce qu’il y a eu des débordements, des erreurs. Mais il est clair que l’État n’a pas besoin de tous ces contrôles pour repérer dans certains Centres Dramatiques, une mauvaise gestion. Ainsi, les procédures de contrôle ont plus ou moins de mal à se justifier. Mais ce n’est pas bien grave ; nous avons seulement un peu plus de travail.
C. R.: Les contrôles se présentent sous quelle forme ?
D. B.: Sous forme de quotas. Il faut faire, par exemple, tel pourcentage de chiffre d’affaires par rapport au total du budget. Pour être plus précis, admettons qu’il y ait un Centre Dramatique qui fasse 9 % de chiffre d’affaires, ce qui n’est pas très bien, alors on nous réclame tout à coup de faire 20 % même si dans la pratique, la plupart des Centres Dramatiques ne font pas moins de 20 % de chiffre d’affaires. Alors, comme je viens de le dire, ce n’est pas bien grave mais cela marque un état d’esprit qui n’est pas le bon. Pourquoi l’État ne se prononcerait-il pas et pourquoi ne prendrait-1il pas des décisions puisqu’il en a la possibilité tous les trois ans ?
C. R.: L’article premier de votre premier contrat dit que Monsieur Daniel Benoin s’engage à ses risques et périls. Pouvez-vous évaluer les risques que vous avez pris et les périls que vous avez subis ou évités ?
D. B.: La Comédie de Saint-Étienne est un Centre Dramatique National mais elle est en même temps, une entreprise de type privée. Les Centres Dramatiques Nationaux ont des missions de service public mais ne sont pas des établissements publics (cette ambiguïté est d’ailleurs intéressante pour gérer de manière judicieuse un théâtre) et en tant qu’entrepreneur privé, c’est évidemment à mes risques et périls que je fais mon travail. Mon budget est donc constitué des subventions de l’État, prioritairement, mais aussi de la ville et du département, auxquelles il faut ajouter les apports du mécénat et les entrées des recettes propres. Je suis à la fois le directeur d’une structure qui m’a préexisté (le Centre Dramatique National) et le P.D.G. d’une entreprise en devenir (la Comédie de SaintÉtienne). Le tout ne formant qu’une seule entité. Et si les Centres Dramatiques Nationaux sont des théâtres de service public, c’est essentiellement parce qu’ils reçoivent ces subventions de l’État. À quoi sert la subvention ? Fondamentalement ?À réduire le prix des places afin que la totalité de la population puisse accéder au théâtre ! C’est la première définition du service public.
C. R.: Quelle est votre politique de programmation et d’accueil ?
D. B.: Ma politique d’accueil répond, en gros, à une nécessité : présenter, de façon panoramique, ce qui se fait actuellement au théâtre, des projets qui sont dans un certain domaine des objets de pointe, qu’ils rentrent ou non dans mes perspectives. Je dirais que 80% de ma programmation se fait comme ça ; les 20 % restants, relèvent de, ce que j appelle les programmations d’équilibre ; parce que je considère que ma liberté en tant qu’artiste, ma liberté majeure, c’est d’avoir un grand public. Le public de Saint-Étienne est un public large qui n’est pas homogène. Sur les 13 000 abonnés, il y en a, grosso modo, 3 000 qui sont des « connaisseurs », 3 000 qui sont plutôt des « néophytes » et 7 000 entre les deux. Ces définitions, très vagues, marquent une réalité protéiforme qui est très importante. J’essaie, donc, sur les 20 % de programmation qui me restent de rééquilibrer afin que les uns et les autres trouvent au théâtre ce qu’ils sont venus chercher en dehors des spectacles que je leur impose. Effectivement, je me permets régulièrement d’imposer, à la totalité des abonnés, une pièce contemporaine qui n’a jamais été créée. Si je n’avais pas, à travers l’abonnement, imposé GHETTO, il y a une dizaine d’années, personne (ou presque) ne serait venu voir le spectacle. J’imagine les commentaires : « GHETTO ? Ça parle de quoi ? Oh ! L’extermination des juifs dans le ghetto de Vilnious en Lituanie… Non, on ne va pas aller voir ça ». Le spectacle a très bien marché et les gens étaient contents de l’avoir vu. Si j’avais laissé Le choix aux 13 000 abonnés, 3 000 d’entre eux, peut-être, l’auraient vu. C’est exactement la même chose pour le spectacle que je viens de faire : une pièce contemporaine qui a pour sujet un metteur en scène à Tel Aviv qui essaie de monter une pièce sur la bible1.
Grâce à l’abonnement j’oblige le public à prendre le risque de découvrir.
L’abandon de l’abonnement est incontestablement une faiblesse de la part des théâtres qui ne pratiquent plus ce système. Il y a deux raisons évidentes à cet abandon progressif ; une raison quantitative : souvent, les théâtres ont peu d’abonnements et pas assez pour en faire une technique, et une raison qualitative qui fait dire aux détracteurs que l’abonnement est une contrainte qui fait fuir le public. Je pense au contraire qu’à l’heure actuelle, si on n’oblige pas le public à aller au théâtre, il ne vient pas. Si on ne dit pas au spectateur, 6 mois à l’avance, que le mardi 15 septembre à 19h30, il doit être au théâtre, il n’y va pas. Mais le plus bel avantage de l’abonnement, reste celui de fair découvrir aux spectateurs ce qu’ils n’iraient pas voir autrement. C’est dans cette découverte « imposée » que nous pouvons continuer de dire que le théâtre tient un rôle dans le progrès de la pensée, dans le progrès des idées. Sinon, nousrentrons obligatoirement dans une politique de marketing où les spectateurs vont voir ce qu’ils ont envie d’aller voir et non pas ce que nous pensons qu ils devraient aller voir. Mais il faut savoir que l’arme ou les instruments que nous utilisons peuvent se retourner contre nous si nous ne faisons pas correctement notre travail. Si, par exemple, nous créons des pièces qui ne rencontrent pas le public, nous prenons le risque de voir le chiffre des abonnements diminuer.
C. R.: Comment, d’une année sur l’autre, gardez-vous les 13 000 abonnés ?
D. B.: Il faut faire un travail tout au long de l’année. Sur les 13 000 abonnés, il y en 6 ou 7 000 qui se précipitent pour les abonnements ; quant aux autres, il faut aller les chercher et les amener progressivement au théâtre. C’est le travail du service des relations publiques : un travail d’animation et d’explication. Je pense que le théâtre que nous devons faire est un théâtre d’art — même si le terme a été un peu galvaudé — qui soit exigeant et qui allie à la fois l’éthique et l’esthétique … Et ce théâtre d’art qui produit des œuvres qui ne sont pas forcément compréhensibles en soi, nous en organisons l’intelligibilité à travers le système de l’abonnement.
Le public aujourd’hui, est d’une certaine manière plus conservateur ; les jeunes qui ont aujourd’hui 20/25 ans sont plus conservateurs que leurs parents ne l’étaient, il y a 20 ans. C’est d’abord une question de sensation et certaines études l’ont prouvé. Il y a 20 ans, le public qui était dans une salle de théâtre était un public qui pensait, dans sa majorité, que demain serait mieux ; aujourd’hui, le public, dans sa majorité pense que demain sera pire. Donc, évidemment, le vecteur porteur de la pensée n’est pas le même. Il y a dans un cas, l’espérance d’un progrès, et dans l’autre une recherche de la jouissance immédiate, du divertissement, de l’exotisme bon marché et une tendance à la « starisation ». Évidemment, on ne travaille pas du tout de la même manière dans les deux cas. L’état a une certaine part de responsabilité ; quand il impose 20 % de recettes propres, c’est une bonne chose mais certains théâtres en font un prétexte pour faire des recettes avec n’importe quel moyen. C’est ainsi que nous avons vu tout à Coup apparaître des vedettes sur la scène des théâtres publics et avec des salaires qui sont incompatibles avec les missions que ce même théâtre doit se donner, Dans une relation de causalité, il y a eu des dérives pour lesquelles la responsabilité de l’État a été amplifiée par les gens de théâtre qui n’ont, c’est vrai, pas beaucoup résisté. J’en reviens à l’abonnement et au spectacle : LES VARIATIONS GOLDBERG ; Je considère avoir fait un acte de résistance notoire parce qu avec cette pièce nous avons lutté contre le conservatisme ambiant. Alors, est-ce qu’à partir de là, il faut chercher un nouveau public ?
Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, la Comédie était marquée, à tort, comme un fief rouge ; à tort parce que bien évidemment, à cette époque-là déjà, le public était à moitié à gauche et à moitié à droite. En conséquence, la bourgeoisie était une catégorie qui ne faisait pas partie du public et que nous avons conquise petit à petit. Il reste une frange de 500 personnes à peu près qui pourraient être abonnées à la Comédie de Saint-Étienne et qui ne le sont pas Ils ne le sont pas parce qu’une première moitié est trop impliquée dans le milieu artistique et estime que 13 000 abonnés, c’est le signe irréfutable d’une politique trop consensuelle et une seconde moitié parce qu’elle considère encore que la Comédie est un fief rouge.
C. R.: Au regard des 20 dernières années, avez-vous l’impression d’avoir fait votre théâtre ? Un théâtre de service public ? ou les deux ?
D. B.: Très franchement, je suis sûr que je suis arrivé pour faire mon théâtre ; j’étais sûr également que ma manière de penser le théâtre allait évoluer et elle a évolué. Mais elle n’a pas évolué pour devenir un théâtre de service public. On fait du théâtre, on fait son théâtre, honnêtement, avec ce que l’on a en soi, à la fois dans sa mémoire, dans son enfance, mais aussi dans sa fantaisie et puis on essaie de faire en sorte que son théâtre devienne un théâtre de service public, c’est-à-dire, faut-il le répéter, un théâtre exigeant, nouveau dans sa forme et dans sa conception mais qui ne perd jamais de vue le spectateur.
C. R.: Christian Schiaretti dit : « La première définition du service public, c’est qu’il est un héritage »2. Comment vous situez-vous vis-à-vis de l’héritage que vous avez reçu ?
D. B.: Vous voulez dire, quelle est la relation profonde qu’entretiennent cet héritage et ma pratique artistique ? Ou quel est le rapport entre cet héritage et ma pratique artistique ? Il n’y a pas de lien direct entre ce que j ai reçu et ce que j’ai fait. Je veux dire par là que l’héritage n’implique pas une servitude et que la notion de service public qu’il véhicule et que nous avons récupérée, n est pas une contrainte pour l’ambition artistique. Les Centres Dramatiques ne sont pas une charge, mais une formidable possibilité. La possibilité de profiter d’une tradition pour faire de la nouveauté. En ce qui me concerne, je veux faire en sorte que ce soit avant tout le grand lieu de vie et pour cela je suis prêt à un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme des licences par rapport aux us et coutumes du théâtre « hérité ».
C. R.: Si je vous dis que le théâtre va mal ? Qu’il est en crise ?