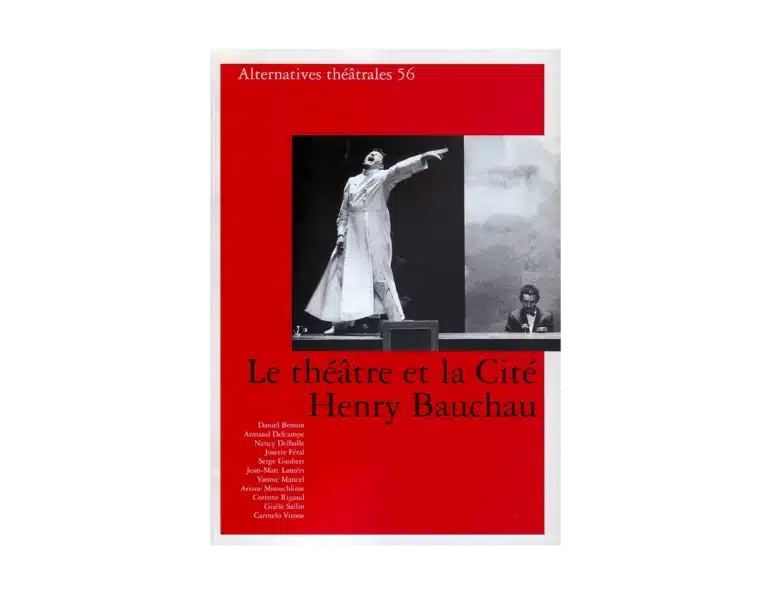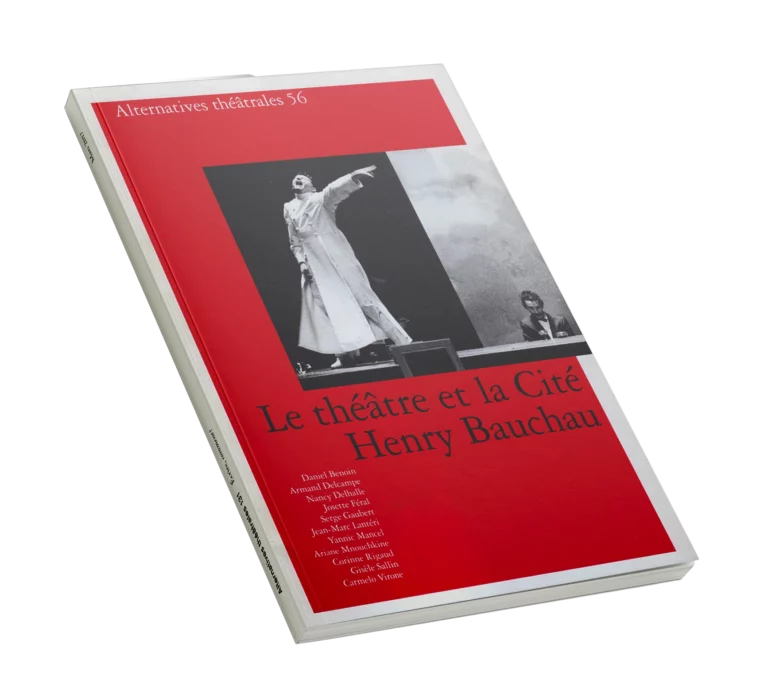IL S’AGIT D’UN DYPTIQUE, dont les deux volets se conçoivent en autonomie, mais c’est le trajet d’un héros tchékhovien à l’autre qui a fasciné Ludovic Lagarde, itinéraire doublement sacrificiel d’un meurtre à un suicide, deux morts qui sanctionnent l’immobilisme, les impasses individuelles et collectives de tout une société : de la Russe à la nôtre, entre lesquelles le spectacle trace une médusante analogie.
De PLATONOV à IVANOV, le spectacle dessine avec une efficace lisibilité qui n’exclut nullement la nuance, le et les trajets de la jeunesse à la maturité, mais Platonov, le jeune homme ranci, et Ivanov, l’homme mûr prématuré sé partagent la même amertume. Aux deux personnages est dévolu le complet blanc crème. Symbole de l’aristocratie et de la valeur perdues, la blanc devient rapidement le signe avant-couteur de la mort. Platonov est encore un petit dandy, ses joues mal rasées participent d’un charme négligé, où l’élégance le dispute à l’insolence. Et il porte une mince cravate, il joue encore avec goguenardise le jeu de l’apparence. Ivanov, lui, a fait bon marché de toutes les élégances en même temps que son domaine s’étiolait. Sous le complet blanc qui le rattache à son cadet, il porte un tee-shirt blanc, et le costume prend des allures honteuses de pyjama. C’est le vêtement d’un homme épuisé qui lorgne le sommeil d’Hamlet. Sous l’effet du temps et de la ruine, l’ambition qui les animait a identiquement décru, elle a vécu sans progresser, elle a enduré sans s épanouir.
Au thème de boîte à musique qui cantonne implicitement la population de PLATONOV au jardin d’enfant (un jardin bien vénéneux) succède, dans IVANOV, un thème pianistique plus grave, plus mélancolique, qui chante les déceptions de la maturité. Dans PLATONOV encore, l’adaptation métronomique du texte condense tout le drame de Platonov sous les espèces d’une journée explosive, d’un infernal et clownesque compte à rebours, tandis que la temporalité naturaliste d’Ivanov est strictement respectée. Dans PLATONOV enfin, le jeu saccadé des rideaux démontre la dérive de personnages condamnés à vivre l’instant, tire certaines scènes vers le burlesque, alors qu’avec IVANOV, le jeu des rideaux épouse plus strictement la division en actes, et toute la partition calculée d’une descente aux enfers.
Les péchés des jeunes hommes au dents agacées se continuent en ceux des vieillards Aucune échappatoire, aucune transcendance, aucune fuite, dans cet univers qui dit aussi bien le blocage de toute une société que les menaces d’un cosmos spirituellement vide.
Pour dire cet univers, le spectacle joue magnifiquement de la combinaison ou de l’alternance des formes géométriques simples. Entre le carré et le cercle, la dramaturgie dessine tous les plans du réel, des plans cosmiques les plus subtils aux cercles mondains les plus étriqués.
Grande sonate, de PLATONOV à IVANOV, des cercles de lumière dont le jeu des couleurs primaires renforce le caractère implacable : cercle jaune de la maison des Lebedev où s’échangent les banalités et les calomnies d’une société figée, cercle rouge des désespérés honteux où Triletzki improvise en compagnie des « zoulous » et autres ratés, une grotesque et obscène parodie d’Hamilet, cercle bleu enfin de la planète entière, du macrocosme de l’univers qui vient comme s’imprimer sur le corps d’Ivanov et le marquer d’un fardeau symbolique. Tel Atlas, Ivanov est terriblement bâté des maux de son temps. Cercle blanc enfin, de fleurs, celles qu’Ossip sème autour du corps de Platonov, comme pour dessiner la lice de sa future victime, inscrire en pointillés (en confetti) le jugement de Dieu. Mais pour un rituel païen, un meurtre druidique dont le couteau n’est qu’accidentellement suspendu.
Symphonie des rectangles et carrés, de bois ou de lumière : dans la première partie de PLATONOV, l’espace connaît son explosion combinatoire à partir de ce paradigme central, la toute petite table rectangulaire où Anna Petrovna et Triletski poursuivent leur sempiternelle partie d’échecs, illusoires souverains ou régulateurs d’un univers promis à une prochaine déflagration. Le jardin des aveux et des désirs, où les couples se forment, se déforment et se reforment, ne sera qu’une maigre bande rectangulaire de lumière projetée jusqu’au devant de la rampe. Mais à la fin de la première partie, à ce moment que l’adaptation du metteur en scène et d’Olivier Cadiot élit comme le minuit de la crise (le texte adopte alors la typographie synoptique d’un poème), les plans et les découpes connaissent une efflorescence démente, se démultiplient, telles des bandes brechtiennes pour distancer cette frénésie, mais pour mimer aussi la polyphonie des volontés et des désirs. Seule, sur cette douloureuse juxtaposition d’angles droits, Anna Petrovna tranche, danse, elle, en rond, et sculpte le trajet plus harmonieux, plus arrondi d’un vrai désir — celui pou Platonov. Trajet « positif » — en négatif de la pièce — de ce personnage, qui ne triche pas, qui a de vrais désirs à exprimer, à revendiquer, et donc connaîtra de vraies souffrances … Au début d’IVANOY, le jardin a en quelque sorte intégré cette pluralité des espaces géométriques, et, avec la juxtaposition impitoyable des découpes, offre une appréhension en puzzle des compartiments de jeu, que rompent encore quelques chaises égarées, et que chapeaute, tel un judas ou un diaphragme photographique menaçant — celui de la mort — la fenêtre d’Anna Pétrovna.
Ivanov circule là avec parcimonie, maître pratiquement immobile, Hamlet bien sûr, « Seigneur latent qui ne peut devenir ».
La prégnance de cette géométrie lumineuse tend à éjecter la conscience de son, de ses systèmes, de son nid doré d’inertie et de complaisance. Platonov et Ivanov souffrent tous deux d’un tropisme vers la voie lactée qui les rend inadéquats à l’espace social.
Au fur et à mesure que l’intrigue progresse et que Platonov se compromet dans des promesses aux femmes et des départs avortés, c’est une sorte de syndrome « agoraphile » qui le frappe. Perdu au milieu d’un plateau insoutenable de nudité, il chante et célèbre sa déréliction, Pascal désespéré et jubilatoire, il est chez lui dans le grand vide de la nuit, mais il y est aussi en voie de dissolution.
Ivanov, grand propriétaire terrien qui a tenté de mener les hommes et de faire vivre une communauté, se trouve rejeté de tout espace défini, c’est un électron, non point libre mais errant autour d’un noyau perdu. Il est en gravitation forcée autour de coteries mondaines insignifiantes. Chez lui, Ivanov ne peut occuper que le rectangle de son bureau, tréteau improvisé qui résume aussi son ultime refuge face au monde, cabinet d’architecte qui ne bâtit plus, caverne de philosophe qui ne médite plus. Lorsque Anna prend d’assaut cette planche de salut, Ivanov n’a en quelque sorte plus le choix. Poussé à la cour de ce petit plateau par les insultes de son épouse, il n’a d’autre issue que de la mettre à mort, ou de mourir lui-même. Cette géniale trouvaille scénique d’un Ivanov poussé au bord du gouffre par une femme qu’il a certes fait souffrir mais ne veut pas détruire, ouvre, sans rendre de verdict, le procès d’un meurtrier en situation, d’un meurtrier des circonstances (atténuantes ?). Ivanov tue Anna par des mots qui sont des armes implacables, mais [vanov la tue parce que, sinon, il tomberait dans un abîme, haut de moins d’un mètre mais riche symboliquement de tous les abîmes contemporains. Après le troisième acte, le bureau et le fauteuil d’Ivanov, derniers vestiges d’une sagesse décidément bien compromise, seront emportés par le tourbillon du temps, effacés par la gomme magique des rideaux.
Peut-on reprocher à Ivanov de choisir sa vie plutôt que celle de l’autre et faut-il dédouaner Platonov de sa cruauté parce qu’il est malade de lui-même ? Questions que le spectacle force à demeurer questions.
Nul refuge en l’intimité de la tour d’ivoire, mais nulle rédemption ou havre de paix chez les hommes. Certes le cercle mondain ment en disant qu’il est le monde. Lors de la soirée d’anniversaire de Sacha, Ivanov tourne, tel un satellite exténué, autour du cercle mondain où Sacha tente de faire son apologie. Ivanov est toujours pieds nus, Ivanov est un va nu pieds métaphysique dont la course ne peut s arrêter nulle part. Il ne mettra chaussures à son pied que pour se marier, et le cuir, tel un voile de Médée, le fera mourir, d’une mort sans pathos, d’une mort qui ne résout rien, et dont la mise en scène désigne, avec une étonnante audace la dimension aporétique, expédiant le suicide d’Ivanov en deux temps trois mouvements.
La révolution du temps ne s’arrête jamais, ni celle que règle (ou dérègle) le cours des astres, ni celle que reflète l’histoire torturée des hommes.
Et pourtant, comme dit Ludovic Lagarde « s’il fallait réunir ces deux pièces autour d’un thème, ce serait celui de la conscience », la conscience certes torturée et fantomatique des deux héros, mais aussi celle, embrumée et contradictoire du spectateur dont les fils se renouent au spectacle pour un questionnement éthique surprenant d’acuité.
Responsables, mais pas coupables dit l’humanisme qui péniblement se survit. Ivanov et Platonov passent leur temps à interroger conjointement leur responsabilité et leur culpabilité. Tandis que les fantômes tragiques (tels ceux d’Hamlet) passent vainement dans cet univers où l’homme est laissé à lui-même, avec le poids individualisé de ses fautes, Ivanov et Plartonov touchent d’un doigt cruel leur propre abjection en même temps qu’ils en expriment obstinément le déni, mais ce visage de Janus n’est-il pas le masque ordinaire de l’homme contemporain ?
Dans cet univers, victimes supposées et assassins désignés se dévisagent finalement avec la perplexité de leurs ressemblances, le bouleversement de leur gémellité secrète. Platonov est un monstre, certes, manière de monstre, qui à « la maladie de Platonov ». Ossip, réprouvé social, apparaît évidemment comme un ange exterminateur à la fois vertueux et épouvantable. En un monologue surprenant, tramé par l’adaptation, Ossip, immobilisé entre deux rideaux mouvants, prie devant l’autel improvisé d’une ampoule nue, et débite un chapelet d’insultes dont on ne sait s’1l se les adresse ou les débite à un autre (c’est le cas dans le texte original). Évoque-t-il un « gros porc » pour s’insulter lui-même, et adopter, avec une certaine dérision, ou en une posture toute de gloire négative, à la Genet, le point de vue de sa société qui le traite comme un paria, ou s’adresse-t-il de loin à Platonov qu’il projette d’égorger comme un animal sacrificiel ? Confusion, voulue par la mise en scène, de la victime et du bourreau. Subtil jeu de miroir du criminel social au criminel métaphysique, le mal et sa punition agissent selon deux corps semblables, circulent entre deux volontés inquiétantes de réversibilité.
Il est à la fois banal et troublant pour le spectateur de se reconnaître en cette faune torturée et torturante, à l’intersection de deux fins de siècle, et avec cet aiguisement à froid de l’introspection qu’eut aimé Tchékhov. Justesse du rapport au public qui réussit l’équilibre d’une narration échevelée de comédie et d’un brechtisme virtuose (car l’une des grandes vertus dramatiques édictées par Brecht n’est-elle pas la « légèreté » ?).
Témoin privilégié peut-être, de cette relation à la fois consubstantielle et surplombée de l’hier à l’aujourd’hui : la rampe. Cette rampe qui participe hautement de notre mémoire du théâtre stanislavkien, mais qui, posée sur la scène comme un accessoire, n est qu’une épave plaisante, un vestige dans la mouvance des rideaux et les éclairages aux sources démultipliées. Débris d’astre de l’histoire du théâtre et de l’histoire tout court qui flotte devant nous, s’éclaire ou s’obscurcit. Pour le quatrième acte, Ludovic Lagarde pratique parallèlement à la rampe une coupe longitudinale, il divise rigoureusement la scène en face et lointain par le rideau même qui, traversant magnifiquement (le rideau n’est-il pas le plus magistral acteur qui soit ? ) le plateau entre l’acte trois et l’acte quatre, mime la mort d’Anna et son assomption de fantôme. Oui Anna est morte, et cette mort coupe en deux la scène, divise la conscience des personnages, dont l’hésitation angoissée reflétera l’éternité des fantômes. Pétrine le sage, s’inscrivant centre plateau, tente inutilement de faire la jonction entre le lointain dérobé de la cérémonie nuptiale et l’avant-scène des déchirements. Sacha y figure dans une robe de mariée qui la fait régresser à l’état d’enfant gatée, (elle qui pourtant, lors de son anniversaire, paraissait dans une robe simple et refusait le rituel social ).
Quand, avec une conviction un peu absente, la noce passe au lointain par le rideau qui s’ouvre, et qu’Ivanov entre enfin, par effraction, dans l’univers mondain (à quoi renvoie le salon Lebedev réutilisé pour la circonstance), c’est la trappe de la mort qui se referme sur lui. Le metteur en scène retourne les projecteurs dans les yeux du public, pour une scène qui ne se Joue que par acquis de conscience tragique, en quelque sorte, pour rien, avec un résultat dramatique hautement prévisible.
Même absence de lyrisme d’ailleurs, même élimination froide, quasi kafkaïenne de Platonov, par un étonnant jeu de scène. Le revolver dont Platonov, jouant avec l’idée de sa propre mort, se débarrasse entre les mains d’une Grekova plus que jamais naïvement compatissante, passe de main en main, effectue tout le circuit sacrificiel d’acteur en acteur jusqu’à atterrir dans la main de Sonia qui presse la détente. C’est un meurtre qui tient de l’accident et du « lapsus gestus », mais c’est la conjuration silencieuse de toute une société dont Platonov est désigné comme l’appendice malade et la victime expiatoire. Platonov cruel avec un ludisme désespéré, l’Ivanov nuisible sans jamais le souhaiter délibérément, sont aussi pleinement coupables que boucs émissaires de leur communauté, et ne faut-il pas redire que la position éthique que régit le théâtre se situe ailleurs qu’en toutes les dichotomies et manichéismes possibles ?
La mort du héros, des héros, au caractère axiomatique, dont c’est plutôt les implications que nous devrions méditer, au-delà de la littéralité idolitre (Sacha contemple une icône — une idole ? — avant de prendre une mauvaise décision, le théâtre est offre de l’icône et refus de l’icône ) d’un suicide et d’un corps mort. Nous aussi, nous avons voulu la mort d’Ivanov, nous attendions aussi abjectement que Lvov l’élimination du monstre. Mais le théâtre ne nous donne des morts de théâtre que pour nous forcer à une vision plus rigoureuse : celle de l’irréconciliation. Devant les corps sans vie de Platonov et d’Ivanov, les conjurés semblent aussi démunis, aussi perplexes que devraient l’être ceux qu’ils reflètent de l’autre côté de la rampe.
L’assassinat complaisant des femmes et la torture psychologique entre les êtres remontent aux crimes les plus énormes du vingtième siècle, à l’ébranlement qu’ils inaugurent de toute conscience éthique possible. C’est avec le trouble de notre culpabilité propre que Ludovic Lagarde nous invite à contempler ces deux cadavres (abandonnés à moitié dans notre camp de spectateurs) avec notre conscience éthique inhibée, ni révoltée, ni désinvolte, d’«une fin de siècle où il ne semble pas y avoir de coupables, où il reste à chaque homme une partie de la faute commune, mauvaise conscience de générations entières. »