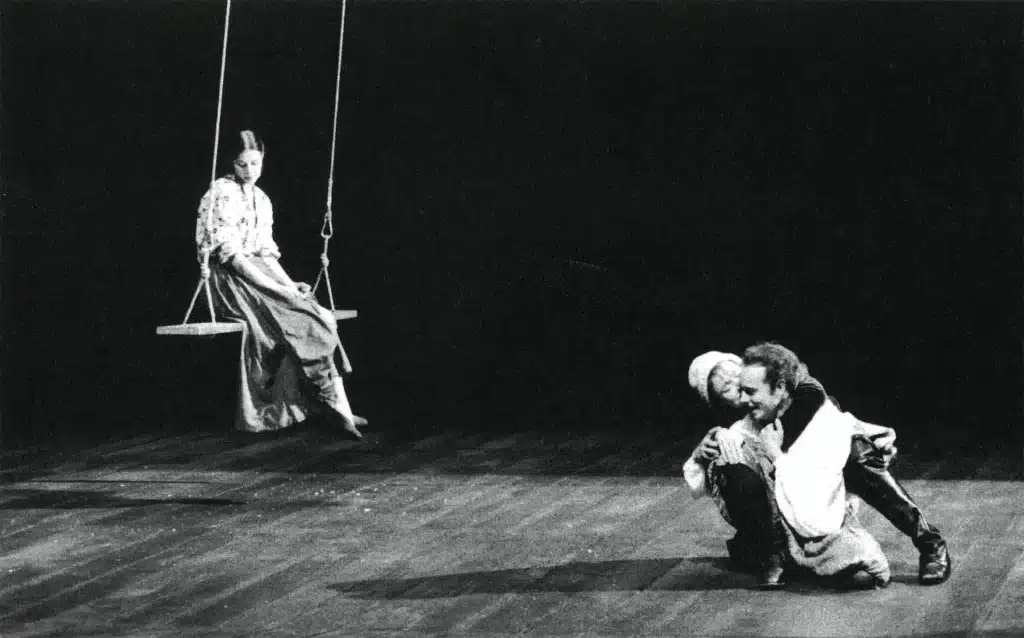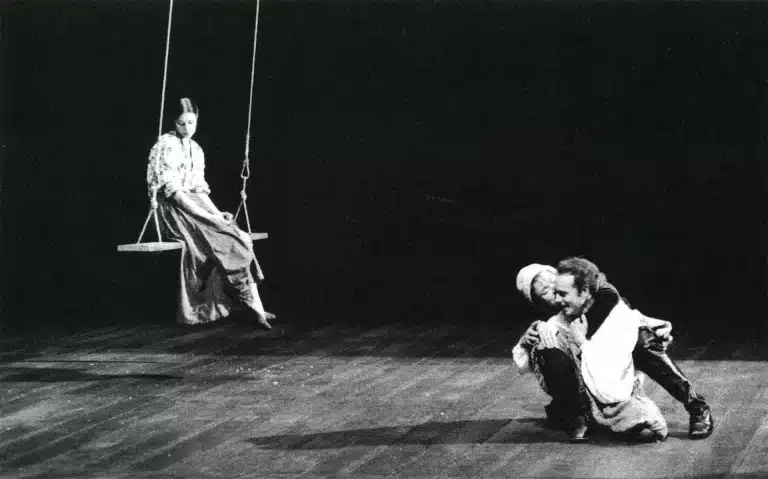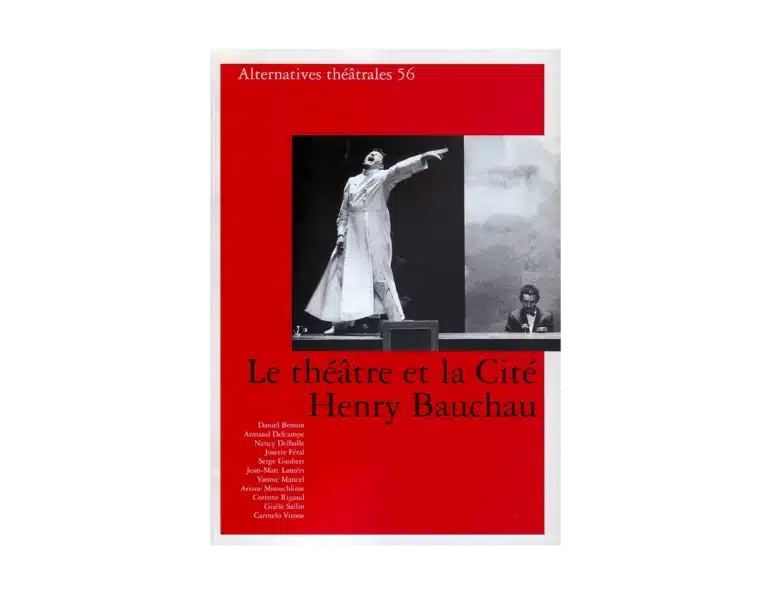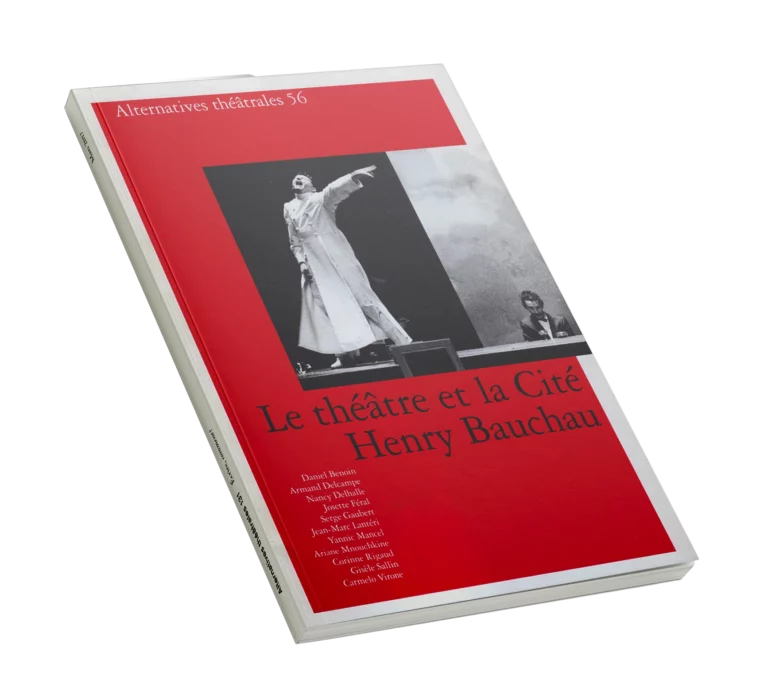DEPUIS QUELQUE TEMPS, — faut-il remonter au début des années 80 ? —, les idées de répertoire et de ligne artistique semblent conjointement reléguées au rang de vieilleries archaïques, passées de mode et frappées des pires suspicions. Or si la notion de ligne artistique connaît aujourd’hui une telle désaffection, c’est probablement qu’elle connote celle de ligne idéologique et politique, elle-même renvoyant à l’histoire du mouvement ouvrier, des partis communistes, des groupes intellectuels les plus engagés du siècle, avec leurs revues, leurs manifestes, leurs dissidences et leurs exclusions. Ainsi, l’effacement d’une ligne artistique identifiable à la direction des théâtres et des établissements culturels correspondrait-il à ce qu’on appelle depuis les années 80 la « crise des idéologies » et la « défaite de la pensée ». Dans un tel contexte, l’exigence artistique, comme toute idée d’appartenance à un courant ou une école, semble être devenue une maladie honteuse, au même titre que le marxisme et la pensée matérialiste. La peur d’être identifié et de devoir se justifier pour ou contre telle option philosophique ou artistique rejoint ici l’un des grands fléaux, l’une des grandes menaces idéologiques de notre millénaire finissant : le consensus, cet allié mou et contagieux de la pensée unique. Ainsi voit-on apparaître sans vergogne, dans ces morceaux d’anthologie que sont les éditoriaux des brochures de saison, ceux-là mêmes qu’Olivier Py et Jean-Damien Barbin ont épinglés dans leur spectacle APOLOGÉTIQUE, un usage inédit, élogieux et mélioratif, de la notion d’éclectisme, autrefois combattue, dans les années 60 et 70, comme l’une des catégories les plus négatives de la pensée bourgeoise. Et il faut bien constater que les affiches des saisons théâtrales, depuis une quinzaine d’années, surtout dan les lieux qui ne sont pas dirigés par des artistes-metteurs en scène à la personnalité forte et courageuse, semblent obéir à d’énigmatiques dosages, oscillant entre les équilibres les plus subtils et le n’importe quoi le plus aléatoire, toujours soumis, de toute façon, à l’anticipation des goûts du public et des effets de mode. La saison théâtrale ainsi conçue, semblable au panier de la ménagère, saura répondre aux lois du marché ainsi qu’à une logique supposée des besoins : un peu de tout, de tout un peu. Tempérance et modération, si l’on en croit les mots prêtés par Ibsen au petit imprimeur provincial d’UN ENNEMI DU PEUPLE, ne sont-elles pas les valeurs canoniques de la frilosité petite-bourgeoise ? Et si perte des repères il y a, du moins si l’on en croit le discours incantatoire ambiant, ne faut-il pas précisément en attribuer la responsabilité à cet éparpillement, à cet éclectisme consensuel, à ce triomphe démagogique du « tout vaut tout » si précocement identifié, au début des années 80, par le philosophe Alain Finkielkraut dans son très prémonitoire essai sur LA DÉFAITE DE LA PENSÉE ?
Le jeu des choix et des refus
Et pourtant, les grandes aventures de ce siècle en témoignent, du Théâtre d’Art de Moscou au TNP en passant par le Cartel ou le Berliner Ensemble, voire certaines expériences plus modestes et beaucoup moins prestigieuses, l’art théâtral a besoin, pour exister de façon significative, d’une identité forte et repérable. Certes, on le sait depuis les initiatives de Jacques Copeau et son éphémère expérience du Vieux Colombier, la fidélisation d’un public, pour la première fois affirmée comme nécessaire à la vie d’un théâtre, passe par des techniques de relations publiques bien connues qui vont de l’information à l’abonnement en passant par la qualité de l’accueil et les avantages tarifaires. Mais il est impossible, dans le projet de Copeau comme plus tard dans celui de Vilar, de réduire ce souci de capter l’assiduité du spectateur à une préoccupation exclusivement gestionnaire. L’ambition de fidéliser le regard répond aussi (et peut-être surtout) à un objectif « militant », toujours présent dans les grandes aventures théâtrales de ce siècle, celui de la formation du spectateur, de l’éducation de son sens critique et de l’élargissement de son champ de vision. L’amateur d’art, se plaisait à dire André Malraux, comme en écho aux propos de Copeau, se définit avant tout par le jeu des comparaisons, c’est-à-dire par l’identification — intuitive ou théorisée, d’une œuvre à l’autre — du jeu de la permanence et de la variation. Puisque ceci vaut pour les arts plastiques, d’un tableau l’autre, mais aussi pour la musique, d’un concerto l’autre, et la littérature, d’un poème ou d’un roman l’autre, pourquoi cette pratique comparative ne vaudrait-elle pas également pour l’œuvre dramatique et sa représentation ? Il n’y a pas plus de vérité ontologique de la représentation théâtrale qu’il n’y en a des autres œuvres d’art, L’œuvre est un élément qui n’existe que par sa relation à l’autre, au tout. Son évaluation, sensible, intellectuelle, est, de ce point de vue, éminemment structurale : élément qui ne se définit que dans sa relation identitaire et différentielle — autrement dit : comparative — aux autres éléments du même ensemble. À partir de là se définiront, par assimilation et regroupement, les styles, les genres, les écoles, les familles artistiques et esthétiques … L’abonnement apparaît donc à Copeau, à Vilar et aux autres pionniers d’un théâtre d’art « pour tous », comme une (douce) contrainte ouvrant au spectateur, par le jeu de sa mémoire et la mise en perspective de ses souvenirs récents ou lointains, la possibilité d’évaluer l’instant présent, l’éphémère de la représentation en cours. Abandonnant librement son imaginaire et sa conscience critique à des associations d’idées, d’images, ou d’impressions intuitives (de contraste ou de déjà vu), il se construira un système référentiel d’oppositions et de filiations qui s’enrichira au fil de sa pratique de spectateur et enrichira son acuité de regard, voire sa capacité de jouissance à la perception de chaque nouveau spectacle.
La programmation, dès lors, relève d’une tout autre responsabilité. Elle participe désormais d’une mission de formation du spectateur et doit procéder à des choix toujours écartelés entre le souci d’ouverture et l’affirmation de préférences. Programmer, disait Jacques Lassalle dans l’un de ses éditoriaux du TNS, c’est se livrer au jeu (cruel mais assumé) des choix et des refus. Les mots sont forts. Ils ont le mérite d’autoriser des audaces artistiques auxquelles doit répondre, en écho, le courage d’un discours théorique fort et argumenté. Ailleurs, le même Jacques Lassalle affirmait également que programmer, c’est poursuivre le travail de création sous une autre forme. Il serait souhaitable que les tutelles politiques méditent longuement cette réflexion, elles qui, un peu partout ces temps-ci, sont plus que jamais tentées par l’abandon des centres dramatiques aux gestionnaires consensuels et autres technocrates de la programmation éclectique. Faut-il leur rappeler que les grandes aventures artistiques du siècle, celles sur lesquelles on peut mettre un nom, furent précisément initiées par des personnalités fortes et courageuses qui surent imposer leurs choix les plus singuliers et les plus aigus, au prix parfois d’amers affrontements et d’âpres polémiques ?
Prenons encore l’exemple de Copeau : dès le fameux Appel placardé sur les murs de Paris à l’automne 1913, précédé par la publication dans la NRF en septembre du non moins célèbre « essai de rénovation dramatique », la notion de répertoire était placée en exergue, quelle qu’en fût l’outrecuidance dans un contexte très figé où son emploi était jusqu’alors réservé aux théâtres officiels (Comédie-Française et Odéon) et aux quelques rares tentatives artistiques ayant fait leur preuve à la fin du siècle passé (Théâtre-Libre et Théâtre de l’Œuvre).…. Et c’est bien en présomptueuse rivalité avec la ComédieFrançaise que Copeau s’appropriait cette notion de répertoire. Il allait le prouver très vite, dès la première saison, en inscrivant à son programme non seulement les jeunes auteurs de la NREF, mais aussi des traductions fidèles et quasi intégrales, ni édulcorées ni expurgées, d’œuvres élisabéthaines, et surtout les farces de Molière, très discréditées depuis le terrible verdict de Boileau, et qu’il eut l’audace et la bonne idée de réhabiliter auprès d’un « public lettré » jusque-là plutôt méprisant.
L’audace artistique, et notamment l’audace de répertoire, permet seule que le théâtre demeure un lieu de débat, de confrontation, où chaque spectateur, dans une relation de confiance et d’estime réciproque toujours renouvelée, se définit pour ou contre telle option artistique repérable, invité qu’il est à prendre parti et si possible avec passion. La pire des choses au théâtre, n’est-elle pas cette « bonne soirée », c’est-à-dire, pour plagier Musset, cette soirée perdue, dans la fausse harmonie divertissante d’un rassemblement hétéroclite ? Non seulement le théâtre et ses artistes ne peuvent faire l’économie du sens ni de la forme, mais ils ne peuvent pas non plus les traiter par le juste milieu n1 par leur plus petit commun dénominateur, le plus politiquement correct ou le moins dérangeant.
Une cohérence subjective
Cette cohérence globale du sens et de la forme, qu’André Antoine, à la charnière du siècle, revendiquait à l’échelle de la représentation théâtrale, avec ses options, ses partis-pris esthétiques et idéologiques, il convient donc aussi de l’étendre à l’ensemble de la programmation d’un théâtre. Il faut, autrement dit, que le metteur en scène qui en a la charge, tout en ouvrant son regard et celui de son public à des spectacles de référence étrangers à sa propre esthétique, assume néanmoins avec la plus grande netteté et la plus grande radicalité permises une programmation au plus près de ses goûts, de ses convictions, de sa personnalité.