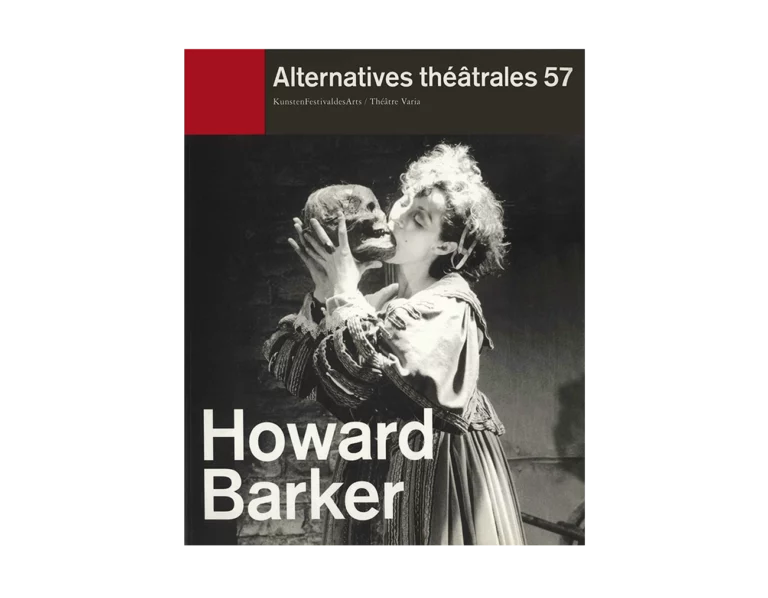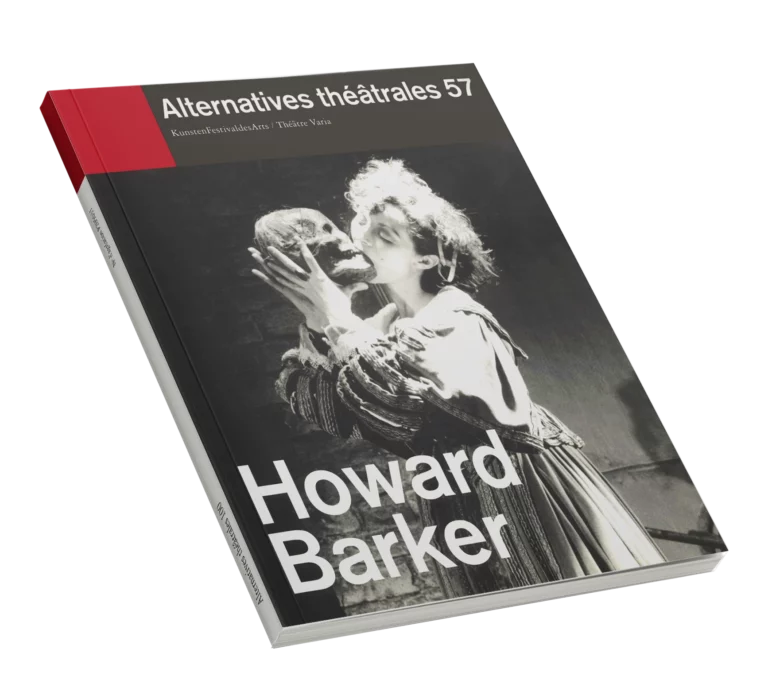L’art amène le chaos dans l’ordre
L’acteur doit détruire
L’auteur doit démolir
Toutes les notions précédemment admises de la représentation
Toutes les notions précédemment admises de la réalité
(N’EXAGÉREZ PAS)
LE RECUEIL D’ESSAIS d’épigrammes et de spéculations intitulé Arguments pour un Théâtre peut également être considéré comme des arguments contre un théâtre, ou contre une situation où l’on nous présente le théâtre que les critiques et le management théâtral ont envie de voir, et que, selon eux, le public mérite.
ARGUMENTS FOR A THEATRE fut le premier livre d’études théâtrales britanniques qui chercha à identifier et à dépasser les clichés concernant le théâtre contemporain depuis l’ouvrage polémique A GOOD NIGHT OUT de John McGrath en 1981. Le livre de McGrath était stimulant au sens où il critiquait le cercle fermé des structures théâtrales britanniques dans les années 1970, et mettait le doigt sur le danger de l’auteur-interprète imprévisible. Cependant McGrath ramenait la force potentielle de cet interprète à un théâtre timoré à vocation populaire, pour qui populaire voulait dire : « intelligible par le grand public, en adoptant et en enrichissant ses formes d’expression, en assumant son point de vue, le confirmant et le corrigeant ». Son appel à un théâtre qui célèbre le peuple rappelle la réaction de Léopold dans LES EUROPÉENS de Barker : « Vous-mêmes ? Qu’y-a-t-il à célébrer en vous ? Le fait que vous soyez en vie et pas un truc puant entre les pins ? Eh bien, vas célébrer cela, mais ne nous demande pas de te rejoindre. »
L’incitation autoritaire à célébrer persista durant les années suivantes. En fin de compte l’art de la célébration est une insulte à l’égard de l’intelligence et de l’imagination, parce qu’en des termes populaires et populistes il célèbre le déjà connu : puisque fondé sur la réitération des avis partagés. Ce théâtre est essentiellement conservateur, évitant l’exploration qu’occasionnerait la découverte de nouvelles possibilités.
Dans ce climat culturel Barker s’opposait au théâtre populaire avec son objectif sciemment provocateur de faire un théâtre élitiste. Sciemment provocateur car, comme Barker rétorque dans son essai L’ÉLITISME RADICAL AU THÉÂTRE : « il n’y a rien d’élitiste dans l’imagination, même si peu d’entre nous sont habilités à l’exercer professionnellement. »
Dans ARGUMENTS FOR A THEATRE, les propos de Barker sont assemblés chronologiquement, et pour cette raison ils démontrent les contradictions et développements essentiels d’une imagination agitée.
La foi en la tragédie qui caractérise les épigrammes des 49 APARTÉS est affinée au fil du recueil par une identification du catastrophisme : c’est le terme de Barker pour une forme moderne de tragédie, qui dépeint le rejet des valeurs jugées fondamentales par la société, refusant en
outre de s’impliquer dans la restitution de l’ordre moral. Les protagonistes de telles pièces sont souvent charismatiques, puisqu’ils rompent avec la routine quotidienne pour entrer dans le domaine de l’extraordinaire. En dépit de cela, la douleur subie à cause de leurs efforts n’invite pas à l’imitation, et leurs
mauvaises actions les écartent du statut héroïque conventionnel. « Dans le courage de l’acteur, le public puise son propre courage », a déclaré Barker.
L’esthétique théâtrale de Barker accorde une position centrale à l’acteur, capable à la fois de découvrir et de démontrer une liberté étrange.
Ainsi le spectateur qui venait passer « un bon moment » se sera sans doute offert « un cadeau de mélancolie » à la place, et trouvera ceci « déroutant mais pas déplaisant », en découvrant le triomphe existentiel d’une sauvagerie individualiste, qui sépare inévitablement et isolerait éventuellement l’explorateur de ceux qui voudront épouser le familier, et donc le
familial. Le pire des mensonges est sentimental : « Nous sommes des frères par exemple
Sommes-nous des frères ou pas
Sommes-nous
DES FRÈRES »
(N’EXAGÉREZ PAS)
La sentimentalité est une appréhension du
comportement émotionnel de l’Autre qui insiste sur la similitude, une sollicitation au partage. Ceci est l’antithèse du « droit de l’individu à vivre le chaos, l’extrémisme et la description de soi » : pour Barker, i
n’est pas nécessaire que l’expressions oit toujours ramenée à la communication. L’élément compulsif, l’impulsion de puissance irrationnelle, peut également être irrésistible.
Obligeant à prendre rapidement position, cet élément provoque alors une victoire insoupçonnée.
Le chaos que Barker appelle est opposé à l’insécurité craintive qui pulse sous la détermination de Mario Vargas Llosa quand il dit que l’art devrait tirer le passé du chaos, afin de procurer de l’ordre pour soulager la vie de sa « complexité et imprévisibilité ahurissantes ». La vision
du chaos comme anathème rapproche Llosa de
l’esthétique théâtrale néo-tchéckhovienne dominante et de sa description coercitive de l’entropie : le concept thermodynamique utilisé sous forme littéraire comme motif d’insécurité linguistique, de l’effondrement pressenti de la dynamique, de l’atrophie spirituelle, de la diminution de l’énergie et de la désintégration morale.
Cependant, depuis la fin des années 1980, le traité scientifique a dû combattre un nouvel argument ; la tendance ultime d’entropie — avec tout le consentement fataliste et nauséabond qu’il implique — est défiée par une redéfinition du chaos comme système de variations complexes, il détient une énergie apériodique qui est la source de régénération vitale. Afin de développer une analogie avec l’esthétique théâtrale, disons qu’un théâtre du chaos encourage les diminutions de l’ordre et proclame que le public au théâtre comme les êtres vivants dans l’univers possèdent le don de l’éclosion de la vie.
Artaud était d’avis que le théâtre est un endroit pour découvrir ce qu’il y a de plus « exceptionnel » et « vulnérable » en soi, et donc pas forcément ce qu’il y a de meilleur. Pourtant les artistes dramatiques qui s’expriment librement ont de plus en plus été accusés, ils offensaient les valeurs populistes de la productivité de consommation. Le danger et la promesse de chaos impliquent le refus de gentillesse, tandis que le théâtre britannique néo-tchékhovien préfère chercher du réconfort dans l’expiation, repérer la maturité dans la retenue, et est donc complice d’avoir ramené le théâtre à l’ordre.
L’auteur Eugenio Barba, comme Barker, apporte un contraste en considérant que le théâtre « entremêle une solitude avec une autre », en explorant le détachement
du corps et du pouvoir. Ce théâtre peut devenir une nécessité pour une certaine catégorie de spectateurs et de comédiens, ceux qui prônent comme Barba « une relation qui n’établit pas d’union, qui ne crée pas de communion, mais qui ritualise l’étrangeté réciproque et la lacération du corps social dissimulé sous la peau uniforme de mythes et de valeurs morts ».
Ce théâtre aspire donc à l’asociabilité, une relation expressive qui ne renonce pas aux différences d’expérience individuelle, de perception, de connaissance et de besoins.