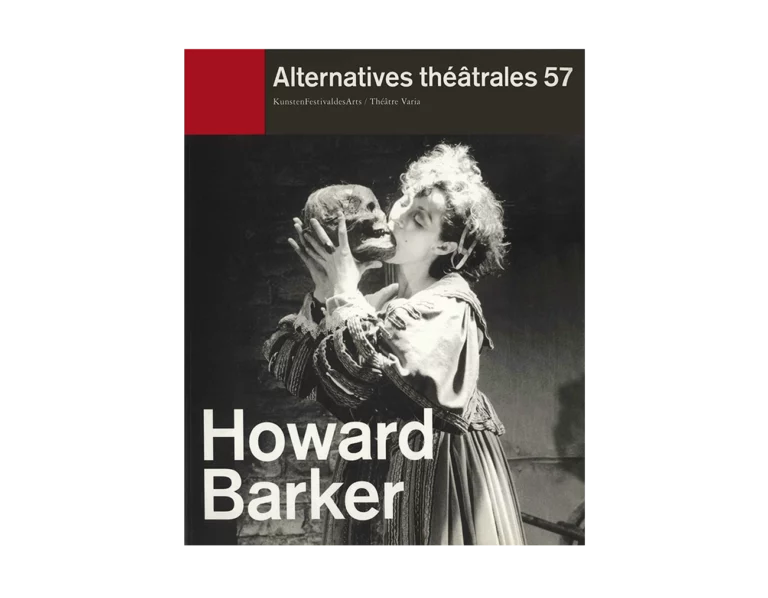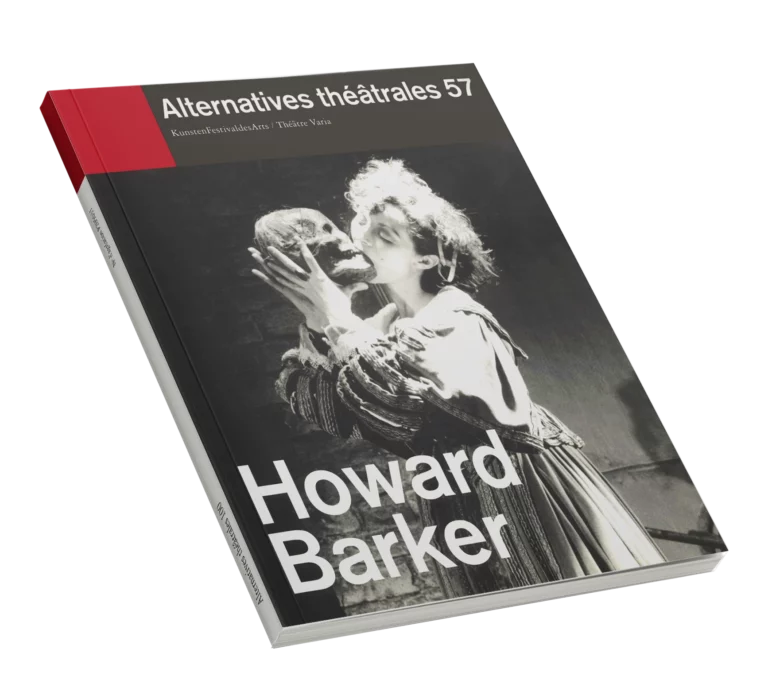QUAND IL OUVRE la fenêtre, Howard Barker entend la mer. Chez lui à Brighton, « la ville la plus décadente d’Angleterre », selon ses propres dires, il élabore son œuvre, loin des combats intellectuels de la capitale, où il n’arrive que ponctuellement, pour semer le trouble. Trop classique pour l’avant-garde, trop avant Gardiste pour le théâtre établi, sa force réside dans le fait qu’il se suffit à lui-même. Comment tiendrait-il le coup autrement, cet auteur d’un demi-siècle, dans sa lutte féroce contre la dictature d’une culture qui se veut à tout prix accessible, si ce n’est par l’humilité d’une activité quotidienne solitaire, celle- là même qu’il décrit dans les JOURNAUX INTIME DE TURTMANN : « Ce qui dérive ici sur les marées est mon tribut / La dîme des hommes heureux et prolifiques / Leurs cageots jetés contiennent des légendes / Que je dispose au hasard sur le rivage / Les décomposant comme une communication gui n’est pas / Plus arbitraire que la parole. »
Aujourd’hui Howard Barker est un culte. Quel autre écrivain de théâtre contemporain a une compagnie qui monte exclusivement son travail, comme la Wrestling School (L’École de Lutte) le fait avec l’œuvre de Barker ? Il nous suffit de rentrer dans une librairie théâtrale à Londres pour découvrir de quoi remplir l’étagère entière d’une bibliothèque ; il y a du pain sur les planches pour les gens de théâtre dans les années à venir. Ce classique contemporain défie la pauvreté linguistique de l’écriture théâtrale contemporaine qui résulte de l’influence néfaste de l’ère télévisuelle, et tient tête à Artaud avec ses théories sur le théâtre. Extrémiste, Howard Barker incarne dans ses pièces l’aristocratie avec la même aisance que la mendicité. Sans transition, on passe d’une canonnade de jurons à un envol poétique, pour ensuite atterrir dans un langage quotidien chargé d’ironie.
L’auteur déstabilise par son dosage savant d’animalité directement surgie de l’inconscient, sa clairvoyance réflexive, un point de vue historique moderne, et son appartenance au clan shakespearien, et ce « en des temps où le sophisme préféré de l’industrie du divertissement est de prétendre que les foules déprimées ont soif de chansons et d’oubli », dixit Barker.
Lors d’une conférence à Orléans intitulée « Le théâtre, ultime scène du dialogue », j’annonçai avec passion le projet de traduire LES EUROPÉENS de Barker pour la compagnie Utopia dans le cadre du Kunsten Festival des Arts. Les représentants d’importantes institutions culturelles britanniques ont aussitôt baissé les yeux. Une terrible gêne se dégageait de leur mutisme.
Le dialogue était définitivement rompu. Plus tard j’ai compris que Barker était vraiment comme son nom l’indique en anglais, un « aboyeur » qui crie à la porte des théâtres, invective les dogmes dolents d’un peuple sur cultivé. Et il ne remet pas simplement en question notre attitude envers le théâtre ; la force de Barker réside dans sa capacité à dissoudre le tissu moral et émotionnel implanté dans nos cerveaux par notre éducation trop souvent similaire. L’abolition des distinctions habituelles ébranle les fondements de nos pensées et provoque ainsi des flashes de lucidité. On finit alors par se demander si, par exemple, la liberté et la bonté sont compatibles, ou si la pitié n’est pas à la fois un poison et un sentiment érotique. Barker décrit son Théâtre de la Catastrophe de la façon suivante : « Le sujet habituel du théâtre contemporain est la façon dont nous vivons les uns avec les autres à partir de prédicats moraux donnés. ( … ) Mais il y a maintenant un problème avec les prédicats eux-mêmes. Ce nouveau théâtre, plus aventureux, plus courageux, demande au public d’éprouver la validité des catégories qui régissent sa vie. En d’autres termes, son propos n’est pas du tout la vie comme elle est vécue, mais la vie comme elle pourrait être vécue ; il s’agit encore de la pensée qui n’est pas autorisée, et de l’inconscient qui a été aboli. »
Sa pièce LES EUROPÉENS, pour parler de ce que je connais le mieux, est une pièce pleine de ruptures de sens, son dialogue une géographie du fonctionnement du cerveau humain on ne peut plus subtile. Howard Barker y exploite le sens littéral des mots, leur sonorité, et comme dans la peinture, il explore le contraste des couleurs sans perdre de vue l’architecture globale de la pièce. La forme classique fait surgir davantage le fond subversif. La grisaille met en relief les traits rouges vifs d’un engagement d’artiste, comme l’apparition soudaine du soleil entre les averses en Angleterre. Un des personnages nommé Starhemberg y déclare : « Ce dont j’ai besoin. Et ce qui aura lieu d’être. J’ai besoin d’un art qui rappellerait la douleur. L’arc gui sera, sera toutes fioritures et festivités. J’ai besoin d’un art qui tomberait à pic à travers le plancher de la conscience pour libérer le soi pas encore né. L’art qui sera, sera extravagant et éblouissant. J’ai besoin d’un art qui briserait le miroir devant lequel nous posons. L’art qui sera, sera tous les miroirs. » En même temps, cette fresque historique réveille en nous le problème de l’immigration d’aujourd’hui dans toute sa violence et notre relation traumatique avec notre passé colonial. Un peintre s’y promène entre les victimes de guerre, comme un artiste de nos jours envoyé à Sarajevo. « C’est cette relation encre le rêveur et l’État qui constitue le sujet de ma pièce LES EUROPÉENS, qui se déroule dans l’Autriche libérée de 1683, ayant comme toile de fond la lutte en Europe centrale contre l’impérialisme islamique. ( …) La protagoniste victime d’une atrocité refuse de pardonner, et dans sa volonté intrépide de vivre sa douleur en public, offense profondément l’État conciliatoire. Elle représente un objet hurlant exposé au Musée de la Réconciliation. » Barker nous parle d’aujourd’hui à travers l’Histoire, Barker mêle les injures des bas-fonds de Londres au jargon élisabéthain, Barker démontre les limites de la connaissance avec des arguments fondés sur la connaissance, Barker nous dévoile la spiritualité par la sexualité — c’est l’artiste du pragmatisme par excellence, parce qu’il ne fuit pas la contradiction qui nous habite tous.
Son théâtre est aussi politisé, mais on se gardera bien d’y déceler avec trop d’insistance une quelconque tendance politique, puisqu’il démontre justement les contradictions dans toute conviction politique ( « On a une main droite et une main gauche », dirait Ernst Jünger), et dans ses pièces les manipulateurs sont souvent démasqués comme plus faibles que les manipulés, comme l’empereur Léopold dans LES EUROPÉENS qui éclate fréquemment en sanglots. On pourrait, si on était de mauvaise foi, dénoncer un certain élitisme — ou positionnement solitaire — dans son écriture, mais Barker a déclaré que son théâtre n’a jamais eu pour but la solidarité, mais celui de s’adresser à l’âme là où elle ressent sa propre différence. Il vise la dissolution de la pensée cohérente pour faire naître une vision du monde plus nuancée et en accord avec la vraie nature de l’homme, la valeur des œuvres d’art se trouvant dans leur capacité à anéantir les idées reçues que véhicule la communauté destructrice de l’individu. En revanche Barker se soucie du public, ou plutôt des individus qui constituent le public : « le public a besoin d’être à la fois préparé et, comme c’est le cas avec toute nouvelle forme de théâtre, éduqué à vivre sa propre liberté. » Il part du principe que « la fonction du théâtre est de rendre au public la responsabilité de l’argumentation morale. »