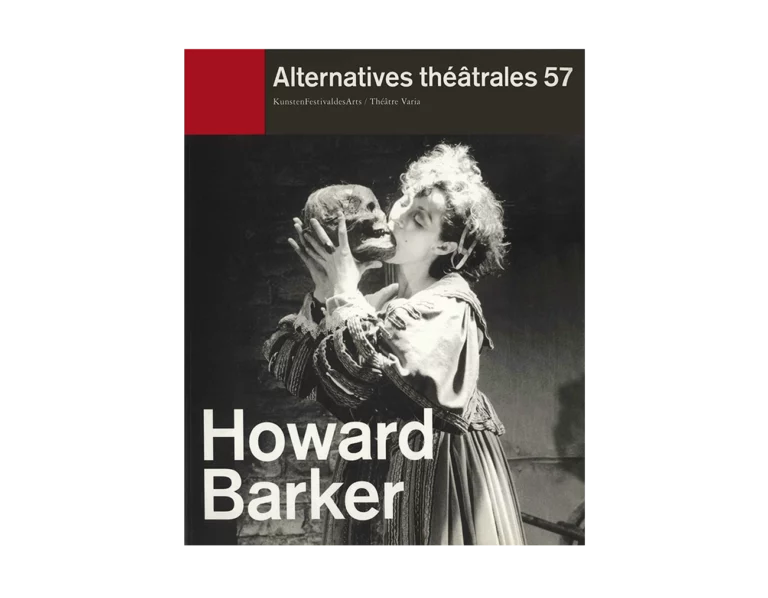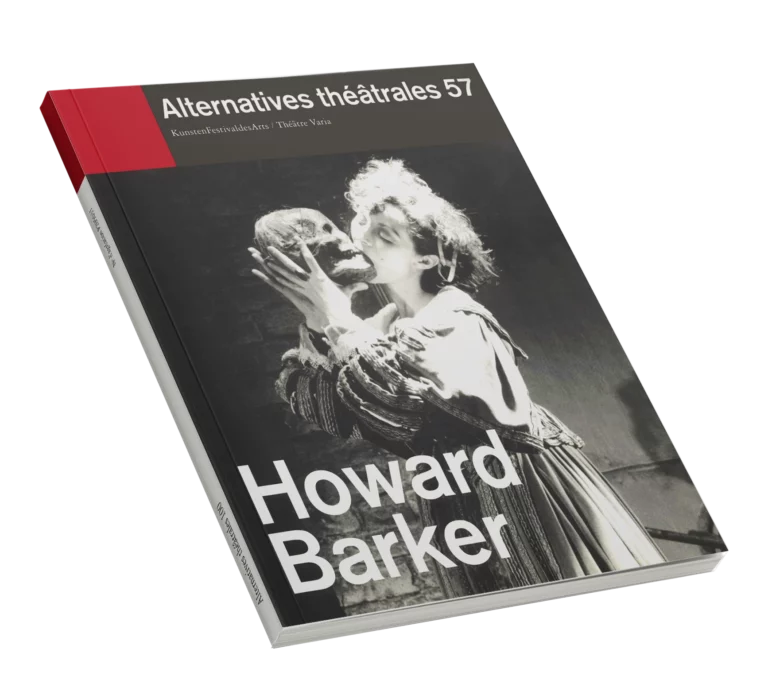Au début des années quatre-vingt, Howard Barker a abandonné le théâtre réaliste et rejeté les deux genres dramatiques qui dominaient alors la scène anglaise et la dominent encore maintenant : la satire politique et sociale et la comédie, en particulier la comédie musicale. Il a critiqué l’attitude autoritaire du théâtre de l’émancipation qui enseigne à ses spectateurs ce qu’ils savent déjà et qui se donne l’illusion de pouvoir changer le monde. Il a rejeté la célébration de l’idéologie régnante par le théâtre du divertissement et son soutien aveugle remarqués. à l’illusion réconfortante d’unité et d’harmonie sociales.
Par conséquent, il a conçu un théâtre radicalement différent qui allait au-delà de la contradiction de la satire en amenant son public « aux limites de la tolérance afin de mettre à l’épreuve la base même de la morale ». Ce théâtre était destiné à restaurer la tragédie et l’expérience de la souffrance et de la douleur sur la scène, expérience que la modernité avait exclue. En introduisant ce double négatif des formes conventionnelles du drame, il a perdu à la fois la faveur des autorités établies du théâtre et une partie de son public. Devant cette incompréhension, il a défendu sa conception de cet autre théâtre dans nombre d’articles et de conférences où il a exposé la théorie qui le soutenait comme une critique radicale du théâtre conventionnel.
Contrairement au didactisme du théâtre politique, sa nouvelle forme de la tragédie est un drame sans conscience, ce qui veut dire qu’il rejette toute responsabilité morale et refuse la valorisation par l’utilité sociale. Au lieu de soutenir les valeurs sociales traditionnelles, il révèle le côté négatif du rationalisme et de l’éthique qui en découle. Contrairement à la comédie qui célèbre l’harmonie, l’unité et le bonheur, son théâtre redécouvre la dignité et la signification de la division, de la douleur et de la souffrance. Barker méprise les tragédies mises en scène par le théâtre politique des années soixante en tant que simples « défaillances des services sociaux ». Le fait qu’il ait toujours prétendu savoir que « le socialisme était une tragédie » illustre à quel point il associait à ce terme une perturbation radicale de l’ordre social et moral.
En évoquant la tragédie grecque en tant que modèle, Barker s’en est approprié l’autorité pour son « théâtre de la Catastrophe ». Il définit son théâtre par sa parenté avec la tragédie classique, et en adopte quelques-uns des principes centraux. Il en invertit aussi d’autres ou leur prête une signification nouvelle selon ses besoins. Pour lui, la catastrophe et la souffrance qu’elle suscite était l’essence même de la tragédie, qu’elle soit ancienne ou moderne. Tandis que dans la tragédie classique la catastrophe signifiait l’inversion du développement de l’action vers une fin fatale, c’est-à-dire la réponse démesurée du destin à la faute commise par le héros (hamartía), dans le théâtre de la spéculation morale de Barker, ce terme désigne le processus d’exploration et de réalisation du moi au-delà des limites du rationalisme et de la moralité. C’est un développement voulu par ses protagonistes. Dans l’état amoral de la catastrophe, la transgression des lois de la moralité traditionnelle reste impunie puisque l’idée de la justice demeure en suspens. Cependant, un événement historique qui a ébranlé l’ordre politique, culturel et moral conditionne en général « la transformation totale » des protagonistes qui les amène à choisir une vie en dehors des principes de la raison et des normes éthiques. Par conséquent, Barker considère la violation des lois de la société comme l’essence même de transgression classique. Il y trouve l’état précédant la morale qui caractérise son« théâtre sans conscience » puisqu’elle révèle que les dieux sont fondamentalement amoraux et capables de malveillance de même qu’elle montre la nature barbare de l’homme. Il se réfère également à la tragédie classique pour justifier sa représentation de la douleur pour elle-même et sa foi dans sa beauté : « les Grecs ont compris les plaisirs cachés dans le spectacle de la douleur autant que son importance dans la vie, son irrationalité suprême ».
Le héros tragique et les protagonistes chez Barker : souffrance, justice et moralité
Le théâtre de la Catastrophe de Barker, tout comme la tragédie classique, exhibe « le refus de l’individu à se soumettre à l’interdiction de creuser sa personnalité aussi bien que l’irruption de la volonté dans le domaine des valeurs sacrées de la société ». Le protagoniste chez Barker, tout comme le héros tragique, poursuit son but en toute connaissance des conséquences fatales qui en découlent. Mais, contrairement au protagoniste de Barker, le héros tragique souffre parce qu’il ne peut pas contrôler les conséquences de ses actions.
Il succombe à des puissances qu’il ne peut, par sa prudence, ni comprendre ni éviter. L’excès de souffrance que le destin lui inflige révèle que « les sphères de la raison, de l’ordre et de la justice sont terriblement limitées. » Sa destruction finale indique pourtant la restauration de l’ordre et de la justice au-dessus de sa dépouille mortelle. Barker feint d’ignorer cela en prétendant que la tragédie grecque n’impliquait pas de didactique morale, car son théâtre de la Catastrophe imagine le moment « où la réconciliation est un désastre plus grand que la disparition ». Il refuse catégoriquement toute réconciliation avec la moralité et l’ordre traditionnels. Les protagonistes de Barker souffrent parce qu’ils transgressent implacablement les normes éthiques conventionnelles pour acquérir un savoir au-delà des limites de leur moi connu, de la nature de leurs désirs. Ils y sont poussés par une « volonté d’être entier », par une « intuition que les conventions sociales et politiques ou simplement la peur entravent et répriment d’autres variétés de leur moi ». Le théâtre d’expérimentation morale de Barker pousse l’effondrement moderne du consensus moral à son comble afin de réévaluer les critères éthiques traditionnels que la société a dépassés et, en le transformant en acte, de tester les conséquences de la pensée défendue. Le théâtre de la Catastrophe est une recherche de « la nature de l’esprit du mal, de la signification de la méchanceté » aussi bien que de la relation dialectique du bien et du mal qui démontre comment l’un crée l’autre en révélant le côté négatif de la vertu et le côté positif du vice. Il rompt l’opposition manichéenne du bien et du mal, en effaçant les limites qui les séparent et en démontrant la « coexistence de l’amour et de la cruauté, du désir et de la douleur ». La pitié est rejetée parce qu’elle est répressive et la souffrance est glorifiée en tant que clef de la connaissance. C’est pourquoi Lvov dans LA CÈNE croit que : « Seule la catastrophe peut nous garder pur ». La catastrophe est considérée comme la condition préalable nécessaire à la reconstruction. Le spectacle de la souffrance qu’elle provoque engendre une beauté subversive.
La réaction du public
Le théâtre de la catastrophe rejette l’hypothèse que, face au théâtre classique, le public forme une communauté rituelle qui estompe l’individualité. Il s’adresse aux spectateurs en tant qu’individus avec l’intention de susciter en eux des réactions et émotions différentes voire contradictoires. Les actions improbables et irrationnelles des protagonistes, leurs terribles transgressions empêchent la libération du moi des spectateurs par identification, par empathie ou par pitié (éleos) en dépit de la souffrance et du désespoir qu’endurent les personnages de Barker. En voyant « faire l’infaisable » les spectateurs sont en proie à des sentiments, des pensées et des désirs qu’ils refoulent et qu’ils refusent d’admettre. Cela provoque en eux honte, gêne et colère. Leur confrontation avec des situations où la distinction conventionnelle entre le bien et le mal est annulée, déstabilise leurs convictions morales. Trouvant que leurs propres réactions contredisent les valeurs éthiques admises, ils sont déroutés et perdus. Le but de cette provocation de sentiments troublants et douloureux est une déstabilisation du moi et, de ce fait, elle est le contraire de la catharsis classique, la purgation de la fascination par l’effroyable et la crainte (phobos) aussi bien que de l’inclination à la lamentation (éleos). Pour Barker la véritable source de la tragédie classique est le mélange de fascination et de répulsion provoqué par sa représentation à la fois de la terreur et de l’affirmation du moi vis-à-vis de la collectivité. Il contredit Aristote en prétendant que la tragédie « ne fait rien valoir pour sa propre défense — ni pour son pouvoir thérapeutique, ni pour son effet cathartique sur le comportement social, donc rien de ce que prétend Aristote. » Barker espère plutôt que le désarroi des spectateurs les incitera à remettre en question les critères de l’éthique traditionnelle et à se faire leur propre
jugement au lieu de se laisser imposer le message d’un auteur. Son théâtre de la catastrophe semble apparenté à l’emphase de Nietzsche concernant la condition « prémorale » de la tragédie grecque, sa mise en scène de la nécessité de la destruction comme condition préalable à la création et l’importance de devenir plutôt que d’être, c’est-à-dire, pour l’individu, de faire l’effort de découvrir son moi véritable.
La morsure de la nuit
La pièce LA MORSURE DE LA NUIT a été écrite à la demande de la Royal Shakespeare Company et représentée en Mars 1988 au Barbican Centre à Londres. Elle a marqué le tournant déterminant dans l’écriture dramatique de Barker. Contrairement aux satires politiques qui l’ont précédé au théâtre didactique de Brecht, le théâtre de Barker devient, à partir de ce moment-là, une chambre noire où l’obscurité libère l’imagination, le désir illicite et la pensée qui « mord, et on peut être parfois mordu par l’amour et parfois par la peur. » Les prologues, introduisant les’ trois actes de la pièce, définissent sa nouvelle dramaturgie et familiarisent le public avec son nouveau rôle. Le mythe de Troie comme catastrophe Avec la mise à sac de Troie, Barker s’approprie pour son théâtre de la Catastrophe ce que George Steiner a appelé « la première grande métaphore tragique ». Il utilise des fragments de l’ILIADE et de l’ODYSSÉE de Homère, de l’ENÉÏDE de Virgile, mais aussi de l’histoire de la découverte de Troie par Schliemann, comme images métaphoriques pour sa mise en scène d’une archéologie de la connaissance illicite comme histoire fictive. La narration du drame est fracturée et sa chronologie perturbée. Elle fait l’amalgame du temps qui suit la chute d’Ilion avec l’époque d’Homère, avec celle de Schliemann et avec le présent en mélangeant personnages historiques et fictifs. La causalité est rejetée en tant que principe de l’histoire. Les explications de l’histoire se révélent être des mythes. On ne peut pas y trouver de vérité historique puisqu’elle est d’emblée mise hors de question. La pièce imagine ce que Horkheimer et Adorno ont appelé « l’histoire souterraine » des instincts, des passions et des désirs humains qui sont réprimés par la civilisation autant que celle de la mutilation du corps humain par son assujettissement aux disciplines et aux normes de la société.
La scène se situe dans les ruines d’une université moderne qui, par la suite, deviennent les ruines d’Ilion. La découverte énigmatique des vestiges d’une série de cités superposées par l’archéologue Schliemann fournit l’image centrale de la pièce qui transpose la notion de temps en notion d’espace.
Le protagoniste de la pièce est le chercheur en lettres classiques Savage. L’exploration de son ego sauvage, son archéologie du moi et de la connaissance lui font parcourir, avec son étudiant Hogbin, une série de Troie différentes, leurs idéologies et systèmes d’ordre social respectifs ainsi que leur destruction. Seules quatre de ces cités sont représentées en détail. La Troie de papier est une cité pacifiste sans murs ni armes où l’individu est la mesure et où les seuls crimes sont ceux que l’on commet contre soi-même. La Troie du rire au contraire idéalise le conformisme et l’impératif catégorique. Elle abhorre l’individualisme et abolit la vie privée. Elle est la cité du « nous » et du devoir. Son homme nouveau observe la loi et vit en public « où rien de non-commun ne peut être fait ». Là se révèle le caractère oppressif de l’unité et de la solidarité. La Troie de maman est une société matriarcale qui conçoit l’état comme une pouponnière. Elle s’oppose aux principes des Lumières et à l’émancipation et ramène ses citoyens à la naïveté enfantine. Enfin, la Troie parfumée suit les principes de la morale puritaine, l’idéal de la propreté. Elle méprise le corps et purge la société de toute souillure comme par exemple le désir qui est la seule offense capitale. Elle magnifie le mariage. Des soldats modernes maintiennent l’ordre et le pouvoir de chacun de ces sytèmes. La Troie des poètes, la Troie mécanique et la Troie dansante ne sont, par ailleurs, que mentionnées dans la pièce.
L’éducation comme processus « décivilisateur »
L’effondrement de la bibliothèque universitaire suggère celui du savoir traditionnel, mais la catastrophe est la condition préalable du renouveau. Savage, l’auteur de livres sur Homère, commence « l’éducation » évoquée dans le sous-titre qui est en vérité un processus de décivilisation. Il rompt les liens familiaux, chasse son fils et incite son père à se suicider. Créüse, sa femme, refuse de son côté de continuer à jouer le rôle que l’homme lui a assigné et décide de se perdre dans le chaos de l’après-guerre. L’identité sociale déterminée par les structures familiales est dissoute. L’impiété catastrophique de Savage est mise en relief par son identification ironique avec l’Enée de Virgile, le modèle de la piété. Dans la première scène, Créüse se souvient de lui portant son père sur le dos et menant son fils par la main comme Enée portait Anchise et menait Ascagne pour les sauver des ruines de Troie en flammes. Selon Susan Langer le héros tragique grandit « mentalement, émotionnellement ou moralement par les exigences de l’action qu’il a initiée lui même, et qui le mène à l’extinction complète de ses forces, à la limite de toute possibilité de développement ultérieur. » Dans le théâtre de Barker, les transgressions du protagoniste s’efforçant de libérer sa pensée, ses émotions et son imagination des entraves du conventionnel, lui font perdre la tête et le forcent, comme Lear, à retrouver une nouvelle façon de voir et de comprendre. Savage, au contraire du héros tragique, en acceptant l’existence du mal en lui, est dépourvu de tout sentiment de culpabilité. C’est pour cette raison que, incarcéré dans la Troie parfumée, il est contraint de se laver jusqu’à avoir l’odeur de la volonté du compromis. Pendant sa recherche faustienne, Savage rencontre Hélène de Troie, Homère et Schliemann. La cécité du barde grec justifie l’investigation du chercheur de « l’ami-histoire ». Il écrit l’histoire de Troie qu’Homère a omis d’écrire parce qu’il a cru qu’un chant sur les ruines et les vaincus était sans intérêt. La pièce reflète sa propre production.
Hélène, allégorie du désir et de la connaissance Le désir implacable du professeur de lettres classiques pour Hélène de Troie est emblématique de son obéissance dionysiaque à sa volonté irrationnelle. Hélène sait qu’elle est la création d’Homère et qu’elle n’a pas d’identité : « Pas moi. Je n’ai jamais existé. Il n’y a pas d’Hélène sauf celle qui fut construite par les autres. » Elle incarne les images contradictoires que l’homme s’est faites de la femme. Elle est l’objet du désir mais aussi la victime et le bouc émissaire de chacune des sociétés des douze Troie. Ce n’est cependant pas parce qu’elle est belle comme dans le poème d’Homère qu’elle est séduisante, mais parce qu’elle incarne tout ce qui est refoulé et interdit par chacune des idéologies différentes : « Elle est tout ce qui est impardonnable ». Barker conteste le cliché qui lie le désir à la jeunesse et à la beauté. Hélène confirme pécher elle-même sans vergogne : « J’ai aimé Troie parce que Troie était pécher. » Son caractère change avec l’ordre social d’après lequel elle est construite en tant que son négatif, son alter ego.
Elle est responsable de l’effondrement de la vie de famille, de l’éloignement des hommes de l’emploi régulier, des horreurs de la guerre et pourtant, elle mangue complètement de sentiment de culpabilité. Elle n’est ni bonne ni mauvaise. Elle ne croit en rien et méprise les vertus, la pitié, le devoir, la pureté. Dans la Troie riante, elle est condamnée pour sa vie sexuelle clandestine, sa revendication d’intimité : « Elle est tout moi et ceci est l’âge du nous … » Afin de la punir on lui coupe les bras. Cela la transforme en un signe de l’individu, la lettre « j ». L’étudiant de Savage, Hogbin, lui prête ses bras pour attirer Savage sur sa poitrine. Elle devient une marionnette manipulée par les hommes. Dans la Troie de maman, elle est amputée de ses jambes parce qu’elle a étouffé son bébé avec ses seins. Sa mutilation progressive reflète les essais des sociétés différentes de la maîtriser en contrôlant son corps. Elle finit par être poussée sur scène dans une chaise roulante. Le fils de Savage propose même de la faire bouillir afin de distiller son parfum. Jusqu’à la fin, elle insiste sur le fait qu’elle personnifie la connaissance. Dans la dernière scène, Savage enterre enfin le corps mutilé d’Hélène, un torse rappelant l’état fracturé dans lequel les archéologues ont trouvé les statues qui nous offrent une idée de la manière dont le corps était perçu dans l’antiquité. L’archéologie de la connaissance illicite faite par la pièce se termine par un tour guidé des ruines de l’université par Schliemann. Cet archéologue autodidacte la considère comme une prison et il demande ironiquement à Savage s’il est au nombre des visiteurs.
Les limites du théâtre de la Catastrophe
L’insistance de Barker sur la parenté de son théâtre de la Catastrophe et de la tragédie classique minimise des différences fondamentales. La tragédie classique ne naît qu’avec la « connaissance tragique » qui provient de la foi en un sens métaphysique. Le tragique n’apparaît que lorsque la connaissance du protagoniste transcende l’expérience de la mort et de l’horreur. À l’époque de la télévision-vérité et des films d’horreur où tout est possible, le théâtre de Barker qui est basé sur la spéculation morale risque d’être mal compris. Les transgressions choquent ou provoquent la mise en question des valeurs aussi longtemps que les normes morales et les tabous conservent de l’autorité. Quand les spectateurs ne peuvent plus s’identifier aux personnages sur scène, quand les actions sur la scène n’ont qu’une relation négative ou ambiguë avec leur expérience de la réalité, comment les transgressions pourraient-elles provoquer une inquiétude morale ? l’impact moral ne dépend-il pas de l’existence d’un terrain commun que partagent les personnages dramatiques et les spectateurs ? Comment le sentiment de sécurité morale du public peut-il être ébranlé dans un monde indifférent à la morale ? La souffrance et le ton pathétique risquent de paraître théâtraux, mélodramatiques ou même involontairement comiques quand, contrairement à la tragédie classique, il n’existe plus entre le public et la scène une foi partagée en un sens métaphysique.