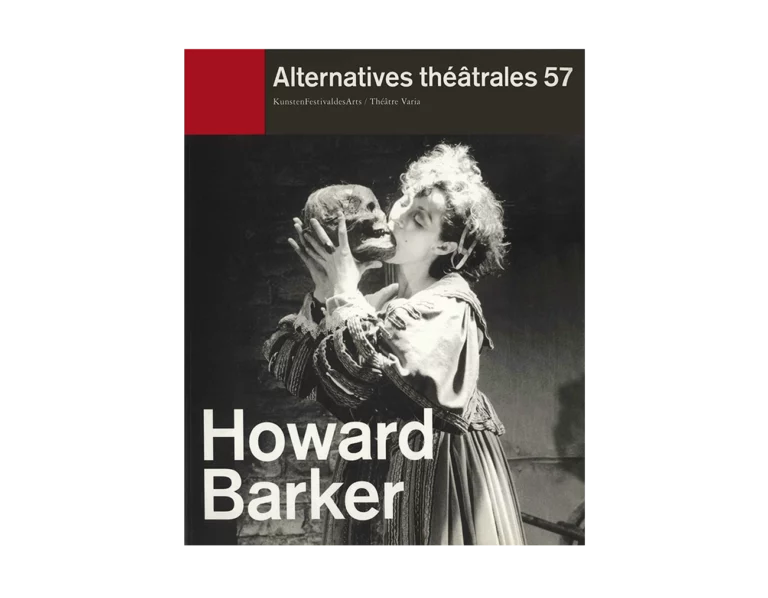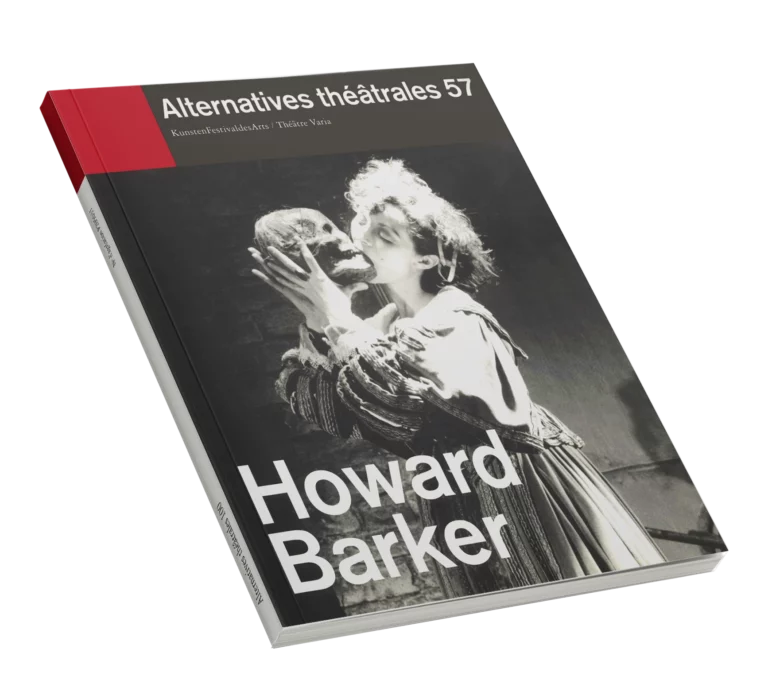MIKE SENS : Si j’étais Stanislavski, que me diriez-vous ?
Howard Barker : Je vous dirais que j’admire ce que vous avez fait en votre temps, mais que ce n’est plus valable de nos jours. Ce qui a produit le naturalisme du 19′ siècle ne prévaut plus dans le théâtre de notre fin de siècle. C’est évident si l’on prend en compte un élément caractéristique qui a directement atteint le théâtre : je veux parler de la télévision. Elle a hérité directement de la méthode réaliste de Stanislavski. Notre situation actuelle est la suivante : la télévision reflue comme une marée et noie le théâtre. La question de savoir si la technique de Stanislavski est juste ou non n’est pas pertinente. Il faut plutôt se demander si le théâtre aujourd’hui peut se satisfaire de l’esthétique de Stanislavski. Nous vivons dans de nouvelles conditions, donc nous avons besoin d’une nouvelle esthétique. Toutes les esthétiques vivent et meurent. Un type de théâtre fait autorité pour une période définie. Pour la période que nous vivons j’ai une théorie sur ce que devrait être le théâtre. Et ce n’est pas celle de Stanislavski. Souvent les personnages, au milieu d’une longue tirade, émettent simultanément trois ou quatre idées. Le public ne sait pas laquelle suivre, quelle idée est la vraie idée, parce que chez Stanislavski tout ce qui se fait sur le plateau a une intention. Il dit que tu peux remplacer chaque discours par « je veux ». C’est le réalisme. Mais vous et moi nous ne voulons pas tout le long de la journée, nous ne savons même pas du tout ce que nous voulons. Ce qui se passe, c’est que nous rencontrons des gens et ils nous distraient de nos intentions, la vie est une continuelle série de diversions, de forces qui nous manoeuvrent. Le théâtre de Stanislavski est tendu vers l’objectif de persuader notre esprit. Ils comprennent cela : c’est rationnel. Mais l’être humain n’est pas rationnel. Ainsi ils refusent mon langage qui joue avec l’idée de l’idée. Spécialement en Angleterre qui a une culture utilitariste, où tout a une valeur d’utilité. Même le théâtre doit avoir une valeur d’utilité. Je ne pense pas que la France soit comme cela. J’ai peut-être tort, mais je ne pense pas.
M. S.: Et si j’étais Brecht, que me diriez-vous ?
H. B.: Je vous dirais exactement la même chose. Parce que Brecht et Stanislavski sont cousins si ce n’est frères. Dans les pièces de Brecht, vous recevez la sagesse de Bertold Brecht et on est obligé de l’accepter. C’est là où le bât blesse, parce qu’il savait pertinemment qu’il y avait un effet d’aliénation dans son théâtre, du fait que les acteurs parlent sur scène comme le prêtre du haut de sa chaire. Le public ne tirait pas ses propres conclusions, mais des conclusions fondées sur les évidences que Brecht avait montrées. Donc ça n’était pas un « fairdeal », un arrangement honnête : tout était déjà fixé. Dans mon oeuvre, parce que je ne cherche pas à me contrôler pour être fidèle à ma propre idéologie, je n’impose pas au public de l’accepter.Les différentes conceptions s’affrontent. J’essaye seulement de susciter des réactions émotionnelles, et le public fait ce qu’il a choisi de faire. Je ne suis pas un libertaire, mais j’essaye de donner au théâtre la forme la plus démocratique possible. Si vous me demandiez : qu’est-ce-que vous attendez d’un artiste quand il vous lit un texte ? Ma réponse serait:Je demande à un artiste de rêver et je le paie pour qu’il me montre ce à quoi il a rêvé. C’est l’irresponsabilité d’un grand artiste qui touche, pas sa responsabilité.
M. S.: Certaines personnes en Angleterre vous ont appelé le Brechtanglais …
H. B.: Il fut un temps où je pensais que la lutte des classes pouvait être montrée au théâtre, j’étais engagé politiquement. Depuis ce temps j’ai réalisé la futilité de cette conception.Donc si on m’a appelé le Brecht anglais, cela devait faire référence à cette période. Mais je n’ai jamais eu l’intention d’être un Brecht anglais. De toutes les façons mon théâtre est plutôt ambigu, trop obscur pour correspondre à ces étiquetages.La société contemporaine est de plus en plus oppressive en ce sens qu’elle conditionne de plus en plus les gens, et la technologie participe à cela. Il n’est permis à personne d’être mystérieux ou sombre. Le domaine privé est continuellement réduit. Cet entretien est une illustration parfaite de ce que je viens de dire. La lumière comme déterminant culturel et spirituel exige qu’aucun individu solitaire ne reste en dehors du syndrome d’accès.
M. S.: Et si j’étais Artaud que me diriez-vous ?
H. B.: Je dirais : « Je vous aime beaucoup Monsieur Artaud, mais il faut que vous appreniez à aimer la langue. » Consciemment je ne vois pas de lien entre mon Théâtre de la Catastrophe et son Théâtre de la Cruauté. Cependant Artaud a tout d’un coup interprété le théâtre comme un cauchemar, enfin c’est ainsi que je le lis, mais pour moi l’expérience de ce cauchemar vient directement de la langue. Artaud a épuisé la langue tout comme le théâtre utile. Pour moi une langue inventée, et pas seulement empruntée, reste au centre de la pratique théâtrale. Dans mes pièces j’ai créé un idiome pour mon langage qui rejette totalement le fléau naturaliste de la parole au théâtre. Il contient un registre élevé et un registre bas ; d’un côté littéraire, poétique, métaphorique,et de l’autre argotique, cru, terre à terre.Beaucoup de répliques ont un rythme particulier. Ce rythme est le résultat de la poésie — ma propre expérience en tant que poète — mais reflète également le courant sous-jacent de l’argot londonien parlé par mes parents et leurs ancêtres.Les démunis à Londres étaient très créatifs avec la langue qui n’était pas contaminée par le langage des films américains. La langue de chez eux était comme une substance. Pourtant je n’ai plus d’illusion sur la beauté du prolétariat. Il n’a pas de vertu qui lui soit propre. Je n’accorde pas beaucoup d’importance à la notion de classe.
M. S.: Vous vous définissez comme un Européen, c’est plutôt étrange pour un Anglais, non ?
H. B.: J’ai toujours eu le sentiment d’être européen et n’ai jamais beaucoup insisté sur mon identité britannique, même si je ne la renie pas. Mes influences culturelles — surtout parce que je viens d’un milieu ouvrier — je les subissais là où je les trouvais. On ne m’a pas inculqué de doctrines. Donc j’ai d’abord rencontré Marx, Camus, Sartre. Et plus tard, de manière plus significative, Nietzsche, Rilke, Céline, Stendhal, Pascal. L’héritage littéraire et philosophique européen est époustouflant,d’une richesse incroyable. Et au cinéma, Tarkovsky est pour moi le maître du siècle, il utilise la caméra non pour créer de la beauté, mais pour créer des métaphores inattendues qui recèlent les significations. Mais il y a également Pasolini, Bergman, Bresson, c’est plus qu’un esprit peut emmagasiner. J’aurais pu être réalisateur parce que j’adore le cinéma, et que je suis beaucoup allé au cinéma quand j’étais jeune homme.