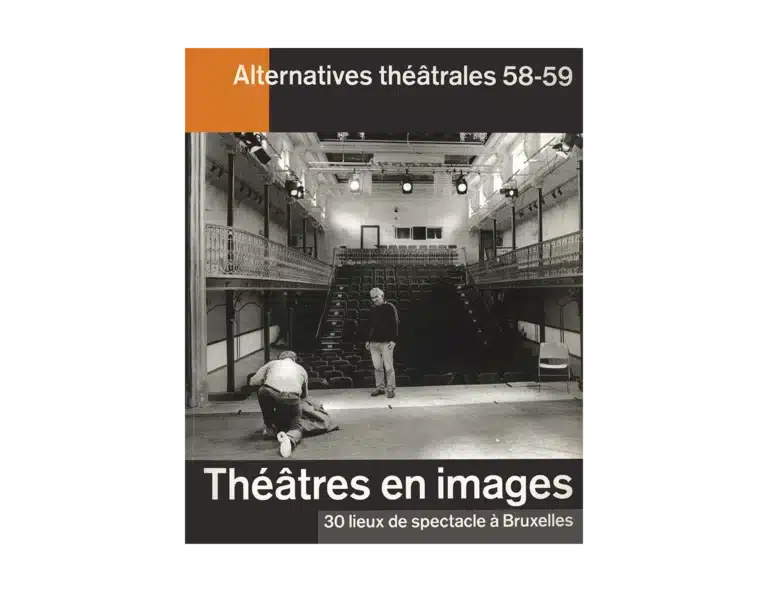LE SPECTACLE débutait avant même que le lieu ne soit en vue. Plongeant vers la tombe du soldat inconnu par un dédale de rues qu’on empruntait jamais, l’avancée vers le Cirque s’apparentait à une aventure, une percée piquante dans la forêt des ruelles et des embouteillages. La peur de manquer le début nous tenaillait et faisait monter la tension. C’est dans les méandres de notre imaginaire que nous filions sitôt descendus du tram pour fouler le trottoir mugissant du brouhaha de la foule agglomérée à l’entrée que nous découvrions soudain, pantois. Car le Cirque Royal, c’est d’abord cette trouée irrepérable dans l’alignement étale des façades, cette gueule béante creusée en retrait de l’allée, impressionnante par sa hauteur et sa teinte de marbre clair. Le seuil entre ce parvis et le dehors franchi, nous étions aspirés sans retour par le lieu, antre grondant au sein duquel il fallait se faufiler, qui résonnait déjà du tintouin de l’orchestre qu’attisait et couvrait le brouhaha de la foule excitée. Deux solutions s’offraient d’emblée : pénétrer par l’issue du bas et s’enfourner d’un bond dans ce ventre troglodyte ou grimper l’escalier magistral scindé au centre par une escale, avaler la seconde volée et franchir les portes battantes, foncer à droite ou à gauche selon les numéros, longer le cercle qui ceint l’arène toute proche désormais, grouillante de murmures et de terreurs latentes, mugissement sourd emplissant l’aire arrondie, tendre les billets à une ouvreuse ou un portier et accéder enfin à l’esplanade encore éteinte, espace sans définition repérable, magique et terrifiant, dominé dans toute sa hauteur verticale, gouffre à pic, balisé par des barrières et les travées où la cohue trépidante prenait place. Le Cirque Royal, c’est d’abord la splendeur spécifique du cadre sans égal, conçu aux seules fins d’agapes clownesques et d’entrées spectaculaires, de sauvageries domestiquées, de rites costumés, de rituels ancestraux accordés au goût du jour.
L’attente du début du spectacle était à la hauteur du frisson provoqué par l’entrée. Le choc du lieu et sa bouleversante découverte engendrait un vertige qui favorise l’adulation du spectacle, sa réceptivité candide fondée sur l’exaltation des frayeurs enfouies, des pulsions les plus tribales, liées au rire et à la dévoration, au fantasme absolu de l’envol et de la chute, du barrissement et de la cavalcade, du déguisement et de la fanfare. Le tournis interne s’accroissait soudain par le flux de lumière lactée, aux relents bleutés, craché par les gros projecteurs noirs sur l’orchestre en contrebas, en mise colorée (pantalons noirs, vestes à galons rouges ou bleues, képis à visière et chef en grande tenue), qui s’emparait du lieu, en dilatait d’un coup de cymbale l’immensité vaste et nue. Tapis dans l’ombre, résiliés dans l’éther, en culottes courtes, aux anges, nous voyions alors se dérouler impeccablement le spectacle rythmé par le défilé des entrées scandées tambour battant par l’orchestre, pulsées sur l’anneau de sable clair bordé par l’orbite de bois orné d’un coussin de velours écarlate. La voix amplifiée du Monsieur Loyal à chapeau buse et redingote, sorte de majordome autoritaire, altier magister ou contremaître, accordant en grande pompe le cours des numéros, nous rendait dociles au dressage des chevaux bais ou pommelés, parés de plumets et de harnais, galopant à vive allure, se cabrant, cavalant sous l’égide d’une écuyère en accorte tenue, maillot brillant et bas résille, ou d’équilibristes jongleurs à toison gominée et fringants pantalons crèmes tirés sous la semelle par des élastiques, qui trottaient à côté du canasson, pirouettaient sur sa croupe, virevoltaient d’une main, s’agrippaient et s’accumulaient à deux, trois, quatre ou cinq, debout bras ouverts, crucifiés dans la lumière et happés d’un coup dans la coulisse par la fermeture des rideaux, trappe molle se déchirant et se closant sous le promontoire où les musiciens, absents de leur chaise lors des numéros plus longs, débitaient de concert leur partition.
Ainsi en était-il aussi des phoques, masses amorphes et grasses, ondulant en couinant, museau brandi sous des ballons colorés, des éléphants hissant leur trompe vers le faîte du chapiteau, assis sur des tabourets grotesques et raillant le dérisoire poncif du magasin de porcelaine, des zèbres (réputés indomptables) et des clowns, emberlificotés dans leurs souliers d’un mètre, au faciès fardé d’un hilare sourire, au nez rouge, à tignasse girante et chapeau plat, celui du clown blanc étant pointu, son habit irradiant de mille éclats accordés aux escarpins vernis étayant ses bas blêmes, qui s’adressaient à nous sans fard, se fichaient de violentes claques à la figure, puisaient de l’eau à pleine bouche. Saouls d’émotion, perclus de rire, grandis par l’immanence imposante du site, nous quittions nos sièges à l’entracte pour nous risquer dans les entrailles de l’antre, dévaler aux enfers, plonger dans les soutes abyssales, labyrinthe odoriférant de sueur, de crottin, d’haleines de fauves rugissant, dénudant leurs gencives roses, exhibant leurs incisives carnivores et leurs griffes acérées, nous dévorant littéralement d’un coup d’œil, avalés dans leur panse tigrée, ballottés sous leurs pattes souples, virant et toupillant dans les cages, narguant la foule apeurée, projetée dans ce lointain passé tant conté dans les manuels scolaires et les films en CinémaScope où la plèbe tend son pouce vers le bas, se hérisse sur les gradins bâtis par l’empereur à la lippe goulue, à la moue veule, au front ceint de lauriers, lapant du vin et gobant des raisins, réjoui du barbare festin des chrétiens déchiquetés, dépecés, démembrés, mis en pièces, dévorés vivants par les aïeux sans pitié des fauves géants campés devant nous.
Jacques Lassalle « J’ai plus appris de mes révoltes que de mes adhésions »
Rencontre avec Georges Banu
GEORGE BANU: Il y à mon sens deux grands types de début: les débuts-événements et les débuts processus. Comment envisagez-vous…