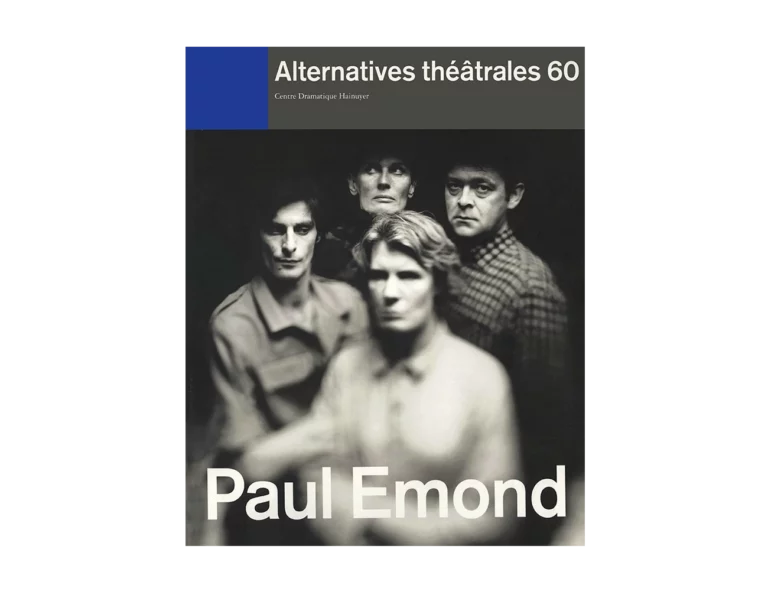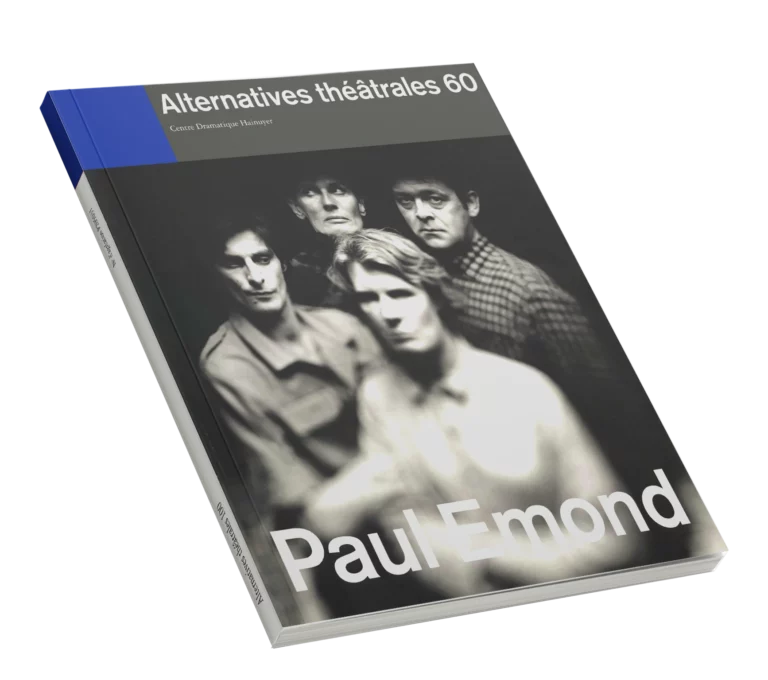ALTERNATIVES THÉÂTRALES : Comment s’est déclenchée chez vous l’écriture théâtrale ?
Paul Emond : Vers 1984, Philippe Sireuil m’a proposé d’écrire une pièce et il en est résulté LES PUPILLES DU TIGRE qu’il a monté deux ans plus tard. Mais cette arrivée au théâtre était sans doute préparée par le plaisir que j’avais trouvé à manier les codes de l’oralité dans Les romans que j’avais déjà publiés à cette époque. Je suppose que c’est d’ailleurs cela qui avait intéressé Sireuil. LA DANSE DU FUMISTE et PLEIN LA VUE sont des narrations à la première personne, où celui qui raconte en a sans cesse plein la bouche et où le flux d’histoires et de commentaires qu’il débite semble être cela même qui le tient en vie. Dès que je me suis mis à écrire pour le théâtre, j’ai senti que je me trouvais là avec une forme particulièrement appropriée pour poursuivre ce type d’écriture : on peut dire, je pense, que chez nombre de personnages de mes pièces la parole est le moyen essentiel de survivre, sinon la seule façon de ne pas sombrer.
A. T.: Cela revient-il à dire que, pour vous, le geste de l’écriture romanesque et celui de l’écriture théâtrale sont semblables ?
P. E.: Il me semble que les raisons fondamentales qui poussent à écrire ne changent guère, qu’il s’agisse de roman ou de théâtre. L’envie ou le besoin de façonner des personnages, d’explorer à travers eux telle ou telle dimension de l’existence, l’envie aussi de créer une forme et une musicalité avec des mots, tout cela appartient autant à l’écriture théâtrale qu’à l’écriture romanesque. Ceci étant dit, j’ai appris très vite que les modalités étaient différentes. L’écriture théâtrale suppose que l’on prenne en compte ce que le metteur en scène et le comédien apporteront, il faut donc pouvoir leur laisser de la place, il faut pour cela que le texte ne soit pas cadenassé, qu’il ait du « jeu », et donc du sous-texte, du non-dit. Mais la frontière est floue et l’on a vu d’ailleurs de grands metteurs en scène travailler au théâtre des morceaux romanesques. Voyez ce qu’à fait Vitez avec LES CLOCHES DE BÂLE d’Aragon ou Grüber avec LE RÉCIT DE LA SERVANTE ZERLINE de Broch. D’ailleurs, je n’ai pas trop envie, non plus, d’écrire du théâtre sur mesure. J’aime travailler à la lisière des deux genres, garder dans mes pièces une place importante pour le récit. C’est ainsi que À L’OMBRE DU VENT, une de mes dernières pièces, mêle sans cesse les temps grammaticaux du présent et du passé et donne dès lors aux protagonistes un statut mixte de personnages et de narrateurs.
A. T.: Écrivez-vous vos pièces avec un souci de la représentation ?
P. E.: Oui, même s’il s’agit de la prendre volontairement en porte-àfaux, comme dans le cas que je viens d’évoquer. Ou dans celui de CONVIVES, où certains personnages oscillent entre une dimension réaliste et une connotation théâtrale exhibée presque à l’excès, de façon volontairement caricaturale. Mais plus je vais, plus j’ai envie de donner au comédien un matériau qui lui convienne, qu’il puisse s’approprier comme il l’entend. Cela va jusqu’à des choses très physiques : voyez le personnage de Barat, par exemple, quand, à la fin de MALAGA, il éclate de rire au milieu d’une crise de désespoir. Il est évident que là, on est loin du roman… Ceci dit, je m’en tiens aux mots et aux phrases, je visualise peu en écrivant, je ne cherche d’ailleurs pas à le faire.
A. T.: Dans vos pièces vous accordez, comme vous venez de le dire, une grande place au récit. En quoi cette technique est-elle proprement théâtrale ?
P. E.: L’est-elle ? Cela supposerait une définition précise du « proprement théâtral » qui peut m’intéresser en tant qu’observateur extérieur mais certainement pas au moment où je suis embarqué dans l’écriture d’une pièce et où je me débats avec les mots de mes personnages. J’ai répondu d’ailleurs à ceux qui disent de mon théâtre : « c’est trop bavard ». J’ai dit à peu près ceci : pour Le type de personnages qui m’intéresse, pour ces sans grade, le plateau d’un théâtre est sans doute le dernier lieu où ils peuvent avoir droit à une parole publique. Alors, laissez-les parler tant qu’ils le veulent, laissez-les se vanter, raconter leurs trucs et leurs machins et même mentir à tire-larigot pour cacher ce qu’ils cherchent à cacher. Je vois d’ailleurs bien comment cette « parlerie » est à la fois ce qui intéresse les metteurs en scène de mes pièces et ce qui leur fait problème, au sens où cela les provoque, ce qui est loin d’être inintéressant. J’ai eu avec Jean-Claude Berutti, par exemple, de superbes discussions à ce sujet. Et puis, mon théâtre est loin de n’être que du récit. GRINCEMENTS ET AUTRES BRUITS, ma dernière pièce, y recourt même très peu.

A. T.: Je posais la question de la théâtralité, parce qu’il me semble que le récit soit de l’ordre du passé et ait peu à faire avec le présent de la représentation.
P. E.: Le présent, ce sont toutes les raisons qui déclenchent le récit : on peut raconter pour séduire, pouf se faire plaindre, pour ne pas aller se suicider. Ces raisons-là me paraissent profondément théâtrales. Même dans le monologue MOI, JEAN-JOSEPH CHARLIER, DIT JAMBE DE BOIS, HÉROS DE LA RÉVOLUTION BELGE, qui est un récit d’un bout à l’autre. Le personnage y raconte son odyssée à la fois grandiose et grotesque mais ce qu’il raconte, il l’a déjà raconté six cents fois, avec son histoire il casse les oreilles de ses auditeurs dans un bistrot liégeois ou ailleurs, il n’est plus qu’un pauvre homme, qu’un aigri obsédé par l’idée qu’il a droit, pour tous ces actes de bravoure qu’il ressasse par le menu, à la pension que le jeune État belge lui refuse. Pour lui, refaire son récit, même si c’est pour la six-centième fois, revivre ce qui fut sa gloire, justifie à ses yeux tout le reste de sa médiocre existence. C’est un acte de vie, de survie. Toute la mise en scène de Jules-Henri Marchant le montrait d’ailleurs parfaitement.
A. T.: Il s’agit donc fondamentalement dans vos pièces d’inventer une ou des situations qui déclenchent les récits de vos personnages ?
P. E.: Ce sont des situations qui amènent souvent les personnages, ou certains personnages, à se livrer. Mais il s’y passe aussi d’autres choses.
A. T.: Comment écrivez-vous vos pièces ? Partez-vous d’un ou de plusieurs personnages ?
P. E.: Je pars de bribes de paroles. De bribes de discours qui au départ ne s’accrochent pas nécessairement tout de suite à des personnages bien définis. Asseyez-vous dans un bistrot ou un autre lieu public, fermez les yeux et laissez entrer dans vos oreilles ce que l’on raconte aux tables voisines. C’est passionnant : vous entendez des mots, des morceaux d’histoires mais vous ne savez pas encore à qui cela appartient. Puis, d’un coup, vous regardez : ça y est, le personnage est là, vous pouvez ajuster sur lui les mots qui l’habillaient à l’aveugle. Eh bien, ça se passe un peu comme ça au départ de l’écriture. Souvent, cela commence par quelque chose qui ressemble à de l’autojustification. Peut-être le personnage parle-t-il à un autre mais, en même temps et à coup sûr, il se parle, il parle à.son moi idéal. J’adore Tchekhov ; tous ses grands personnages fonctionnent à partir de cette autojustification.
A. T.: Comment à partir de cela, la pièce se structure-t-elle ?
P. E.: J’essaie en tout cas le plus longtemps possible de ne pas trop savoir où ça va, de faire confiance à la façon dont ces mots vont s’entrechoquer. Dès que des personnages sont mis ensemble, très vite les situations sont conflictuelles et donc dynamiques. Quand, par exemple, un « casse-oreille » vous envahit les tympans, cela génère un certain nombre de réactions. De toute façon, très vite, une crise s’installe. Plus tard, le plus tard possible, je reprends tout d’un point de vue plus « narratif » : entrées inattendues, ruptures, thèmes récurrents, contrepoints, nouveaux personnages, COUPS de théâtre, etc. Il m’arrive de lorgner sans vergogne du côté de la mécanique du vaudeville, d’en réutiliser les codes à contresens.
A. T.: Un discours d’autojustification peut-il être le point de départ d’un changement, d’une évolution des personnages ou de la situation ?
P. E.: Cela me semble évident. Dans INACCESSIBLES AMOURS, par exemple, ce qui pourrait éventuellement se passer dans la rencontre de Caracala et de la serveuse, de ces deux âmes solitaires (pour parler comme dans les feuilletons), est stoppé net par l’irruption, à deux reprises, de « l’homme au visage ensanglanté » et de l’histoire de ses aventures amoureuses qu’il leur rabâche, alors qu’elle ne les intéresse pas du tout. Idem en ce qui concerne Barat et Astrid, dans MALAGA : la crise de leur couple est exacerbée par tout ce que leur raconte Flambard sur les bonnes raisons qu’il a de divorcer. Il y a, dans ces récits, une dimension que les linguistes appelleraient performative : dire, en même temps, c’est faire…
A. T.: Mais qu’est-ce que le ressassement apporte au personnage même de Flambard ?
P. E.: Un personnage qui suit son obsession, qui s’y accroche, le fait comme à une bouée. Pour nous, qui voyons cela de l’extérieur, c’est drôle ou grotesque. Pour lui, c’est très sérieux, cela a une importance énorme, même si en réalité cela n’en a que très peu. C’est d’ailleurs ce décalage-là qui constitue un des principes fondamentaux d’un certain genre de comédie. Donc, toutes les histoires sur lesquelles revient Flambard dans MALAGA, son divorce, son métier de représentant, l’entretien de son corps, etc., ce sont des choses pour lui primordiales, qui l’occupent entièrement, parce que, s’il n’y avait pas cela, il n’aurait plus rien, il n’aurait plus qu’à s’écrouler. Ces personnages-là, ces monomaniaques, réduisent leur vie à leur seule obsession. Voyez jusqu’où le théâtre de Thomas Bernhard pousse le traitement de personnages de ce type.
A. T.: Mais le ressassement chez Bernhard produit une certaine lucidité.