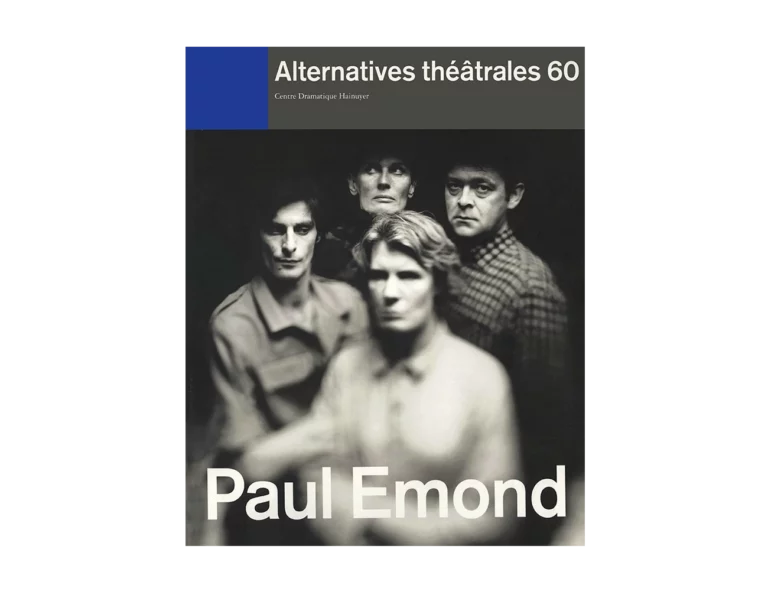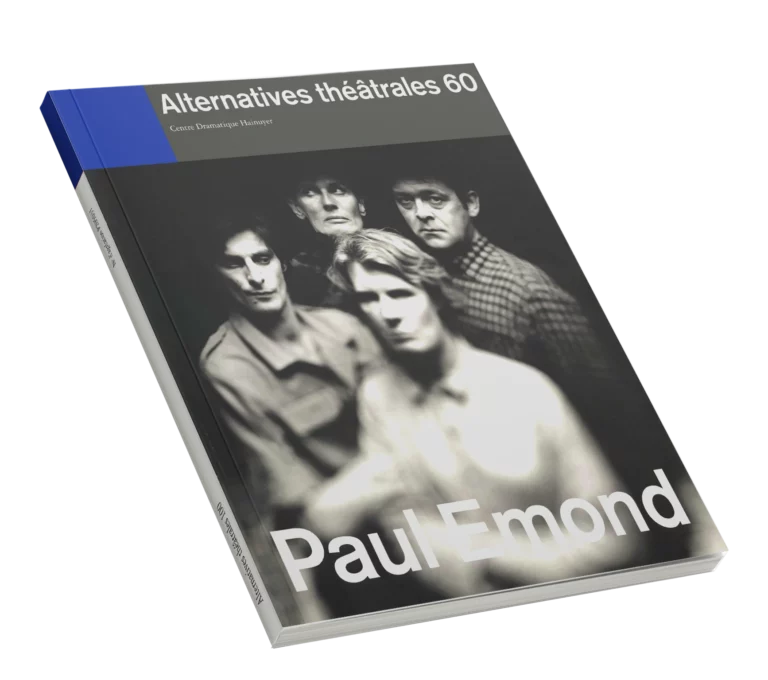« Pour que les audaces de la recherche novatrice ou révolutionnaire aient quelques chances d’être conçues, il faut qu’elles existent à l’état potentiel au sein du système des possibles déjà réalisés, comme des lacunes structurales qui paraissent attendre et appeler le remplissement, comme des directions potentielles de développement, des voies possibles de recherche. »
Pierre Bourdieu.
« Toute primauté est silencieusement empêchée. Tout ce qui est original est aussitôt aplati en passant pour bien connu depuis longtemps. Tout ce qui a été conquis de haute lutte devient objet d’échange. Tout mystère perd sa force. »
Martin Heidegger.
LE THÉÂTRE DES ANNÉES 90, ronronnant et bientôt bien pensant, semble condamné à une alternative : le spectacle de maître ou la production médiocre. Entendons-nous bien : « médiocre » ne signifie pas ici « mauvais », mais plutôt : « commun », « déjà vu », « auto-référencé », « itératif », une répétition en arrière, un « nivellement de toutes les possibilités d’être »1. Seules des mises en scène telles, par exemple, le dernier SERVITEUR de Strehler (1997 – 98), ou la dernière version de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON de Chéreau (1995 – 96), semblent encore capables de mettre à mal, pour son plus grand profit, l’acte théâtral. Il y a quelque chose de la représentation dramatique qui ne vit plus, quelque chose de si confortablement établi dans l’esprit de tous — c’est-à-dire, rappelons-le, d’une minorité — que plus personne ne songe à l’interroger, encore moins à le remettre en jeu.
L’histoire et la sociologie permettent de comprendre une telle situation. Car, ce qu’il s’agit de saisir, ce sont les raisons pour lesquelles Le sous-champ du théâtre n’est plus traversé par les mouvements et les tendances qui animent habituellement le champ artistique.
Le sous-champ du théâtre et l’espace des possibles
Dans un champ artistique, les règles sont fixées par les anciens. Et, lorsqu’un nouveau entre dans le champ, deux possibilités s’offrent à lui : ou bien, accepter les règles du jeu et les enjeux que celles-ci recouvrent, s’y conformer et y exceller, c’est-à-dire reconnaître les anciens comme ses pairs, pour être, à son tour, reconnu par eux ; ou bien, rejeter les règles établies et en proposer d’autres, de sorte que l’ensemble du champ s’en trouve modifié — le « Salon des refusés » devenant le véritable « salon », celui autour duquel le sous-champ de la peinture est conduit à se réorganiser. Cette deuxième attitude définit l’avant-garde : « l’action subversive de l’avant-garde discrédite les conventions en vigueur, c’est-à-dire les normes de production et d’évaluation de l’orthodoxie esthétique, faisant apparaître comme dépassés, démodés, les produits réalisés selon ces normes. »2
Émules et avant-gardistes ont un rôle dynamique et complémentaire eu égard au bon fonctionnement du champ. Comme les deux mains d’un même corps, ils permettent d’embrasser dans son entier l’espace des possibles : les premiers (ceux qui acceptent leurs pairs et sont acceptés par eux) parce qu’ils entretiennent les acquis et les lacunes structurales du champ ; les seconds (ceux qui refusent la filiation directe et entendent s’en démarquer) parce qu’ils élargissent, en la renouvelant, la pratique artistique, et par là, la sauve de l’effet d’usure. Car, lorsque l’avant-garde s’en prend à la tradition (l’orthodoxie esthétique), elle le fait au nom d’une autre tradition, qu’elle considère comme plus pure, plus originelle.
De même, dans le champ scientifique, la modification du paradigme dominant ne peut être effectuée que par des nouveaux entrants désireux de le contester3. Au contraire, dans le sous-champ du théâtre (partie intégrante du champ artistique), les choses ne se déroulent pas de la sorte. Ceux qui, dans cet espace social particulier, bénéficient d’un fort capital symbolique spécifique et d’un degré d’autonomie élevé, les metteurs en scène, directeurs artistiques et comédiens travaillant dans de grandes institutions publiques (Théâtres nationaux, Scènes nationales, Centres dramatiques nationaux, etc.) manifestent leur scepticisme à l’endroit de l’avant-garde. Un spectre taraude les esprits : rares sont ceux qui voient d’un bon œil les expériences contestataires menées au cours des années 70.
C’est que ces mouvements n’ont finalement pas fait date. Le besoin de rupture l’a emporté sur Le désir de transformation. Le positionnement contre la doxa dominante a été si radical qu’il s’est accompagné d’un refus de connaître l’histoire propre du champ et, en premier lieu, « les tentatives antérieures de dépassement qui sont passées dans l’histoire du champ ». Une telle posture ne pouvait manquer d’apparaître comme naïve, et Les propositions qui en découlaient comme nulles et non avenues, ou, pour le moins, inintéressantes. Nombre de ces tentatives sont restées d’éphémères micro-révolutions — trop ponctuelles, parce que trop coupées des réalités du théâtre, elles n’ont pas joué le rôle qui leurs était imparti : déplacer les règles de l’art — la façon de faire, et les raisons d’en faire.
Seulement, cette tentative manquée pour constituer, non pas une révolution de champ, mais, plus simplement, une avant-garde, est perçue aujourd’hui, par les tenants de la doxa théâtrale, comme la preuve de l’inutilité, de l’inefficience et de l’inanité de tout mouvement d’avant-garde. Les tenants de la doxa oublient là le rôle déterminant joué par la dernière véritable avant-garde, à savoir le Nouveau Théâtre, au cours des années 50. On ne peut contester le caractère abâtardi de l’avantgarde des années 70, mais l’on ne doit pas faire de ce caractère une caractéristique essentielle (en un sens husserlien) de l’avant-garde. La critique justifiée d’un mouvement abâtardi ne peut servir de base à une définition correcte de la notion. Or, c’est pourtant ainsi qu’est appréhendée, aujourd’hui, l’avant-garde théâtrale. Pour exemple d’une telle erreur de perception, cet article du Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre : « I] ne faut pas confondre le théâtre d’avant-garde qui a vocation de reconnaissance publique, mais à retardement, ni avec les tentatives de renouvellement des formes théâtrales plus ou moins bien accueillies au moment de leur apparition (celles d’un Copeau, d’un Pitoëff, d’un Baty), ni avec le théâtre expérimental ou de recherche (comme ce fut le cas du Laboratoire Art et Action et à un moindre degré, à l’étranger, du Laboratoire de Grotowski) qui, refusant d’entrée la notion même de spectacle, se situe en dehors de l’activité visible du théâtre. »4
La distinction opérée entre « théâtre d’avant-garde » d’un côté et « tentatives de renouvellement des formes », « théâtre expérimental ou de recherche » de l’autre, est inopérante d’un point de vue sociologique. Plus encore, elle révèle les enjeux de la constitution du « théâtre d’avant-garde » en genre esthétique. Cette classification participe d’un même désir (qu’il soit formulé ou inconscient, peu importe) de disqualifier la tendance avant-gardiste. Si l’on extrait la notion de la perspective classificatoire esthétique, et qu’on lui évite ainsi un discrédit non fondé, force est de reconnaître que l’avantgarde est bien plutôt une posture dynamique à l’intérieur du champ théâtral, et qu’à ce titre elle participe tout autant du désir de reconnaissance ultérieure que d’une volonté de recherche et de renouvellement. À chaque état du champ correspond une, voire plusieurs, possibilité(s) d’avant-garde. Et, si chaque manifestation du phénomène est éminemment historique, le sens générique de la notion, est, quant à lui, anhistorique.
Histoire et paradoxe
On a coutume d’opposer à la notion d’avant-garde, celle de Théâtre d’Art. Cette distinction se voit fondée, dans la pratique, par la différence que l’on a pu observer entre l’attitude d’un Strehler ou d’un Chéreau, par exemple, et la posture adoptée par les contestataires des années 70. À la différence des seconds, les premiers insistaient sur la nécessité de réformer le théâtre de l’intérieur, à partir de ce que la tradition proprement théâtrale offrait comme possibilités. Les metteurs en scène se revendiquant implicitement, ou explicitement, du Théâtre d’Art, entendent, aujourd’hui plus que jamais, œuvrer à une modification lente et profonde de l’acte théâtral — d’où leur méfiance particulière à l’endroit de la rupture instantanée, pour eux superficielle et éphémère.
Les raisons d’un tel découpage sont, une fois encore, historiques. Car la situation actuelle du sous-champ du théâtre est directement héritée de la révolution opérée à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième par Paul Fort, Antoine, Lugnée-Poe, Stanislavski, etc. Le metteur en scène, ce nouvel acteur social apparu alors, est, maintenant encore, au centre du jeu et des enjeux de l’univers théâtral. De même, la crise du drame dans les années 1880 – 1910, telle que l’a décrite Peter Szondi, a soulevé des interrogations qui sont encore au travail aujourd’hui : déconstruction du dialogue et du héros, monologue intérieur, épicisation de la forme dramatique, etc. C’est parce qu’elle méconnaissait, ou refusait de reconnaître, cette double problématique, que l’avantgarde des années 70 s’est, d’elle-même, disqualifiée, et qu’à l’inverse, parce qu’il reprenait en la questionnant, cette même problématique, le Nouveau Théâtre a marqué profondément, en la modifiant, l’écriture dramatique. Il semblerait donc, que l’«on n’a pas encore épuisé Les possibilités inscrites dans la grammaire de la mise en scène instituée par Antoine »5. Le temps de maturation serait, au théâtre, plus long et plus douloureux qu’ailleurs.