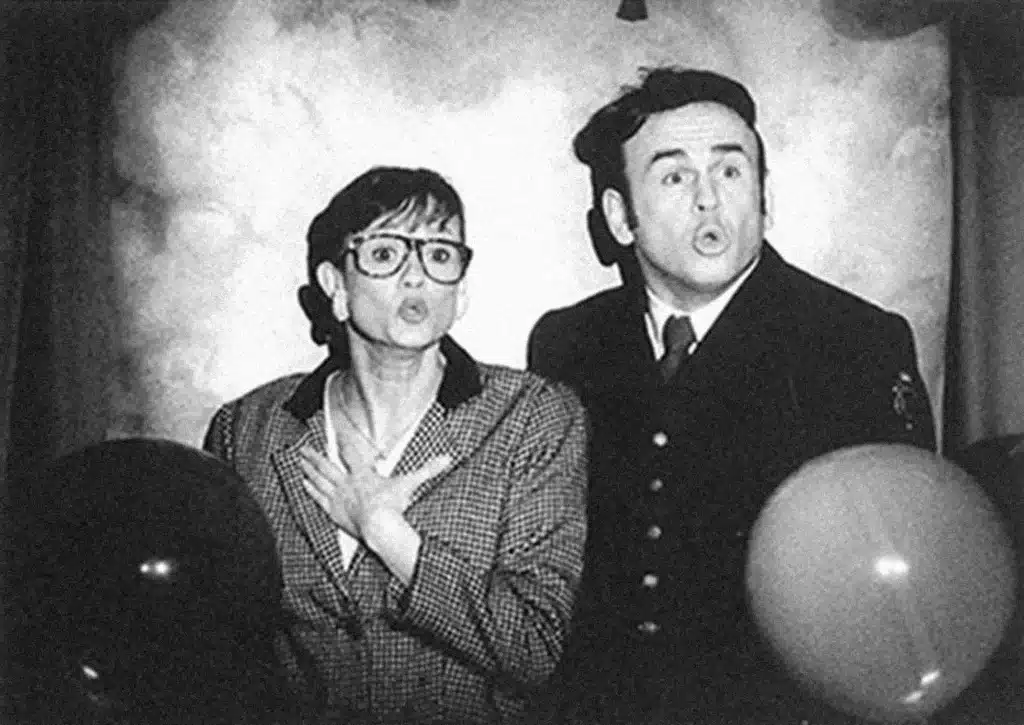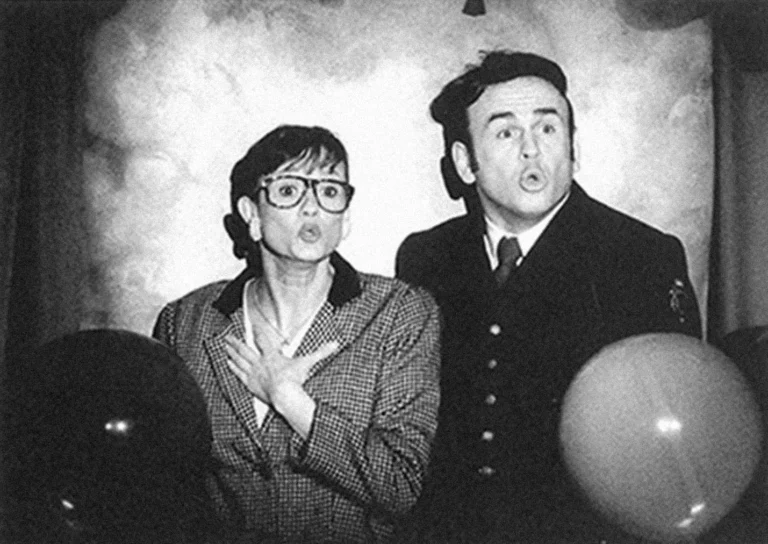ALTERNATIVE THÉÂTRALES : Comment s’est déclenchée chez vous l’écriture théâtrale ?
Roland Fichet : Avant l’écriture théâtrale y a‑t-il l’écriture ? L’écriture nouée au théâtre laisse une double trace, dans l’oreille et sur le papier. Dans le corps et sur le papier. A‑t-elle une double origine ? Pour moi c’est probable. Une double origine et une origine trouble. L’écriture surgit-elle d’une secousse intime particulière ? Oui. Peut-on identifier cette secousse ? Je n’en suis pas sûr. C’est une secousse qui dure, ça je peux le dire, je crois.
Si je me laisse tirer par la manche, si j’entre dans le jeu d’une sorte de micro-légende autobiographique, Je suis tenté d’aller chercher l’origine de l’écriture chez moi dans le théâtre rugueux de mon enfance paysanne. J’ai vécu les onze premières années de ma vie immergé dans un monde archaïque ; je partageais les rites et le mode de vie d’une communauté/toile d’araignée tissée par les rapports familiaux, les fêtes populaires, le dialogue , avec les animaux. À onze ans j’ai été retranché de cette communauté/village et catapulté dans un autre monde, le monde du latin et du grec. Désigné pour les « missions étrangères », invité à errer, un peu perdu, je me suis acccroché aux mots, aux signes ; privé de ma terre d’origine, le texte est devenu ma terre d’élection. Je me sens toujours dans cette coupure, dans cet écartèlement, dans cette faiblesse. Du jour au lendemain je suis devenu faible et écrivant. Dans cette coupure, dans cette question sans réponse, s’est enracinée, je crois, la pulsion d’écriture qui m’habite ; et son inséparable sœur, la pulsion de lecture. L’écriture s’est déclenchée chez moi et continue de me tenir parce que tout est énigme.
A onze ans, l’épreuve du deuil et la stupeur devant l’émergence subite de la mémoire en moi m’ont été données d’un seul coup ; à trente-trois ans, écrivant DE LA PAILLE POUR MÉMOIRE, j’ai choisi l’écriture comme passage, comme errance apaisée aux pays des monstres qu’on n’apaise jamais. L’écriture est liée pour moi
à la résurrection. Sans doute pourrais-je reprendre à mon compte la phrase d’un de mes personnages, Lazare, à la toute fin de TERRES PROMISES «:Je suis né mort je voudrais mourir vivant. »
Oui mais l’écriture théâtrale ça vient d’où ? Ça s’inscrit comment dans le corps d’un écrivant ? Une petit voix me dit que, confronté à une telle question, je ne peux ignorer la langue, le poids de la langue. La langue insiste. Là aussi la séparation marque mes débuts affolés dans le filet sans limites des mots. La langue dans laquelle j’ai baigné, enfant, ne s’écrit pas, c’est à peine un idiome, plutôt un « parler » — on désigne ainsi quelques branches bâtardes de la langue noble, le français d’Île-de-France. Le « parler gallo » dans lequel j’ai fait mes premières armes d’être parlant défie donc l’écriture. Il se parle, s’entend, fait même beaucoup de bruit, mais oblige celui gui veut l’écrire à de multiples micro-déplacements dans la matière même des mors, dans la syntaxe, dans l’architecture des phrases. Il y a beaucoup de corps dans une langue gui laisse avant tout une trace sonore. Je n’ai pas choisi d’écrire en « langue gallèse », j’ai tout fait au contraire pour fuir sa sauvagerie et m’inscrire dans l’héritage littéraire charrié par le français-français, mais j’ai continué d’entendre deux langues dans mon oreille. Le goût des mots qu’on « entend », le réflexe de cheviller les mots avec les corps me viennent peut-être de cette langue gallèse blessée, mal rabotée, mais aussi secouée par la comédie. Pour moi les mots ça joue. Pour moi la poésie et le jeu ça va ensemble, ça danse naturellement ensemble. Dans les champs, dans la rue, et sur une scène de théâtre. Héritage celte ?
A. T : Comment s’établit la relation entre l’auteur et le directeur du Théâtre de Folle Pensée ?