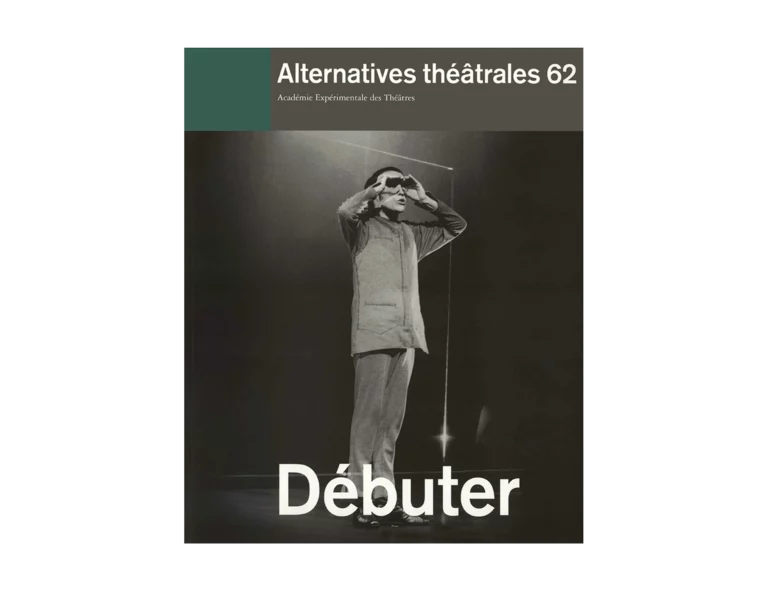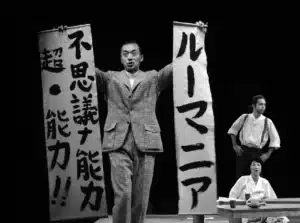GEORGES BANU : Le début est une période où les séparations n’ont pas encore eu lieu, où — si les identités des différents artistes s’affirment — les ruptures ne sont pas toujours évidentes. Aujourd’hui les artistes qui affirment une sorte de credo spontanéiste sont de plus en plus rares, pour reprendre la formule de Grotowski : « chacun sait qu’il est le fils de quelqu’un ». Chaque artiste a un point de repère qui le précède, qui peut être un homme de théâtre, mais aussi un artiste chorégraphe, plasticien ou performer…
Il s’agit aujourd’hui d’interroger des gens de théâtre au moment de leur émergence, de leur demander comment définissent par rapport à ceux qui les précèdent, avec quelles personnalités ils entretiennent des rapports privilégiés.
Je crois aussi qu’on pourra parler d’une filiation non pas directement personnalisée mais pour ainsi dire de formation, car parmi les jeunes artistes, nombreux sont ceux qui viennent de l’École de Chaillot créée par Antoine Vitez et de celle initiée par Didier-Georges Gabily. Ec si l’on pose la question de la filiation, il faut inévitablement soulever également celle de
la rébellion. Meyerhold n’est-il pas le véritable héritier de Stanislavski, car l’héritier rebelle par excellence ? La rupture s’inscrit, je crois, dans la logique de la filiation. Je demanderai d’abord à nos invités de bien vouloir se présenter et se situer dans cette problématique de la filiation.
Philippe Chemin : Ma dernière mise en scène MATÉRIAU HEINER MÜLLER, je l’ai présentée ici même à la Cité Internationale. C’était le fruit d’un travail de deux années que j’avais commencé sur l’invitation de l’École Régionale des Acteurs de Cannes, avec les élèves de dernières années, puis présenté au Festival Nouvelles Scènes à Dijon. C’est là que Nicole Gautier a vu le spectacle et m’a alors invité.
Ma première mise en scène, PAYSAGE, je l’ai faite dans un endroit disons alternatif : à l’Hôpital éphémère. C’était un spectacle autobiographique qui racontait une expérience dans un pays étranger qui m’avait marqué comme un cauchemar.
Pour en revenir à la question de la filiation, la mienne est à la fois de formation et personnalisée : j’ai suivi une formation auprès de Daniel Mesguich qui sortait du Conservatoire. J’ai longuement travaillé avec Robert Wilson en tant qu’acteur, assistant et dramaturge.
Le premier spectacle de Robert Wilson que j’ai vu s’appelait I WAS SITTING ON MY PATIO, THIS GUY APPEARED, I THOUGHT I WAS HALLUCINATED, et, pendant la représentation, j’ai cru avoir des hallucinations : les questions essentielles me semblaient posées, elles me renvoyaient à mon univers personnel.
Ce spectacle a joué le rôle de déclencheur dans mon choix de faire du théâtre : j’étais jusque là beaucoup plus proche du cinéma et j’ai alors compris que seul le théâtre pouvait troubler instantanément si intensément. J’ai ensuite rencontré et travaillé avec Robert Wilson et j’ai
appris de lui l’artisanat du théâtre pendant les seize années que j’ai passées à ses côtés.
François-Xavier Frantz : J’ai fait des études de plasticien aux Beaux-Arts de Metz. Parallèlement, j’ai travaillé dans le festival de musique contemporaine de la même ville et comme comédien dans une compagnie, À la fin de mes études, sur la création de LA RECONSTITUTION de Bernard Noël, mis en scène par Charles Tordjman, j’ai rencontré Daisy Amias qui montait Sénèque pour la première fois en France, PHÈDRE au T.G.P. Je suis devenu son assistant pendant cinq ans, notamment sur ANDROMAQUE en Corée. Ces cinq années ont été pour moi un choc entre le monde théâtral parisien (et ses contradictions) et la passion dévorante de Daisy Amias. Dans le même temps, j’ai fait une dizaine de mises en scène, de Fassbinder à Werner Schwab. J’ai pris la position de l’Apprenti. Considérant chaque mise en scène comme une école de la patience et de la passion, grâce à la fidélité d’un groupe de dix comédiens.
Par le biais de l’Académie Expérimentale des Théâtres, j’ai pu rencontrer et voir travailler ou dialoguer Luca Ranconi à Turin, Grocowsk : à Pontedera, Vassiliev à Moscou, c’est-à-dire sur leur lieu de travail. Ces rencontres et d’autres sur une dizaine d’années m ont permis de préciser des outils et directions de travail. Je m’étais donné dix ans pour « apprendre à commencer ».
Parce que l’exigence artistique coûte cher en temps et à ce point de mon parcours, il me paraît plus juste d’aller à la rencontre des institutions pour obtenir un éventuel soutien — ce que je m’étais toujours refusé à faire en tant qu’apprenti.
Ludovic Lagarde : J’ai également commencé le théâtre par hasard. J’étais étudiant en lettres à Censier et j’ai vu qu’il y avait un groupe de théâtre au sein de la faculté. Je m’y suis inscrit et j’ai décidé de continuer dans cette voie.
J’ai été ensuite élève à l’école de Lucien Marchal qui s’appelait « Théâtre en Actes ». Au bout des trois années d’études, j’ai rencontré Christian Schiaretti dont je suis devenu l’assistant.
J’ai passé quatre années à ses côtés, dont trois à la Comédie de Reims dont il était le directeur, réalisant entre temps mes premières mises en scène : TROIS DRAMATICULES de Beckett au Théâtre Granit de Belfort, L’HYMNE de Gyorgy Schwajda à la Comédie de Reims,
LE PETIT MONDE de Courteline au Channel de Calais, SŒURS ET FRÈRES d’Olivier Cadiot — à qui j’avais fait une commande d’écriture — puis PLATONOV et IVANOV de Tchékhov, et dernièrement LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN de Brecht et LE COLONEL DES ZOUAVES d’Olivier Cadiot. Mon parcours commence donc par un cheminement avec le théâtre du Granit de Belfort et une collaboration avec un auteur, Olivier Cadiot, avec lequel je continue à travailler. J’ai fondé ma propre compagnie à Paris il y a deux ans.
Christophe Lemaître : J’ai une formation d’acteur très classique qui passe par l’école du T.N.S. Mais après avoir été acteur professionnel pendant cinq ans, j’ai eu envie d’autre chose, de donner un sens véritable à mon travail. J’ai alors commencé à diriger des ateliers avec des psychotiques, avec des adolescents, et fait parallèlement mes premiers spectacles en commençant par une mise en espace de MAUX D’AMOUR OU LES MALICES DE LA LUNE de Françoise du Chaxel. J’ai réalisé l’année dernière mon premier vrai spectacle HAUTE AUTRICHE au Théâtre du Muselet à Châlons-en-Champagne.
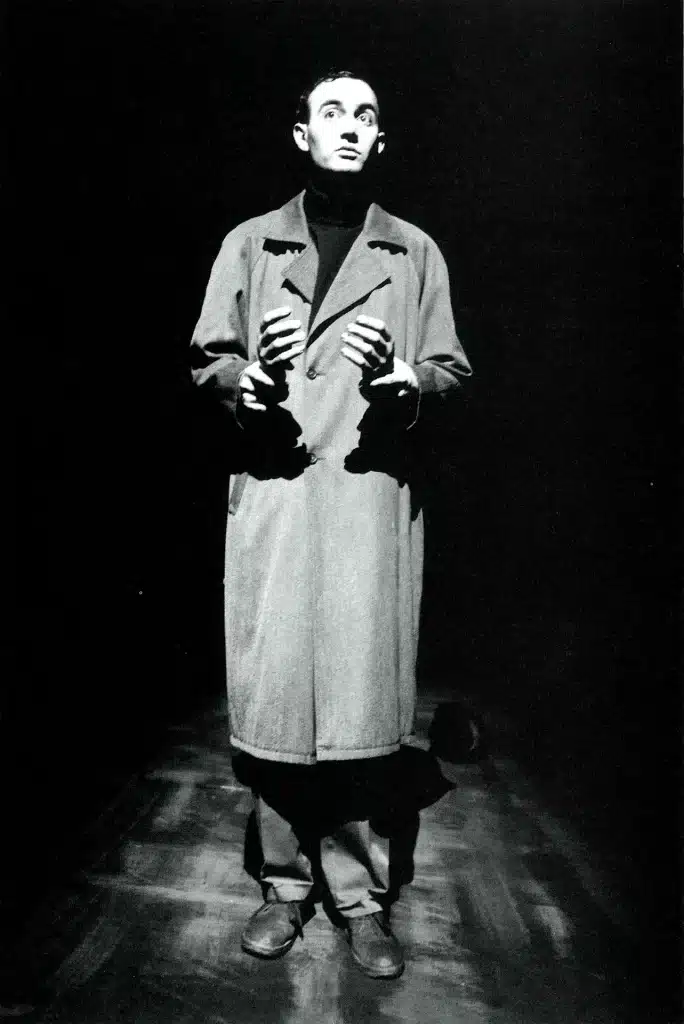
Serge Tranvouez : J’ai également une formation d’acteur, j’ai fait l’INSAS à Bruxelles, puis j’ai travaillé en tant qu’acteur principalement en Belgique et en Suisse où J’ai fait la rencontre d’André Steiger. Mais j’ai très vite été insatisfait de la façon dont se déroulait mon travail : Je participais pleinement à un projet pendant trois mois et puis l’équipe se séparait, chacun disparaissant vers un autre horizon. J’avais au contraire envie de constituer une famille.
J’ai eu l’occasion d’être assistant- stagiaire sur un spectacle de Vitez, LE MARIAGE DE FIGARO. J’étais sûr que cette rencontre serait déterminante. Elle l’a été, mais pas où je le croyais : j’ai fait la rencontre déterminante de Vitez bien sûr, mais aussi celle des élèves de la dernière promotion de Chaillot et, grâce à eux, celle de Didier-Georges Gabily avec qui nous avons fondé le groupe Tchan’g. Nous avons fait deux ans de travail d’atelier qui a abouti à un spectacle écrit pour nous par Gabily, VIOLENCE, créé 1ci à la Cité Internationale. Mes débuts sont très liés à cette maison, Car ma première mise en scène, c’est aussi ici que je l’ai faite. Après avoir vécu l’aventure du groupe Tchang pendant quelques années, je me suis senti apte à prendre en charge un projet et je l’ai engagé avec des acteurs qui étaient issus de cette mouvance-là : nous avons travaillé et présenté devant des professionnels à la Cité Internationale un travail sur PARTAGE DE MIDI de Claudel repris dans le même lieu un an et demi après à cause de problèmes de droits. J’ai ensuite clos un premier volet de mon parcours avec la lourde, trop lourde, mise en scène de L’ORESTIE au Théâtre des Amandiers. Ensuite Stanislas Nordey m’a proposé de devenir metteur en scène associé du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis ; j’étais tellement emballé par le projet que j’ai tout de suite accepté. Le travail de toute une année a abouti à deux créations:LE MONOLOGUE D’ADRAMELECH de Valère Novarina où Catherine Epars me mettait en scène et GAUCHE UPPERCUT de Joël Jouanneau créé en décembre 1998. C’est un projet autour de la jeunesse, de la violence urbaine, qui se rattache thématiquement à toute l’aventure de Saint-Denis.
Joël Jouanneau m’a accompagné tout le long de mon parcours de metteur en scène : il m’a aidé, comme Nicole Gautier à monter mon premier spectacle et nous avons plusieurs fois co-mis
en scène des spectacles tant au T.N.S. (LÈVE-TOI ET MARCHE d’après Dostoïevski) qu’à Théâtre Ouvert autour d’un texte de Jacques Serena, RIMMEL.
Mais en racontant mon parcours, j’oublie une filiation essentielle, celle que j’appelle en reprenant un expression de Vitez«l’école du regard » je me suis constitué par la vision d’un certain nombre de spectacles qui ont été pour moi fondateurs. Ce sont mes premiers pères.
Sarah Franco-Ferrer : j’ai une formation de comédienne et je travaille beaucoup avec un monsieur qui s’appelle Armand Gatti et des personnes qui se trouvent dans des situations extrêmement précaires. J’ai commencé la mise en scène en 1996 en montant un texte d’Armand Gatti QUATRE SCHIZOPHRÉNIES À LA RECHERCHE D’UN PAYS DONT L’EXISTENCE EST CONTESTÉE.
J’ai également fait quelques films documentaires. J’ai donc un parcours un peu particulier qui oscille entre la langue théâtrale et celle du film. Je poursuis aussi mon travail avec Gatti avec qui je viens de terminer un spectacle qui s’appelle L’ÉTÉ INDIEN dont le thème était l’indianité, la guérilla ; et juste avant nous avions travaillé sur la Résistance et la mécanique quantique autour de la figure de Cavaillès.
Gloria Paris : Pour faire du théâtre, j’ai quitté l’Italie et suis venue en France. J’ai commencé à faire de la mise en scène par hasard, si l’on peut dire, car alors que j’étais assistante à la mise en scène de Mario Gonzalès, une des comédiennes m’a proposé de monter avec elle LES FEMMES SAVANTES au sein du J.T.N. dont elle faisait partie. Le geste de la mise en scène n’a donc pas été pour moi le fruit d’une démarche volontaire.
Or il s’est trouvé que ce spectacle a très vite trouvé une production, une grosse tournée d’un an, puis on l’a repris. Cela nous a permis de faire un autre spectacle, LA FAUSSE SUIVANTE de Marivaux que j’ai cette fois mis en scène toute seule. Je viens aujourd’hui de terminer ma troisième mise en scène, HEDDA GABLER d’Ibsen, que j’ai présentée à la Comédie de Picardie.
Il m’a donc fallu à peu près quatre ans pour me rendre compte que j’étais faite pour le métier de metteur en scène. Ce sont les autres qui m’ont désignée et si je réfléchis aujourd’hui à la question de la filiation, je crois avoir plusieurs pères : des pères techniques, des pères spirituels, des mères aussi.
Marc-Ange Sanz : Je suis arrivé au théâtre tardivement : J’ai une formation d’ingénieur. Je me suis aperçu un peu tard que je n’étais pas fait pour ça, trop tard en tout cas pour passer des concours. Je me suis alors inscrit dans une école formidable, à l’écoute de la cité, le Théâtre-école de Montreuil. J’y ai passé trois ans au bout desquels je suis devenu animateur : j’ai finalement rejoint l’autre côté de la barrière et j’ai aussi dû faire l’apprentissage des responsabilités de la mise en scène. Pour pouvoir réussir à travailler avec les gens qui m’intéressaient, j’ai décidé de fonder un groupe, « L’empreinte et Cie ». Ce qui est difficile, c’est de rencontrer des gens avec qui on a de réelles affinités, et je dirais que mes pères ce sont les gens avec qui je travaille, qui animent mes projets et me nourrissent. Après quelques années passées à Paris, nous avons décidé de nous réfugier en banlieue mais malgré nos résistances, nous avons aussi dû quitter ce second lieu. De cette expérience est issu un spectacle qui s’appelait UN PUR MOMENT DE ROCK’N ROLL écrit par Vincent Ravalec. Il s’agissait de rendre compte de cette période où nous avions essayé de nous inscrire dans un territoire. Avec ce spectacle, l’institution s’est subitement rendue compte que nous existions. Cela faisait pourtant dix ans que l’on produisait ! Nous avons alors été invités en résidence au Théâtre Populaire de Lorraine puis à la Scène nationale de Forbach. Notre théâtre essaye aujourd’hui d’investir le réel:nous voudrions essayer de rendre compte de ce que sont les « marges » de la société sur un plateau. Les marges, ce sont aussi bien les cités que les vieux ou les malades : et les auteurs dont nous portons les textes sont strictement contemporains : Vincent Ravalec, Michel Azama, Jean-Louis Bourdon, Peter Turrini, ou Franz Xaver Kroetz.
Renaud Cojo : La première fois que j’ai fait du théâtre, c’est parce que, un jour, j’ai refusé de sauter. J’étais dans une école privée à Bordeaux qui possédait un théâtre à l’italienne style art-déco ; on n’y faisait pas du théâtre mais du sport : les profs de gym l’avaient réquisitionné. On y faisait du cheval d’arçon, de la corde à nœuds. Mais un jour le prof de sport nous a demandé de sauter du balcon sur un tapis de réception à l’orchestre ; je l’ai fait et je crois que ça m’a complètement traumatisé. Et en plus on allait le refaire toutes les semaines ; j’avais deux solutions : soit me porter absent à tous les cours, soit faire en sorte que cette salle redevienne un lieu de théâtre et ne serve plus à faire du sport. Deux, trois élèves et moi sommes allés aussitôt voir les directeurs de l’école avec un projet, celui de monter LE MÉDECIN MALGRÉ LUI de Molière. Et le jeudi suivant des ouvriers installaient des sièges dans la salle ; on a fait du sport dehors. Après ce début, nous avons continué à travailler jusqu’au jour où l’on nous a proposé de participer à un Festival dans la banlieue bordelaise, les Chantiers de Blaye. À cette époque j’étais tombé amoureux d’un texte qui proposait une série de définitions d’animaux imaginées par des déficients mentaux d’un centre d’aide par le travail. Nous en avons fait un spectacle, LES TAXIDERMISTES, que Nicole Gautier a vu et invité à la Cité pour un mois de représentations.
Je crois que la filiation géographique est importante et si nous n’avions pas eu la chance de jouer à la Cité, je crois que je serais toujours à Bordeaux en train peut-être de sauter de tous les balcons des théâtres ! Après ce spectacle créé en 1992, j’ai fait quatre autres mises en scène, MAÏAKOSKI NUAGE TOUR d’après LE NUAGE EN PANTALON de Maïakovski, WHAT IN THE WORLD ? que j’avais écrit en faisant des colonnes remplies de choses vues et entendues et qui était au départ une proposition scénographique, mélée à l’art vidéo, LOLICOM TM, un spectacle axé sur l’esthétique du Manga japonais et plus généralement des cultures de masse où la vidéo avait aussi une place très importante, créé au C.D.N. de Bordeaux, enfin POUR LOUIS DE FUNÈS de Valère Novarina au Théâtre de la Bastille. Je ne crois pas avoir de pères, ni avoir jamais souhaité travailler avec quelqu’un, recevoir son enseignement. C’est en ce sens que je me considère comme un escroc : je m’auto déclare metteur en scène sans avoir reçu l’assentiment d’aucun maître. Je considère la filiation plutôt du côté des gens ou structures qui accompagnent ma démarche artistique, le théâtre d’Angoulême, par exemple.
Ricardo Lopez-Muñoz : J’ai une formation d’informaticien et j’ai toujours été un spectateur de théâtre assidu. J’ai eu un jour envie de pratiquer le théâtre et j ai ouvert les pages jaunes pour choisir un cours privé. Mais jouer s’est très vite avéré quelque chose d’impossible pour moi. Par contre j’ai senti tout de suite le plaisir de mettre en scène les autres.
À la fin de ma formation d’acteur j’ai réuni un certain nombre de copains acteurs et on a monté BARROUF À CHIOGGIA de Goldoni que l’on a joué plus de cent fois.Jean-Claude Penchenat a vu le spectacle et m’a demandé d’être metteur en scène associé au C.D.N. Théâtre du Campagnol s’installant à l’époque à Corbeil-Essonnes. J’y suis resté deux ans. Après quoi plusieurs mises en scène ont suivi et tout récemment KINDERZIMMER de Gilles Boulan.
Il me semble important de travailler avec des auteurs vivants comme de faire des stages avec des acteurs non-professionnels. C’est ma filiation en acte !
Frédéric Fisbach : J’ai suivi un parcours de comédien classique commençant le théâtre au lycée, puis dans une troupe de théâtre amateur, suivant les cours de l’École de la rue Blanche puis ceux du Conservatoire où j’ai travaillé notamment avec les acteurs Madeleine Marion et Pierre Vial, rencontré Stanislas Nordey, et un auteur, Pasolini. Je suis sorti du Conservatoire en 1990 et j’ai travaillé sur Pasolini pendant les trois années suivantes au Théâtre Gérard Philipe où j’étais en résidence. Il se trouve que je n’étais pas du tout préparé à cela, mais dès ma sortie du Conservatoire je me suis retrouvé à faire du théâtre aussi bien en tant qu’acteur qu’en animateur de stages, et il est devenu très vite évident pour moi que faire du théâtre dans une école, dans un conservatoire municipal ou sur le plateau du T.G.P. était une seule et même chose.
Je ne me considère pas plus comme un metteur en scène que comme un acteur, j’ai simplement une pratique qui m’aide à cerner ce qu’est le théâtre ou plutôt mon désir de théâtre. Mais il est vrai que depuis deux ans, j’ai plutôt le regard du metteur en scène. J’ai commencé la mise en scène en fin de compte très tôt après le Conservatoire dans de petites formes souvent méprisées : le théâtre pour enfants, le théâtre hors les murs —désormais très à la mode — le théâtre avec les amateurs, qui mélange amateurs et professionnels, mais aussi du théâtre dans le théâtre — j’ai mis en scène deux textes issus d’un travail avec les acteurs, l’un était issu d’un travail que Stanislas Nordey avait fait sur TABAC-TABAC de Koltès et l’autre qui s’appelait UNE PLANCHE ET UN ACTEUR et qui faisait parler deux acteurs de leur désir de théâtre. Ce spectacle nous l’avons tourné en Creuse, sur l’invitation de quelqu’un tout comme j’ai commencé la mise en scène sur l’invitation de Stanislas Nordey. Pour moi, c’est un chose importante : je n’ai jamais eu le désir d’être metteur en scène, j’éprouve seulement la nécessité de faire du théâtre dans la légèreté. Il faut que les choses se passent facilement et si c’est compliqué, ça m’ennuie, donc je m en vais.
Je travaille actuellement sur trois grands auteurs : Platon, Kafka et Strindberg et je m’apprête à mettre en scène un texte d’un jeune auteur américain Bary Hall À TROIS avant de m’attaquer à TOKYO NOTES de l’auteur japonais Oriza Hirata.
Georg-Maria Pauen : J’ai commencé le théâtre à Berlin, mais je m ennuyais. On m’a conseillé d’aller en France. Je suis alors parti suivre l’École de Lecoq avant d’aller en Espagne où j’ai fondé une compagnie, puis en Belgique et en Italie.
Je suis ensuite retourné à Berlin où j’ai rencontré des acteurs américains plutôt dans la mouvance Dance-Mouvement avec qui j’ai continué à travailler à New-York. J’ai rencontré là-bas des Français dont Evelyne Didi qui m’a invité au Théâtre de l’Athénée et proposé de mettre en scène DIDASCALIES. C’était le moment des APA (artistes et produtceurs associés). Ils avaient décidé qu’ils n’avaient plus besoin de metteurs en scène, mais, moi, 1ls m ont toléré, pourquoi je n’en sait rien. Beaucoup de grands noms intervenaient comme Bob Wilson etJean Jourdheuil, alors je n’ai pas osé dire que j’avais réalisé une mise en scène ; J’ai dit : mise en jeu. Après quoi, je suis retourné à Berlin mettre en scène des spectacles où Je mélangeais les différentes nationalités.
J’avais décidé de monter mes propres productions et je me suis rendu compte que cela prenait autant de temps que de faire un film — deux ans — pour finalement ne jouer que trois semaines tout au plus. J’ai ensuite monté un Gatti en Allemagne, puis je suis allé travailler en Europe de l’est, à Siblu en Roumanie où l’on a créé LA MISSION d’Heiner Müller, après quoi j’ai arrêté de faire de grands spectacles. J’ai décidé d’arrêter de courir derrière les producteurs et de me consacrer à la direction d’acteurs.
J’ai alors commencé un travail de recherche avec des acteurs à Paris qui dure depuis deux ans. L’un des aboutissements de ces recherches, HAMLET, MISE EN JEU, a été montré à la Cité Internationale.
Benoît Bradel : Dès mes quinze ans, j’ai voulu faire de la mise en scène. Et comme il n’existe pas d’école, j’ai décidé d’apprendre le théâtre par tous les bouts. J’ai eu la chance d’entrer peu après au Théâtre du Campagnol qui n’était pas encore Centre Dramatique National.
Une grande liberté y régnait. J’y ai appris beaucoup de choses : à faire la régie, les lumières, les décors, à déchirer les billets, à faire l’acteur aussi. Ça m’a aussi permis de me rendre compte concrètement que ce qui m’intéressait, c’était d’être à l’origine des spectacles. Il m’a fallu dix ans pour arriver à affirmer ce désir et à le concrétiser. La première opportunité qui s’est présentée à MOI dans l’institution, ce sont Jean-François Peyretet Sophie Loucachevsky qui me l’ont offerte. Ils s’occupaient d’une aventure au Petit Odéon qui s’appelait Théâtre feuilleton : pendant un an et demi on leur a confié le lieu. Les metteurs en scène, les auteurs et les acteurs venaient sans cesse discuter au théâtre des projets des uns et des autres. J’ai ainsi pu travailler une pièce d’après Gertrude Stein NOM D’UN CHIEN. J’ai donc eu un premier père qui s’appelait Peyret et puis toute une série de frères : il y a eu la Fonderie, les gens du Théâtre du Radeau qui nous ont proposé de venir retravailler et grâce à eux le spectacle a pu être remonté et tourner. Après quoi |ai préparé pendant un an et demi un autre projet qui s’appelait BLANCHE-NEIGE SEPTET CRUEL que j’ai présenté ici à la Cité. Il s’agissait de partir du thème de Blanche-Neige et de réunir autour, des gens venus aussi bien de la danse et de la peinture que du théâtre, en vue de réinterroger les formes et d’inventer de nouveaux langages.
Avant de me lancer dans la mise en scène, je me suis longtemps demandé ce qu’on pouvait encore faire qui n’avait pas déjà été fait et comment par rapport à ces nombreuses filiations opérer aussi des ruptures et devenir « son propre fils ».
Georges Banu : À l’écoute de ce tour d’horizon, je me suis aperçu à quel point les artistes insistent sur l’importance de l’inscription dans un territoire, dans le tissu urbain, par le biais notamment d’ateliers. À côté de la réflexion purement artistique émerge aujourd’hui un questionnement social. À côté du souci de monter une production, on trouve celui de se doter d’un outil, si modeste soit-il, qui permette d’engager un dialogue dans le territoire. Pourquoi ces pratiques ? N’est-ce que pour répondre à un besoin alimentaire ou bien sont-elles intrinsèquement liées à votre manière d’envisager le théâtre aujourd’hui ?
Frédéric Fishach : Les amateurs nous aident à nous reposer des questions qu’on ne se pose plus. Ils nous aident à travailler, à retrouver la joie de pratiquer. Ce n’est pas d’abord un projet politique : je fais du théâtre pour faire du théâtre. Je fais du théâtre avec les gens ; je ne fais pas d’action culturelle.
Serge Tranvouez : L’ouverture vers le territoire social ne s’est pas faite au tout début de mon parcours. Je me suis d’abord défini par rapport au père et au grand frère que j’ai rencontrés : Vitez et Gabily. Et je crois que la question de la rupture est au cœur de ma démarche de mise en scène : le premier spectacle que j’ai choisi de faire était LE PARTAGE DE MIDI de Claudel. Or Vitez l’avait monté, et Gabily avait travaillé sur une autre pièce de Claudel, L’ÉCHANGE. J’affirmais donc mes filiations pour mieux souligner en quoi j’étais en rupture : j assumais l’expérience que j’avais acquise tout en faisant une proposition différente, qui intégrait, parmi d’autres, la dimension de la danse contemporaine. Avec la proposition de Stanislas Nordey de venir travailler dans son théâtre, mon geste théâtral a changé de dimension : j’ai porté un autre regard sur la place du théâtre dans la Cité, ce qui a orienté mes choix ; celui notamment de ne travailler que sur des textes strictement contemporains et de les envisager dans un questionnement fort par rapport au public. Je crois que l’on fait toujours son premier spectacle dans une inconscience plus ou moins folle, et que les spectacles qui suivent sont à chaque fois des tentatives pour comprendre et affirmer sa propre écriture de plateau.
Jean Lambert-wild : La fréquentation de mes Maîtres, au sens stoïcien, m’a permis de comprendre qu’elles étaient les nervures de mon corps. Je n’ai donc aucun désir de les tuer. À mes Maîtres, merci ! À monsieur Debelman, à monsieur Lambert, à monsieur Arcellaschi, à monsieur Forest, à monsieur Jünger, à madame Colcomb, à madame Wild, à monsieur Dubois, à monsieur Lazennec à Monsieur Langhoff, à monsieur Goyard et aux autres merci ! Leur enseignement continue et continuera de m’être profitable. Il me permet de m’explorer et d’explorer ce qui m entoure. Il n’y a pas de mauvais Maîtres, ce sont les élèves qui choisissent les Maîtres et non l’inverse ; il n’y a donc que de mauvais élèves.
Sarah Franco-Ferrer : Le travail que nous faisons avec Gatti, n’est jamais un cravail à proprement parler social : Gatti est d’abord un auteur. L’enjeu est de 5e confronter à d’autres mondes, à d’autres formes de pensée, à d’autres individus par le biais de la parole théâtrale.
Ricardo Lopez-Muñoz : Contrairement à Renaud Cojo, je ne me sens pas un escroc, je ne me sens pas du tout inutile. Je ne fais pas pousser des tomates, je ne produis pas quelque chose de concret, mais je crois qu’il se passe effectivement quelque chose dans la relation que j’établis avec les gens avec qui je travaille qu’ils soient professionnels ou amateurs. L’année dernière, nous avons initié un projet avec quatre cents élèves dans une Zone d’Éducation Prioritaire à Aulnay qui a duré quatre mois au bout desquels on a fait une présentation entre nous et l’un des élèves à dit : « Je n’ai pas envie de devenir acteur, mais avec cette expérience jai eu l’impression d’accéder à une autonomie. » Voilà, des phrases comme ça font que je ne me sens pas inutile.
Georges Banu : Je voudrais à présent demander à André-Louis Perinetti s’il veut bien nous parler des débuts de la Cité Internationale qu’il a fondée.
André-Louis Perinetti : Ce lieu que j’ai investi il y a trente ans était essentiellement un lieu de rupture. Nous ne nous reconnaissions aucune filiation et par la force des choses nous nous considérions comme orphelins. Je n’aime pas du tout ce terme de filiation, je lui préfère celui de compagnonnage. J’ai eu la chance de rencontrer un homme qui a TOUJOURS été en rupture, Je veux parler de Jean-Marie Serreau avec qui j’ai été en compagnonnage pendant près de dix ans. La première chose que j’ai apprise auprès de Jean-Marie Serreau est d’avoir d’abord un « toit ». Forts de ce principe, nous avions alors la boulimie des lieux : on travaillait dans la salle de répétition du Gaumont Palace, l’Université du Théâtre des Nations, que je dirigeais par ailleurs, était installée dans le sous-sol d’un autre cinéma, le Gaumont Gambetta, on avait aussi piqué un appartement de trois cents mètres carré à Beaubourg, dans l’attente de la construction du nouveau musée (il s’agissait d’une étude de notaire !). Nous avions également récupéré un rez- de-chaussée dans une rue des Halles. J’étais à l’affût de nouveaux lieux, parce que l’Université du Théâtre des Nations avait été chassée du Théâtre Sarah Bernhardt, où nous occupions le dernier étage, ceci en raison de la réfection du théâtre. Et quand on refait quelque chose, on vide toujours ceux qui sont dedans. Et ils ne risquent pas d’y retourner !
Le lieu où nous sommes aujourd’hui n’était alors qu’une sorte de « théâtre- garage », où avaient lieu de temps à autres des spectacles, mais l’on y montrait avant tout des films. Le Ministère de la Culture cherchait à cette époque des lieux un peu spéciaux pour en faire des lieux de recherche assimilés à une sorte de Maison de la Culture un peu différente. Évidemment cette Maison Internationale de la Cité Universitaire leur a semblé appropriée. Le président de la Cité Internationale, Monsieur Bernard Chenot, était prêt à accepter cette transformation de la Maison Internationale, mais demandait en même temps qu’on y désigne un animateur. À cette époque Jean-Louis Barrault, directeur du Théâtre de France installé à l’Odéon, mais aussi directeur du Théâtre des Nations (pour encore peu de temps!) cherchait avec Peter Brook un lieu pour y installer un atelier international de recherches. La proposition lui fut faite. Mais évidemment, si Jean-Louis Barrault convoitait l’espace, ce n’était pas pour en assurer l’animation permanente. Aussi il refusa. À cette époque, j’étais à la recherche de nouveaux locaux pour l’Université du Théâtre des Nations et souvent sans être invité, je me pointais au Ministère. J’y étais le jour où Jean-Louis Barrault a exprimé son refus définitif. C’était en janvier 1968. Quelqu’un de la Direction du Théâtre du Ministère a dit : « Pourquoi ne le donnerait-on pas à Perinetti ? » J’ai posé mes conditions avant d’accepter : j’acceptais de devenir directeur des Affaires Culturelles de la Cité Universitaire, mais en échange je prenais tout le sous-sol de la maison pour y installer l’Université du Théâtre des Nations. Notre arrivée était prévue pour le mois d’octobre 1968. Mais en mai, les événements en ont décidé autrement. Nous avons avancé notre installation, profitant que nous n’étions pas « suspects » aux étudiants qui occupaient la Cité. Et coute la fratrie y a alors débarqué : les stagiaires de UTN, mais aussi Jean-Marie Patte, qui créa son lieu, « le Jardin », Victor Garcia, Jorge Lavelli, et d’autres. Même Vitez qui reprit plusieurs de ses spectacles dans les différentes salles que nous avions créées. Car la Cité était devenue multiplexe. Quand j’ai quitté la Cité, il y avait quatre lieux qui fonctionnaient en permanence (le Grand Théâtre, la Resserre, la Galerie et le Jardin)sans compter les pavillons que l’on investissait le temps d’un spectacle.
Ce théâtre est donc devenu en très peu de temps le lieu par excellence de la jeune création française mais aussi du théâtre international, notamment avec les grandes troupes américaines de cette époque.
Installés en mai 1968, nous avions toujours voulu garder l’esprit et la liberté de parole de ce moment privilégié. Jusqu’au moment où je me suis rendu compte, après quatre ans et que mai 68 s’éloignait dans le temps, que cette liberté de parole risquait d’être reprise. Et commençait par l’être. Une année, j’ai été accusé d’avoir, par une programmation orientée, tenté de remettre en cause les structures de la Société et celles de l’État !J’ai donc décidé de partir et j’ai démissionné en mai 1972. On m’a alors proposé de prendre la direction du T.N.S., à Strasbourg, qui devenait Théâtre National. (Auparavant il en avait le titre mais pas les statuts.) J’ai beaucoup hésité (deux mois!) mais j’ai sauté le pas après avoir consulté Roger Planchon, et surtout son co- directeur, Robert Gilbert. Ils m’ont indiqué qu’il était de notre devoir d’investir le plus de lieux officiels possibles, afin de les pervertir ! Les lieux ont une mémoire, ils résistent. Surtout ceux-là !
Mais les bâtiments officiels ne doivent pas nous faire renoncer à théâtraliser les lieux déjà existants, ces lieux qui ont une âme ec une histoire. Et je suis très heureux de voir que ce lieu, grâce à Nicole Gautier, est redevenu une structure d’accueil de jeunes compagnies dans un même esprit que ce lui que nous avions alors, mais certes dans un contexte différent. Si vous me permettez d’exprimer un souhait, c’est que ce théâtre demeure un lieu de rupture. Et je vous encourage, comme Peter Stein l’a suggéré dans une interview, à renverser le théâtre de ces metteurs en scène sexagénaires qui à force de n’avoir pas été remis en question pendant de nombreuses années, peuvent toujours se faire passer pour le nouveau théâtre, comme d’éternels adolescents qui refusent de vieillir.
Christophe Lemaître : Je crois que les générations précédentes connaissaient une situation différente. Nos pères détruisaient ; nous, nous avons besoin d’enfiler le costume de l’institution pour le faire craquer. Ils avaient un côté homme préhistorique qu’on ne peut plus se permettre aujourd’hui. Au lieu de rupture, je parlerais donc de transformation.
Serge Tranvouez : Il me semble que la notion de frère est importante quand on parle de filiation. Et j’ai le sentiment que les gens de théâtre de ma génération, plutôt que de déclarer laguerre à leurs aînés ont su se constituer en fratrie pour faire surgir du nouveau. Ma réaction aujourd’hui est plutôt d’essayer de retrouver le lien avec ces aînés.
Ludovic Lagarde : Ce qui a changé par rapport à l’institution, c’est que les frontières entre théâtre public ec théâtre privé sont devenues floues. Il y a des théâtres publics qui présentent des spectacles conventionnels que l’on avait l’habitude de voir dans le privé.
Nous vivons une situation d’éclatement politique et esthétique, et peut-être que l’absence d’affrontement idéologique clair y est pour quelque chose, Et puis, il est devenu presqu’impossible d’avoir la possibilité de travailler sur la durée, tant notre société subit la menace de la contagion du fast-food.Un spectacle doit se boucler en cinq semaines et parfois en trois, c’est une question de rentabilité.
Gloria Paris : Il y a une notion qu’il me semble important d’introduire dans le débat, c’est celle de légitimité. Dans ce moment de commencement, il m’est très difficile de savoir si je suis en rupture.
J’en suis encore à me donner le droit de faire, à essayer de me légitimer moi-même. C’est pourquoi, il me paraît important de continuer à travailler avec les armes que des gens comme Mario Gonzales ou Claude Régy m’ont données pour être à la hauteur de leur exigence.
Serge Tranvouez : Je crois que nous manquons sérieusement d’outils critiques et que nous devrions nous les fournir. C’est-à-dire que nous devrions d’abord nous faire un devoir d’aller voir les spectacles des autres et d’être capables d’en parler, d’échanger une parole critique de plateau. Car sinon nos spectacles sont comme des assiettes sales qu’on empilerait sans fin. Trouvons l’endroit, inventons le lieu d’une telle parole de travail. Et peut-être qu’à ce moment-là, on investirait les institutions d’une manière plus intelligente, plus vivante.
Ludovic Lagarde : Il est fondamental de pouvoir trouver un lieu où l’on puisse exercer un travail dans la continuité. Je crois qu’on a tous envie de ça. Et toute l’institution aujourd’hui devrait placer ce souci au centre de ses réflexions.
Jean Lambert-wild : Je crois à l’exil, à la migration. Je n’ai aucune envie de diriger un lieu. En France, on ne manque ni de bâtiments, ni de structures, la question est ailleurs : Peut-on mener de front un travail de création et un travail de directeur de théâtre. Me concernant, la réponse est non !
Benoit Bradel : Peut-être faudrait-il inventer des moyens de codiriger des lieux, de créer des partenariats entre les artistes et les animateurs culturels. Créer des réseaux.