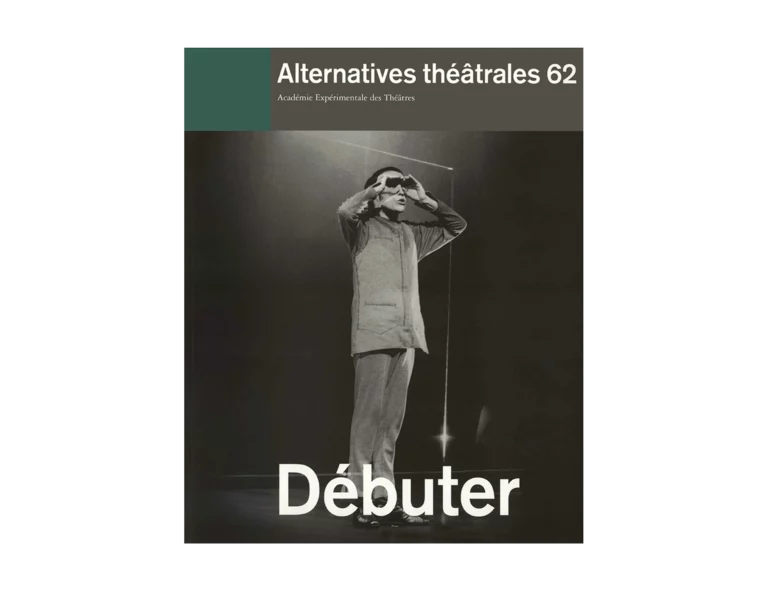YAN CIRET : On ne débute pas aujourd’hui comme on le faisait à la fin des années 60. Selon toi qu’est-ce qui a radicalement changé ?
Georges Lavaudant : Il y a une sorte de paradoxe. Les institutions multiplient aujourd’hui les stratégies pour aider les débutants et c’est en même temps incroyablement plus difficile de débuter. Quand j’ai commencé à faire du théâtre, lé paysage était ouvert. Mais si je n’ai pas éprouvé de difficultés, c’est aussi parce que notre seule préoccupation était de fabriquer de l’art avec des amis sans souci de la durée. J’ai débuté à Grenoble où il n’y avait que deux ou trois compagnies théâtrales. Il était alors possible de commencer par nous réunir pour choisir quoi monter, quel texte écrire, comment s’inscrire dans la violence politique de l’époque, quels poètes nous voulions faire entendre sans d’abord poser la question du financement. L’argent on le trouvait, un peu comme des gangsters qui montent des coups, rackettent des hommes politiques, mais ilfaut dire aussi qu’à ce moment aucun de nous ne vivait du théâtre.
Y. C.: La nouvelle génération a tendance à toujours se positionner par rapport à l’institution. À penser que seul son soutien permet de les sortir de l’ombre. Est-ce la seule optique envisageable ?
G. L.: Un spectacle ne se fait bien sûr pas indépendamment du contexte dans lequel il est créé ; les moyens dont on dispose influent sur l’objet qu’on façonne :le lieu de répétitions, les moyens octroyés, le théâtre où l’on va jouer. Mais le soutien des institutions n’est pas le seul qui importe. Parfois le soutien moral d’un allié que l’on estime, d’un professionnel dont on respecte le jugement, compte davantage ; il donne la force de continuer et peut ouvrir d’autres horizons.
Y. C.: Au temps de tes débuts, la nouvelle génération était contre l’institution. Il semblerait aujourd’hui que l’avant-garde se soit alliée au marché, qu’elle se soit infiltrée dans toutes les sphères institutionnelles. Qu’en penses-tu ?
G. L.: Ce qui me plaît dans le théâtre, c’est Justement sa capacité à entrer dans une autre temporalité que celle que la société nous impose. Un spectacle, par son discours, participe à la vie culturelle et en même temps y échappe : chaque soir, tout est à réinventer. Si l’acteur n’ouvre pas correctement le spectacle, ne dit pas sa première réplique avec justesse, alors tout s’écroule. Il n’y a pas d’instantanéité. Le théâtre est un ralentisseur de temps : il se fait lentement, il agit lentement sur les spectateurs. Ainsi il résiste aux lois de notre temps. C’est un art très archaïque, n’est-ce pas ? Il me semble qu’un spectacle peut s’inscrire dans un temps contemporain, comme geste de rupture, tout en étant alimenté par cette espèce de mémoire qu’on peut chacun se réinventer différente, cette filiation avec les anciens. Mais j’ai l’impression ne n’avoir pas tout à fait répondu à la question.
Y. C.: Ce que tu viens de dire me semble très bien définir ton propre travail : ton geste artistique est radical, mais il garde toujours un lien avec la mémoire du théâtre. À tes débuts as-tu jamais voulu rompre complètement avec le théâtre qui se faisait jusque là ?
G. L.: Je ne suis pas né dans le théâtre. Mon univers était peuplé de gens comme John Coltrane, Jean-Luc Godard ou Jean-Marie Le Clézio. Je n’ai pas écrit d’articles qui attaquaient les directeurs de théâtre en place surtout que, à Grenoble, l’un d’entre eux, René Lesage, m a enthousiasmé par ses mises en scène de Beckett. Je n’étais pas dans la logique de l’affrontement.
Y. C.: Pourtant tu faisais partie de ces jeunes gens en colère qui voulaient changer le monde.
G. L.: La nouvelle Vague s’est élevée en Opposition à « la qualité française » qui avait sclérosé le cinéma. Pour ces jeunes cinéastes, ce qui importait n était pas le savoir-faire, mais que le cinéma donne une image vraie de la société dans laquelle ils vivaient. Avec eux, un vent de liberté a soufflé. Nous nous sentions proches de cette démarche. C’était un peu avant 1968. Notre énergie était générée par ce sentiment que changer le monde était plus que jamais possible.
Y. C.: Philippe Sollers m a un jour dit : « La première chose que je demande à un jeune écrivain, c’est s il déteste la société. » Crois-tu qu’aujourd’hui la jeune génération est moins révoltée que la tienne ? Que demanderais-tu à un jeune metteur en scène qui viendrait te voir ?
G. L.: Il ne faut pas nécessairement être une personne révoltée pour que son geste artistique soit violent. On peut avoir une personnalité conformiste et produire une œuvre subversive. Je crois que la biographie et les prises de position politique d’un artiste sont secondaires. Ce qui m importe, c’est d’être ému par un spectacle ; aussi Je ne cherche pas à rencontrer les jeunes metteurs en scène, n1 à connaître leur parcours avant d’avoir vu leur spectacle. Je me souviens du premier spectacle de Tanguy auquel j’ai assisté. Je n’avais jamais entendu parler de lui auparavant. Et j’ai éprouvé un réel choc dans cette petite salle où nous n’étions que cinquante spectateurs. Je trouvais son travail incroyable et je suis allé immédiatement à sa rencontre.
Y. C.: Au moment où tu mettais en scène LE ROI LEAR1, tu m’as dit que le spectacle ressemblait au théâtre que tu voulais faire quand tu étais enfant. Comme si plus tu avançais plus tu te rapprochais du début, de l’enfance.
G. L.: Je ne sais pas si c’est volontaire. Il vient un moment où l’on commence à maîtriser un peu plus les moyens qui nous sont donnés. Et en même temps que l’on en devient maître, on perd quelque chose, une petite mort plane. Après cette période J’ai ressenti la nécessité de retrouver ce que le brio technique avait fini par masquer : une émotion qui point à fleur des choses. Il faut alors avoir le courage de perdre sa technique, ce que des peintres comme Matisse ou Goya ont osé faire.
Y. C.: Tu arrives à l’essentiel.
G. L.: Je me suis souvent demandé ce qui faisait qu’un premier spectacle marche. Je crois que dès les premiers spectacles existent des éléments, encore bâtards, mal définis, qui sont les germes de tout ce qui est à venir. Proust écrit depuis qu’il est jeune, mais c’est seulement à l’âge de la maturité qu il trouve son écriture. C’est cela que je trouve bouleversant dans les premières œuvres : retrouver les germes d’un style. Tout jeune Picasso copie avec brio toutes les toiles de maîtres qu’il admire. Mais ses copies sont déjà du Picasso.
Y. C.: Dans tes premiers spectacles as-tu ressenti le besoin d’imposer une esthétique ?
G. L.: Je n’ai jamais été seul. J’ai commencé à plusieurs. Nous étions tout un groupe avec partisans et la réflexion esthétique n’émanait pas d’un seul. Nous étions animés du désir de ne pas se conformer au destin triste que Grenoble semblait nous avoir préparé. Nous ne voulions pas devenir ingénieurs, professeurs, mais réussir à dire la poésie qui était en nous. C’était vital.
Y. C.: Entrer dans le monde du théâtre, c’est passer d’une famille à une autre. As-tu le sentiment d’avoir rompu avec un milieu social, de t’être affranchi du milieu dont tu étais issu ?
G. L.: En prenant le chemin du théâtre, je me suis, il est vrai, éloigné de ma famille originelle pour me rapprocher des gens de la troupe que nous formions. Mais je n’ai jamais cessé de voir mes parents et mes frères. Nous avons toujours eu des rapports sans conflit.
Y. C.: Ta carrière est faite de plusieurs débuts. Après avoir commencé dans la mise en scène, tu te mets à écrire. Tu connais alors un deuxième début, un début d’écrivain.
G. L.: Je ne le vois pas comme ça. Je crois avoir toujours eu envie d’être romancier. Et dans le fond, je me suis un peu servi du théâtre pour écrire des romans à plusieurs. Des romans dont la matière-même est la vie. Même si l’on s’en invente trois ou quatre, même si l’on est mensonger à la manière de Fellini. Ce que j’ai toujours eu envie de faire entendre, c’est une sorte de journal de bord où sont montrées les contradictions à la fois personnelles et sociales qui nous traversent.
Y. C.: Pourquoi avoir commencé si tard à écrire ?