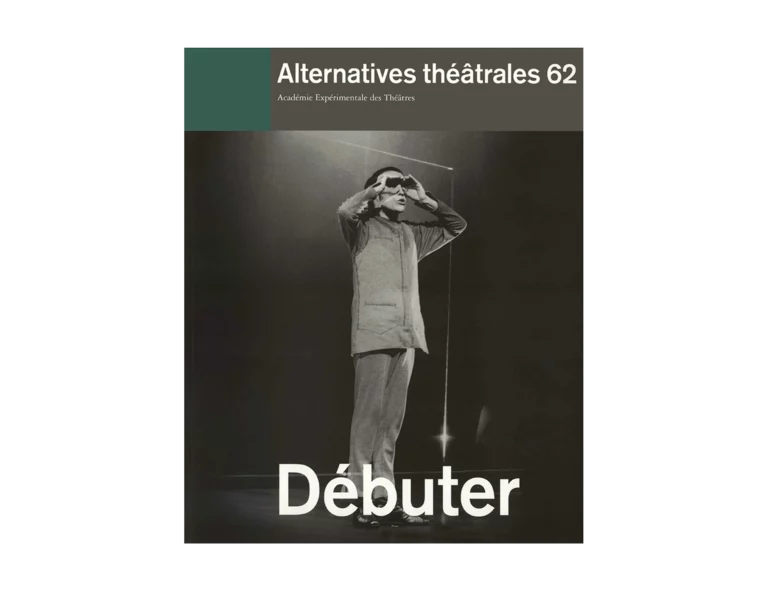JULIE BIRMANT : Comment êtes-vous venu au théâtre ? D’où venait le désir de faire cette école de mise en scène qu’est l’INSAS1 ?
Jacques Delcuvellerie : Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Je n’ai pas désiré faire l’INSAS. Depuis très petit, je me suis tourné vers la littérature. Je ne dis pas ça du tout pour faire enfant prodige : à sept ans j’écris mon premier sonnet en vers sur les moissons, les blés murs, j’étais très fier de ça. Donc il était clair très tôt que je serais de ce côté là, par là. Ma première expérience théâtrale était d’un niveau de qualité discutable : j’ai fait partie à Lille d’une troupe d’enfants célèbre dans la région qui s’appelait les enfants de Tante Ginette qui mélangeait des acteurs professionnels et de très jeunes enfants autour de spectacles un peu mélodramatiques et ponctués de chansons. Je me suis senti mal à l’aise dans le cadre scolaire dès le lycée, sauf dans les matières littéraires, et puis j’ai eu à quatorze ans, pour le meilleur et pour le pire, un grand choc qui a marqué un tournant dans ma vie : j’ai perdu dans des circonstances violentes mon père et ma mère. Une des conséquences positives de cet événement par ailleurs assez désastreux, c’est que j’ai pu influencer ma vieille tutrice, la sœur de mon père, qui m’a permis de quitter le secondaire et de faire des études artistiques. Ma mère était eurasienne, ce qui explique la folie pour le Japon dont je me suis pris à ce moment-là. J’ai étudié toute son histoire, je m’habillais en Japonais, je pratiquais les arts martiaux et je peignais des calligraphies et des paysages. J’ai donc cherché d’abord une école d’arts plastiques. La meilleure des environs de Lille était Saint-Luc à Tournai en Belgique. Après ces trois années — brillamment réussies ! — je me suis tout de même rendu compte que je n’étais pas fait pour la peinture. J’étais partagé entre plusieurs passions qui se situaient toutes dans le monde des arts : peinture, architecture, musique — je voulais aussi devenir organiste. Après Saint-Luc, je me suis inscrit dans une école tournée vers la communication sociale, l’IHECS2, C’est là qu’ont commencé mes premières expériences de mise en scène et d’écriture dramatique pour la radio et la télévision auxquelles j’ai pris un goût extraordinaire. Mais en 1968, en troisième année de l’IHECGS, j’ai pris une part plutôt remarquée aux événements qui n ont pas manqué de secouer l’école : nous en avons été expulsés moi et deux de mes camarades puis réintégrés mais, à la rentrée suivante, nous avons été refusés à l’inscription en dernière année. Par conséquent nous étions à la rue et nous avons finalement frappé à la porte de l’INSAS dont la rentrée avait déjà eu lieu, et son directeur de l’époque, Raymond Ravart, a bien voulu nous prendre en sachant que nous étions des boutefeux. Et ça n’a d’ailleurs pas manqué : à peine étions-nous Inscrits dans son école que nous avons déclenché des grèves. Je serai toujours reconnaissant à Raymond Ravart de nous avoir recueillis, parce que c’est à l’INSAS que j’ai fait la rencontre de la dernière pièce du puzzle Littérature / Arts plastiques / Sens de la temporalité :l’acteur. Et donc en étant assistant de metteur en scène en rencontrant des professeurs comme Arlette Dupont, j’ai su que j’avais trouvé ce qui rassemblait tout pour moi. Je me suis aussi rendu compte que j’avais la qualité de pouvoir réunir et animer les énergies d’une équipe, c’est-à-dire faire en sorte qu’autour d’un texte ou d’un projet on puisse faire advenir ce que l’on porte, à travers la créativité des autres, dans le dialogue et la stimulation de la créativité des autres. Voilà comment je n’ai pas choisi de faire l’INSAS. C’est l’acteur qui m’a d’abord déterminé à faire du théâtre. Et puis le théâtre rassemblait tous les domaines auxquels j’avais été sensible, et troisièmement, effectivement, c’était un acte composé qui venait du monde et se reposait hic et nunc devant le monde.
J. B.: Ce qui me trouble c’est la diversité de votre parcours. Vous ne vous focalisez pas sur la mise en scène de théâtre, mais investissez aussi bien l’univers de la radio que celui de la vidéo. Comme si peu importait qu’on utilise une langue ou l’autre (le langage radiophonique, cinématographique ou théâtral) pourvu que l’on exprime ce que l’on à dire. Le pensez-vous ?
J. D.: Ma véritable langue, c’est le théâtre. La radio et un peu plus tard la télévision, à travers mon émission consacrée à la création vidéographique, ont rempli pour moi une fonction d’éducation permanente. Les émissions que j’ai créées ou auxquelles j’ai participé comme celles consacrées aux arts contemporains, au folklore, aux arts populaires, aux arts des minorités urbaines, de la classe ouvrière, étaient extrêmement enrichissantes et allaient de pair avec un engagement prépondérant politique qui faisait que la vocation artistique passait après la préoccupation politique. J’ai à un moment donné d’ailleurs abandonné et la radio et la télévision pour directement travailler à l’usine.
J. B.: La pratique des médias radiophoniques et télévisuels vous ont-ils permis d’acquérir des méthodes de travail applicables au théâtre ?
J. D.: La radio et la télévision s’adressent à une audience beaucoup plus large, dans une relation beaucoup plus immédiate. La radio était à l’époque très écoutée. On avait le sentiment de pouvoir toucher l’opinion. Comme au moment du putsch de Pinochet. Nous avons alors réalisé plusieurs émissions consacrées entièrement au Chili. Pendant deux trois heures d’affilée, le samedi soir, nous avons invité des Chiliens et des journalistes pour rendre compte du mouvement culturel qui avait accompagné l’unité populaire, et nous avons fait écouter ses musiques. À ce moment là, je n’avais pas de pratique théâtrale directe. Et c’est peutêtre pendant cette période que je me suis formée l’idée, fondamentale pour la fondation du Groupov3, que le théâtre est un art minoritaire et que sa pratique doit rester archaïque par rapport aux autres
moyens de communication contemporains s’il veut réaliser pleinement ses possibilités. La pratique des autres médias m’a permis de ne jamais céder à la tentation d’investir la scène avec une sorte de nostalgie du cinéma, par exemple. Je me suis plutôt dirigé sur une autre piste totalement éloignée de mes préoccupations politiques : celle du Théâtre Laboratoire de Grotowski dont j’admirais l’exigence. Ses méthodes m’ont beaucoup influencé. Mais j’étais aussi à l’écoute d’un théâtre politique comme le Théâtre Canpessino fait par les Chicanos, les ouvriers agricoles mexicains aux États-Unis. C’était un théâtre très simple, très profondément enraciné dans une culture … J’admirais aussi le Living Theater, le travail de Dario Fo, un certain nombre de pratiques authentiquement théâtrales
J. B.: Ne viviez-vous pas alors une contradiction : avec, d’un côté, le désir d’agir sur une large audience, et de l’autre celui de faire un théâtre fondamentalement minoritaire ? Comment s’est opéré le choix de fonder le Groupov et de se consacrer à cette pratique minoritaire ?
J. D.: J’ai effectivement toujours été traversé par cette contradiction. Je crois qu’on ne peut pas extorquer à un art quelque chose d’autre que ce qu’il est, même si l’on en bouge les limites. Même si le théâtre ne s’adresse qu’à des audiences réduites, il les touche véritablement. Et il n’est susceptible de cette influence de longue durée que s’il est dans son génie propre. De fait, le théâtre de Grotowski, qui n’a été vu que par quelques milliers de personnes, a continué à exercer une influence profonde à travers le monde — mais pas en France. De même le théâtre de Brecht4, qui n a pas seulement été un auteur mais un refaiseur des outils du théâtre, a une influence dans le temps d’une autre qualité.
Je ne veux pas dire par là qu’il soit satisfaisant que le théâtre soit vu par si peu de monde. C’est un problème citoyen dans lequel les artistes devraient s’impliquer qui outrepasse la forme propre dans laquelle les artistes s’expriment. On a beaucoup critiqué la pratique de Jean Vilar, mais je crois qu’il a posé une question essentielle et qu’abandonner ce terrain est une désertion inadmissible. Mais ce n’est pas en modifiant la nature de ce qu’on produit, qu’on résoudra la question : ce n’est pas parce qu’on fait du spectacle à caractère forain ou populaire qu’on répond à ce problème citoyen. Dans ce moment d’engagement politique où je travaille dans les médias (que je retrouverai par la suite pour gagner ma vie), je ne fais pas de théâtre.
Quand je reviens vers le théâtre, je vis la contradiction que l’on vient d’évoquer d’une manière aiguë : j’ai l’impression que toutes les grandes questions politiques qui m avaient agité étaient désavouées par le monde, qu’elles n’étaient pas capables de se porter elles-mêmes ; les entreprises révolutionnaires avaient dépéri, implosé. Mes questions étaient restées sans réponse. Et ceux qui prétendaient qu’on s’était trompé et que le monde était bien tel qu’il était, Je ne les croyais pas non plus. Donc les anciennes idéologies, celles de mon enfance, du
christianisme, de la social-démocratie, etc. ne m’intéressaient pas du tout. J’étais en souffrance de tout cela, et en même temps, je revenais vers un art qui me semblait avoir si peu de prises sur le monde par rapport à la musique rock, pop ou le cinéma. C’est dans cet esprit, qu’est aussi — dans la fin des années 1970 et 1980 — celui du mouvement punk et du no future, que le Groupov ‘ se forme. Les formes théâtrales qui nous entouraient et qui pour certaines étaient très belles — c’était le début de la somptuosité wilsonienne — nous semblaient auto satisfaites par rapport à l’état du monde ; nous ne nous y reconnaissions pas. En même temps nous ne savions pas comment agir sur le monde ni quoi faire avec le théâtre. Aussi décidons-nous d’aller au bout de ce constat assez noir, c’est-à-dire de faire quelque chose qui peut-être n est pas du théâtre : de nous enfermer dans une grande pièce et de voir ce qui pouvait sortir de nos nerfs, de nos muscles, d nous-mêmes qui nous sentions orphelins, dans un sentiment de déréliction et de perte, en plein désarroi. Et notre regard devait être impitoyable : il fallait éliminer tout ce qui nous semblait reciter quelque chose de déjà vu, ou fonctionner sur des archétypes. Nous cherchions à trouver les méthodes qui puissent permettre de rentrer par effraction en nous mêmes en étant perpétuellement dans a surprise de ce que nous produisons. Le Groupov a d’abord travaillé en dehors de tout cadre de production, de toute perspective de représentation à échéance et même en refusant un rythme de travail habituel : 1l y avait des semaines où l’on ne se quittait pas (une semaine de congé par exemple), d’autres où l’on ne se voyait qu’une seule fois … La manière de vivre et d’accoucher était déjà différente puisque l’objet inconnu à chercher était lui-même différent ou plutôt comme nous le supposions d’une manière totalement mégalomaniaque « inouï ». Notre entreprise était donc d’abord très puérile — croire qu on pouvait comme ça accoucher de l’inouï dans un endroit clos — mais aussi très douloureuse. Nous avons travaillé pendant un an et demi à ce rythme bizarre, avant de présenter un spectacle devant un petit nombre d’invités FAITES CE QU’ON VOUS DÎT ET IL VOUS ARRIVERA UNE SURPRISE QUE PERSONNE ME PEUT IMAGINER. C’était le vrai début du Groupov, cinq heures et demie de spectacle. Je ne sais pas si c’était vraiment du théâtre, c était plutôt quelque chose à offrir et proposer devant et pour des autres. Ça commençait même de façon extrêmement radicale pour les autres, puisque les spectateurs entraient dans un petit sas assez sombre où sut un pupitre un magnétophone diffusait un message sur la troisième guerre mondiale qui enjoignait les gens à faire preuve de courtoisie et de prudence en cette période de pré-catastrophe et les invitait, afin de pouvoir passer le temps dans cet esprit, à louer ce soir un des acteurs. Après quoi entraient cinq acteurs. Les spectateurs devaient choisir un acteur et chacun lui donner cent francs (belges): il partait ensuite avec lui dans un local où il pouvait lui demander pendant une demi-heure tout ce qu’il voulait.
Nancy Delhalle : Pourquoi l’argent ?
J. D.: Cela rendait plus manifeste cette responsabilité directe que vous prenez en achetant un billet de théâtre. Il y a une grande équivoque dans l’histoire du théâtre en occident, notamment pour les femmes, entre actrice et prostituée.
J. B.: Comment le spectacle a‑t-il été reçu ?
J. D.: Par une ignorance totale de la presse. Mais il y avait une rumeur. Isabelle Pousseur, Jean-Marie Piemme, Chantal Ackerman.… sont venus. De la même manière que nous nous étions inventés des méthodes et des temporalités différentes, il fallait apprendre à gérer la rumeur, plutôt que d’appliquer les techniques habituelles de « management de communication ».