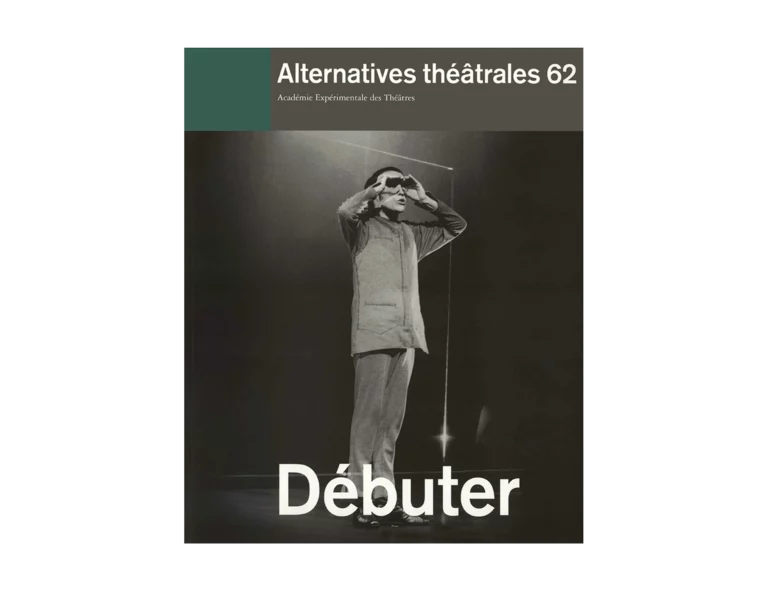GEORGE BANU : Il y à mon sens deux grands types de début : les débuts-événements et les débuts processus. Comment envisagez-vous votre propre début ?
Jacques Lassalle : En ce qui me concerne je pourrais parler de début involution. En effet à peine avais-je commencé que je m’arrêtais aussitôt. Je pense que je n’en finis pas de débuter parce que je n’en finis pas d’interroger le théâtre en général et la mise en scène en particulier. Comment définir ce que je fais ? Mon étonnement face à cette question quotidienne est toujours resté le même.
Comment ai-je pu consacrer ma vie au théâtre alors qu’il n’était pas consciemment le but de ma vie, comment ai-je pu faire théâtre de mon désir de ce qui n’est pas théâtre ?
J’ai tenté plusieurs échappées, plusieurs ruptures et le théâtre m’a toujours repris. Je crois que je suis désormais lié au théâtre par un rapport d’appartenance, mais ce lien n’a pas été évident d’emblée, il résulte d’une longue pratique de la rébellion, de l’insurrection quotidienne.
G. B. : Par quels chemins êtes-vous arrivé au théâtre ? La vocation, si on peut employer le terme, comment s est-elle affirmée ?
J. L. : Les raisons sont à chercher, me semble-t-il, dans l’enfance. Je suis auvergnat, Comme André Antoine, comme Maurice Pialat. Mais eux mis à part, les Auvergnats sont peu nombreux à être entrés dans le monde du spectacle. Parce que c’est un pays dur, un pays d’exil obligé. Quand mon grand-père était mécontent de moi, il me traitait d’artiste et crachait dans l’âtre pour se laver la bouche. C’est sans doute pourquoi j’ai éprouvé une sorte de culpabilité intériorisée à travailler dans le monde du théâtre jusqu’au jour où j ai réussi à avoir le sentiment
d’agir en citoyen. Alors je me suis dit que j’avais le droit de faire l’artiste ; j’arrivais à prononcer le mot. « Artiste ». Mais ça m’a demandé beaucoup de temps.
Mon désir de théâtre Je l’ai ressenti dès l’âge de douze ans. À l’époque je croyais que j’avais une vocation de prédicateur : au retour de la messe, tous les dimanches, avant le déjeuner, je me mettais un torchon sur l’épaule et j’infligeais à mes frères et sœurs (dont j’étais l’aîné) une réappropriation de l’homélie ecclésiastique. Il me semblait être investi d’une mission ! Je pense que tout désir de théâtre est à l’origine narcissique et que toute vie dans le théâtre raconte le renoncement à cet amour de soi originel. On a au départ une conception ingénue de l’ego et on en arrive à l’acceptation difficile mais essentielle de la dissolution de l’ego dans l’autre.
Après avoir cru que je deviendrais prêtre, je me suis pris de passion pour les grands maîtres du barreau, c’était l’époque des Maurice Garçon, des Maître Floriot… Enfin, après quelques temps d’école buissonnière à Clermont-Ferrand et à Nancy, il a fallu que je m’inscrive au Conservatoire municipal de Nancy. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Depardieu disait qu’il y était allé pour voir les filles.
Je me souviens avec tendresse d’un professeur qui ressemblait à Gaby Morlay1. Qui avait attendu toute sa vie que Gaby Morlay ait une grippe pour la remplacer. Il y avait à l’époque deux types de carrières : les carrières lumineuses et les carrières d’ombre portée. À Nancy, je m’étais senti encouragé, on m’avait donné un premier prix de Comédie, un autre de Tragédie pour LORENZACCIO (je m’identifais alors à Gérard Philipe que j’avais découvert au festival d’Avignon et je travaillais tous les textes que le T.N.P. montait).
Je me sentais prêt à « monter à Paris » pour tenter le concours du Conservatoire. Car dans les années 50, dans l’environnement qui était le mien, si l’on voulait faire du théâtre, il fallait entrer au Conservatoire,
Je suis entré dans un cours de préparation, le cours Gramont. Le premier jour, je monte sur le plateau pour présenter une scène de LORENZACCIO. Je n’ai pas dit trois mots que Béatrice Dussanne, qui était une éminente pédagogue, m’interrompt : « Dis, donc mon gros, tu descends immédiatement de là, et pour demain, tu me travailles le gros René ». Depuis ce jour je me suis résigné à jouer Gros René tout en restant à l’intérieur Lorenzo. La violence de cet événement m’interroge en tant que professeur. Serais-je aujourd’hui capable de donner à un élève un cel diagnostic, à ce point rédhibitoire ? Car si je n’ai cessé d’enseigner depuis une vingtaine d’années, si je suis pédagogue, ce n’est pas pour enseigner, mais pour apprendre. Un pédagogue reçoit toujours plus que ce qu’il donne, c’est un privilège exorbitant. Je suis donc entré au Conservatoire avec l’emploi de valet. À l’époque on entrait au Conservatoire avec un emploi, et on en sortait de même, n’ayant travaillé qu’avec le professeur en fonction auquel cet emploi était attribué.
Mon parcours a donc commencé de façon somme coute très conventionnelle, mème si dans mon environnement familial se consacrer au théâtre était considéré comme une attitude de rébellion. Peu de temps avant sa mort, un jour que nous étions partis ensemble fumer la pipe, mon père — qui me pardonnait mal d’avoir East du théâtre m’a dir : « Mon vieux Jacques, je ce remercie de m’avoir désobéi. » Je lui ai répondu : « Je te remercie de m’avoir forcé à te désobéir. » Je raconte cette histoire parce qu’au fond j’ai toujours beaucoup plus appris de mes révoltes que de mes adhésions. Je dis toujours à mes élèves que je les souhaite réfractaires, que je n’attends aucune adhésion de leur part, si agréable soit-il d’avoir des disciples. Il ne faut pas se résigner à imiter, mais se constituer contre ses maîtres ou en tout cas au-delà.
Ma rébellion vis-à-vis du père c’était cela : crois années de Conservatoire. J’éprouvais un sentiment d’étrangeté terrible, de damnation douce. Nous étions en pleine guerre d’Algérie. Je n’avais pas de conscience politique. Cette guerre coloniale nous la trouvions sale, nous ne voulions pas la faire ; c’était tout. Alors qu’à côté de nous, à la frontière encre le théâtre public et le théâtre privé s’inventait un théâtre intermédiaire novateur qui lui était engagé et analysait l’histoire politique. Je me souviens être sorti des NÈGRES de Genet monté par Roger Blin en me demandant « Mais qu’est-ce que tu fais là ? »
Ainsi pendant ces crois années malgré un changement de classe et l’arrivée pour moi déterminante de Fernand Ledoux, c’est Le sentiment d’étrangeté qui domine, un sentiment que je n’ai réussi À surmonter que récemment. J’ai cru avoir à me construire contre et malgré cette formation initiale et c’est seulement quand je suis entré à la Comédie Française, que j’ai découvert que ma rébellion était demeurée tout à fait intacte, mais qu’y participait aussi un sentiment d’appartenance : j’étais sidéré de ressentir qu’à peine arrivé, j’étais déjà chez moi. Comme si j’avais fait une très longue fugue et que j’étais revenu à la maison, sans avoir rien oublié des raisons qui m’avaient décidé à partir. La boucle était en fin de compte relativement bien bouclée. Je retrouvais un lien avec ce qui me semblait être une erreur d’orientation : j’allais davantage à la cinémathèque rue d’Ulm qu’au théâtre, je lisais Les Cahiers du Cinéma et pas la revue du Théâtre Populaire, j’allais au bistrot plutôt qu’aux colloques spécialisés … Aujourd’hui je mesure tout ce que je dois à ces années de formation même contrariées, même incertaines. Je crois que le théâtre fait ventre de tout, des détresses, des désarrois. Après ce début-là, j’ai renoncé au théâtre, et il a fallu que la vie m’y ramène : j’étais marié, J avais deux enfants, bientôt trois, j’ai donc dû déménager, dans un H.L.M. à Vitry sur-Seine.
En même temps que je découvrais la banlieue, je retournais étudier à la Sorbonne et c’est là qu’un de mes professeurs, mon professeur de grammaire Robert Léon Wagner m’a dit : « Abandonner le théâtre est je trouve suicidaire de votre part, allez donc voir cet Institut d’Études Théâtrales qu’un de mes amis, Jacques Scherer, est en train de créer ».
J’ai fait en même temps la rencontre de l’Université qui m’a permis de donner un sens à la pratique de l’acteur, et la rencontre de Vitry, une banlieue violente. C’est cette double rencontre qui m’a ramené au théâtre. À Vitry, j’étais un peu suspect, je n’avais pas ma carte du Parti Communiste, mais c’est là que j’ai compris que faire du théâtre au cœur de la cité avait un sens, tout comme c’en avait un de faire du théâtre pour ceux qui n’y vont pas, de jouer Shakespeare, Goldoni ou Molière devant des salles pas toujours pleines. Vitry me donnait l’occasion de faire le citoyen et c’est alors que je me suis donné le droit de faire un peu l’artiste, bien modestement. Ça a commencé par la visite d’un voisin quelques jours avant Noël : il m’a demandé de préparer un spectacle à partir de trois contes de Pagnol, histoire de rassembler les gens de la cité. J’ai accepté, et cela a continué tout aussi modestement par la proposition qui m’a alors été faite de m’occuper le samedi des adolescents de la Cité. Il ne s’agissait pas de former des acteurs, encore moins d’amorcer l’embryon d’une compagnie, mais plus simplement de faire passer quelque chose que j’aimais du théâtre. Je faisais ça bénévolement, je vivais à l’époque en enseignant le français au lycée. Ça avait un coté exaltant, non seulement parce que je m’attirais une certaine gratitude des parents mais surtout parce que j’apparaissais — c’était très visible dans l’ascenseur — comme un pervers polymorphe… Il était temps que je découvre Brecht et sa suspicion envers le bénévolat.
Des années plus tard, je rencontre le fils de l’homme qui m’avait entraîné dans cette histoire, il me dit que son père a été assassiné dans des conditions terribles et me demande de témoigner en sa faveur au procès. J’ai témoigné en sa faveur, son assassin avait dix-neuf ans, et je revois son regard, un regard qui ne disait rien. Il a été condamné à quinze ans de prison. Je me disais la terrible responsabilité que j’avais dans cette affaire, je me demandais pour combien d’années j’étais, par ma déposition, dans cette condamnation. Je ne suis pas si loin du théâtre qu’on pourrait le penser. Les assises m’ont toujours fasciné : on y voit des gens absentés d’eux-mêmes, des gens à qui ont parle d’eux-mêmes et qui ne se reconnaissent plus. Et cela a à voir avec l’acteur. Car on ne devient acteur que dès lors qu’on a connu cette absence à soi-même, cet étonnement de l’autre en Soi, cette étrangeté à soi. Je crois que l’art de l’acteur commence par cette acceptation à rendre son identité problématique, à la mettre en danger. Il n’y a pas de plus grande générosité, de plus grand danger à vivre.
G. B. : Vous avez commencé votre travail au Studio-Théâtre de Vitry. Comment cette implantation à long terme s’est-elle décidée ? Quelles furent ses MOTIVATIONS ?