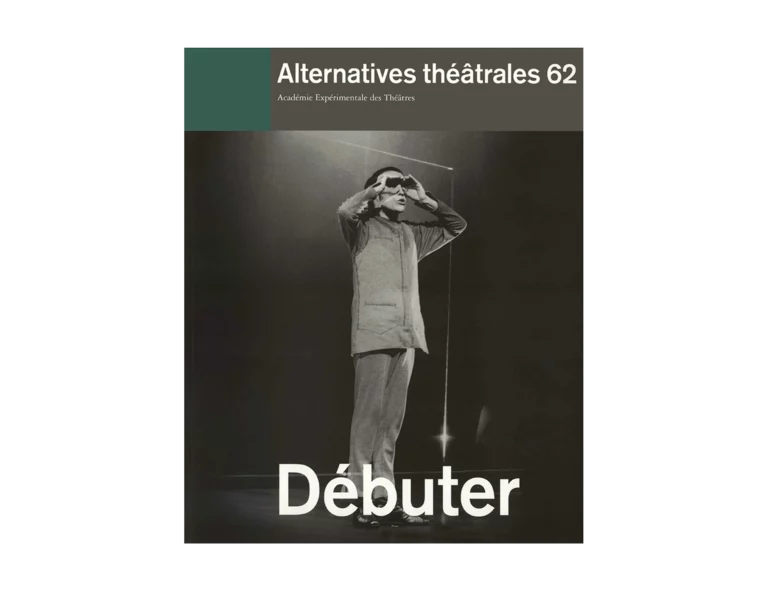MICHELINE ATTOUN : Notre première rencontre avec Jean-Pierre Vincent, c’était en novembre 1968, à Châlons, le soir de la première de son formidable spectacle LA NOCE CHEZ LES PETITS-BOURGEOIS au Théâtre de Bourgogne. Nous avions assisté au spectacle puis au débat qui suivit en présence de Jean-Pierre Vincent et de Jean Jourdheuil, ceux qu’on a appelés ensuite les « Brechtiens méchants ». À la fin de la soirée, un jeune homme nous a demandé si on pouvait le remonter à Paris. Il est monté dans notre voiture. C’était Jean-Pierre Vincent. Il nous a pourtant fallu 150 kilomètres et une crevaison sur l’autoroute pour m’en rendre compte.
Lucien Attoun : Les années de tes débuts me semblent être celles de la naissance d’une génération, formée par le théâtre universitaire, qui allait marquer le théâtre : en même temps que toi débutent Ariane Mnouchkine, Michel Bataillon, Jean-Claude Penchenat, Philippe Léotard, Jérôme Deschamps, Jacques Nichet, Georges Lavaudant, Patrice Chéreau… sous le regard fraternel de Bernard Dort. Avec le recul, comment relis-tu cette période ?
Jean-Pierre Vincent : C’était une aventure collective. On éprouvait le sentiment d’appartenir à une même génération, un sentiment comparable à celui que j’ai cru déceler, il y a cinq ou six ans, dans la nouvelle génération. Nous étions une génération qui s’est pour beaucoup constituée au travers du théâtre universitaire : il y a eu d’abord le Groupe Antique de la Sorbonne puis le Théâtre de l’Aquarium, le Groupe Théâtral du Lycée Louis-le-Grand, le Théâtre Universitaire de Nancy, le Théâtre Universitaire de Grenoble … C’était aussi le moment de la guerre d’Algérie, une époque de radicalisation des esprits et de politisation intense. Pour moi, les années essentielles auront plutôt été 1963 – 64, celles de la fédération nationale du théâtre universitaire ; l’invention théâtrale et l’engagement politique avaient alors partie liée. Nous faisions un théâtre fondé sur la connaissance, sur l’utilisation agressive de la connaissance envers nos aînés. Nous étions plus violents que ceux qui débutent aujourd’hui. Notre violence, nous l’exercions contre les pionniers de la décentralisation. Ils étaient reliés à Copeau, et Copeau, c’était celui qui avait plus ou moins pactisé avec Pétain en 1940, il représentait une esthétique littéraire française liée au catholicisme à la française, aux mandarins de l’université, à la France telle que nous la détestions. Aussi nous sommes-nous appuyés sur l’Allemagne, sur Brecht, sur la dramaturgie allemande en remontant jusqu’à Lessing pour dynamiter la dramaturgie française du bien-dire.
L. A. : Comment avez-vous débuté avec Jean Jourdheuil ?
J.-P. V. : Grâce à Jacques Fornier du Théâtre de Bourgogne. Il a fait appel à de jeunes metteurs en scène, à Lavelli, à Jourdheuil et à moi, à un certain nombre d’autres, pour venir travailler avec sa troupe. Nous avions avec lui un rapport très critique : il s’agissait de se servir de ses outils pour les transformer complètement. Il y avait à l’époque sept Centres Dramatiques Nationaux, cinq Maisons de la culture, une vingtaine de Compagnies de Théâtre et c’était tout. Nous voulions opérer un saut dialectique, reprendre et dépasser, contredire et dépasser. C’était simple et tranché. La situation actuelle est incomparable et, je crois, beaucoup plus difficile à penser et douloureuse à vivre.
L. A. : Mais avant de créer la Compagnie Vincent-Jourdheuil, tu avais travaillé avec Patrice Chéreau au Théâtre des trois Baudets, où Micheline et moi avions vu L AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE, à Sartrouville. Comment cela s’est-il passé ?
J.-P. V. : On avait fait du théâtre ensemble au lycée. Puis Patrice a signé sa première mise en scène FUENTE OVEJUNA de Lope de Vega. C’était un spectacle magnifique monté dans l’esprit de ses deux maîtres Brecht et Strehler : comme le faisait Brecht, il a adapté une pièce classique de façon à ce que le discours en devienne brechtien : chez Strehler, il puisait la sensualité, le goût des belles images et cela magnifait la lucidité critique qu’il exprimait. Chéreau était allé à Berlin et à Milan voir tous leurs spectacles. Il avait assimilé leur dramaturgie et tissait déjà son étoffe personnelle imprégnée de sa propre violence.
L. A. : Le Visconti de SENSO ne vous a‑t-il pas également influencé ?
J.-P. V. : Nous allions ensemble cinq fois par semaine à la cinémathèque, voir et revoir tous les Buster Keaton, les films d’Orson Welles, les westerns d’Anthony Mann. Je me rappelle que devant GO WEST de Buster Keaton, Chéreau hurlait tellement de rire qu’il a cassé un siège de la salle ; ça a déclenché la colère d’un cinéphile acharné, assis derrière lui, qui essayait de prendre des notes plan par plan. Nous avons donc beaucoup été influencés par le cinéma. Nous voulions que le théâtre en tant qu’art atteigne le même niveau d’attrait, de séduction, d’appel que le cinéma. C’était une époque nécessaire. Aujourd’hui, on revient aux outils proprement théâtraux du récit.
L. A. : Chéreau et toi avez monté votre premier spectacle en même temps : lui c’était FUENTE et toi LA CRUCHE CASSÉE.
J.-P. V. : Oui, et c’était très mauvais. Mon second spectacle l’année suivante était bien meilleur : c’était SCÈNES POPULAIRES d’Henri Monnier où Jérôme Deschamps et moi faisions un mémorable duo d’acteurs. Bernard Dort était venu au lycée voir le spectacle de Chéreau. Il avait emmené Bernard Sobel avec lui. Bernard Sobel qui revenait de Berlin-Est s installait tout juste à Gennevilliers. Il nous a proposé de faire un spectacle pour le Festival de Gennevilliers. C’est là que Claude Sevenier qui dirigeait le théâtre de Sartrouville (et le dirige encore) a proposé à notre compagnie de venir s’installer dans son théâtre de Sartrouville. Je jouais en général le rôle principal dans les spectacles de Patrice et, dans la journée, j’allais dans des lycées, j’en faisais cinq ou six par jour. J’avais une 4 C.V. et, pendant deux ans, j’ai sillonné la région de Sartrouville.
M. A. : Pour faire de l’animation ?
J.-P. V. : Oui. Nous jouions des spectacles assez violents, on se donnait des coups ; je perdais en général deux kilos par représentation. Ces spectacles ressemblaient à des matchs de rugby. J’étais épuisé. Au point d’en tomber malade. Mais heureux !
L. A. : J’y reviens : Comment as-tu rencontré Jean Jourdheuil ?
J.-P. V. : Je suis né dans une famille très éloignée du monde des arts. Au lycée, mon meilleur copain, qui voulait absolument faire du théâtre, m’a entraîné au groupe théâtral. C’est là que j’ai rencontré Chéreau. Je n’avais pas de vocation si ce n’est que j étais le meilleur imitateur comique de ma classe. Je suis toujours un imitateur comique qui a attrapé un certain nombre de capacités supplémentaires …