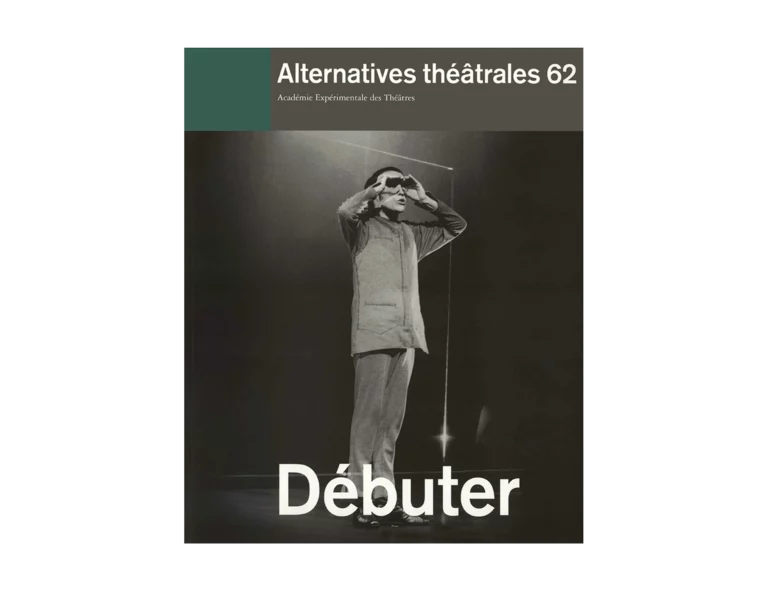COLETTE GODARD : Comment es-tu venu au théâtre ?
Jérôme Savary : En 1963, je suis allé faire mon service militaire dans mon pays natal, en Argentine. Le pays n’était pas encore dirigé par ses sinistres généraux. J’y suis resté sept mois et j’ai eu le temps de faire deux révolutions (!) évitant ainsi l’enrôlement français qui, en cette période d’après guerre d’Algérie, durait encore vingt-quatre mois. De retour en France, j’ai eu la nostalgie de Buenos Aires où je faisais des dessins dans une revue humoristique, une sorte d’Hara-Kiri argentin. J’avais appris à bien parler l’espagnol et à aimer le tango, ces magnifiques mélodrames de trois minutes.À Paris, ils me manquaient. Je me suis alors mis à fréquenter les bars sud-américains de Saint-Germain. C’est là que j’ai rencontré ma première femme, la comédienne vénézuélienne Ilcia d’Aubetère, et, grâce à elle, deux grands metteurs en scène : Victor Garcia et Jean-Marie Serreau. Victor Garcia était fier comme un torero, et, malgré sa petite taille, semblait vous regarder de haut. Il refusait d’utiliser le plastique, mais se servait à la place de vessies de porc, de peaux d’animaux ; un écologiste avant l’heure. C’était un metteur en scène chrétien dans le sens Monty Python. Mais ses mises en scène n’étaient pas toujours très drôles…
Jean-Marie Serreau avait un œil de verre et l’habitude de se le gratter avec sa fourchette quand il déjeunait avec des gens importants. Ce qui nous faisait beaucoup rire. À l’époque il montait le théâtre de Beckett avec Delphine Seyrig et Michael Lonsdale au Pavillon de Marsan.
Ce sont ces rencontres qui m’ont conduit à entrer dans le monde du théâtre. J’avais fait l’École des Arts Décoratifs de Paris et j’ai commencé par faire des décors pour Jean-Marie Serreau. Je me souviens du décor projeté que j’avais conçu pour LA TRAGÉDIE DU ROI CHRISTOPHE. Et puis, pour ne pas avoir l’air ignorant aux côtés de ma femme qui travaillait avec des metteurs en scène novateurs, j’allais aussi à l’école, dans cette école formidable qui s’appelait l’Université du Théâtre des Nations où allait aussi Jorge Lavelli. Elle était dirigée par André-Louis Perinetti. Les cours avaient lieu dans les combles du Théâtre Sarah Bernhard. Nous étions de toutes nationalités, il y avaient parmi nous des Turcs, des Américains … On était des espèces d’internationalistes théâtraux qui étudiaient toutes les utopies existantes. Un jour Che Guevara est venu nous donner un cours. Il accompagnait les ballets d’Alicia Alonso qui se produisaient à côté, au théâtre des Nations. Che Guevara était en « battle dress » avec son béret légendaire et ses yeux bleus, un peu gras. (On oublie souvent que le Che était un peu gras, et qu’il n’a été maigre que le jour de sa mort, épuisé par sa longue marche dans la Sierra Madre.) Après le cours, il y a eu une petite réception. C’est alors que je suis allé vers lui pour le provoquer : « Comment est-il possible qu’un leader révolutionnaire de votre ampleur soit là en train de boire du champagne avec Alicia Alonso ? » Le Che m a pris par la manche et m’a dit : « Viens, on va boire un coup. » Nous sommes descendus au bistrot qui se trouvait à gauche de l’actuel Théâtre de la Ville et nous avons passé crois quarts d’heure à boire du rouge et à manger du saucisson. En partant, il m’a dit en espagnol : « T’en fais pas petit, bientôt tu entendras parler de moi. » Et de fait, la semaine suivante, il partait à Cuba et y déclarait publiquement renoncer à la citoyenneté cubaine, à toutes ses médailles et privilèges. Il est ensuite parti chez Kabila au Congo et y a connu le fiasco que l’on sait avant d’entamer son long chemin de croix en Bolivie.
Voilà comment j’ai commenté. Je dois dire que j’étais aussi un peu comédien, et musicien : j ai un jour remplacé au pied levé un acteur malade de Victor Garcia ;il m’a ensuite donné un rôle dans UBU ROI.
Pour impressionner ma Jeune épouse, j’ai fondé dès ce moment-là ma propre compagnie et je lui ai confié le rôle d’administratrice.
C. G.: Mais ce n’était pas encore le Magic Circus.
J. S.: Pas du tout. J’étais alors seulement scénographe et comédien.
C. G.: Mais alors, comment en es-tu venu à créer le Magic Circus ? Cela s’est fait en plusieurs étapes, je crois.
J. S.: Oui. J’ai d’abord fondé une compagnie qui portait mon nom, (Comme ça on est sûr d’apparaître sur les affiches !) J’avais écrit deux pièces en Un acte. Lune s’appelait L’INVASION DU VERT OLIVE, c’était l’histoire d’une couleur, la couleur vert olive, qui envahissait toute une ville. Du Ionesco revisité. Lautre s’appelait LES BOÎTES et racontait l’histoire de gens qui vivent dans des boîtes en carton. Cette fois-ci, je subissais l’influence de Beckett. Alain Crombecque nous a invités à jouer ces deux pièces dans un festival universitaire, sous un chapiteau rue de la Contrescarpe au printemps 1965. Avant nous, des gardes rouges chinois montaient sur scène, et après nous, il y avait un défilé de Rabanne. Les charmantes petites chinoises en uniforme Mao étaient dans les loges voisines des nôtres ; nous avons vainement essayé de les draguer. Il faut dire aussi qu’on était déguisé en travelo (on faisait déjà les drag queen !). Et puis nous avions déjà mis des poules sur la scène. (Si vous voulez fonder une compagnie, engagez des animaux. Il n’y a ni Ursaff ni Assedic à payer et si les affaires vont vraiment mal on peut toujours les manger.) Arrabal était venu nous voir, vêtu d’une écharpe rouge, d’une cape en soie et d’un chapeau aux larges bords, il faisait penser à un mélange de Vincent Scotto et de Dali. Il était venu me dire que le spectacle lui avait vraiment plu. Au point de m’imposer comme metteur en scène au théâtre Daniel Sorano qui avait décidé de monter sa pièce LE LABYRINTHE. C’est grâce à cette rencontre que je suis sorti de l’ombre : Arrabal était déjà à l’époque un auteur extrêmement célèbre.
Je me souviens qu’il y avait un long monologue silencieux au beau milieu du spectacle par ailleurs terriblement bruyant : un personnage dansait silencieusement pendant cinq minutes. Et un soir, pendant ce monologue, une cane a pondu un œuf sur scène. C’était un moment de grâce : on était de plain-pied avec l’univers des dessins d’Arrabal.
Le spectacle a fait scandale. On avait fait un tract imprimé sur du papier hygiénique, parce que le personnage qui symbolisait le Christ, chaque fois qu’il avait un problème, se mettait la tête dans une cuvette de chiottes et Je tirais la chasse d’eau. Poirot Delpech était venu nous voir, je me souviens avoir parlé avec lui dans le métro — à ce moment-là, c’était encore possible. Mais c’est grâce à Dutour qu’on a été lancé : il a écrit une critique très violente. On a repris le spectacle à Francfort, puis le Mercury Theater de Londres nous a invités. Mais au même moment se sont déclenchés les événements de mai 1968 et mon acteur principal, Jacques Coutureau, occupait le Théâtre de l’Odéon. Je suis allé le voir pour essayer de le convaincre de venir avec nous à Londres. Mais j’ai été tellement dégoûté par la conduite des insurgés, une bande de ringards ratés et minables qui essayaient d’humilier Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, que je suis parti sans lui. À Londres nous avions donc dû modifier la pièce, et on l’a appelé le Panic Circus. C’était l’ancêtre du Magic. Les Beattles sont venus nous voir, encore une de mes rencontres importantes ; David Bowie jouait dans la pièce, il était absolument charmant en tutu. Le spectacle a connu un grand succès de presse.
C. G.: Il avait un côté Monty Python.
J. S. : Le spectacle était assez british. Je suis d’ailleurs d’origine irlandaise par ma mère.
C. G.: Mais c’est à New-York qu’est vraiment né le Magic Circus ?
J. S. : Oui, Ellen Steward était venue voir le spectacle à Londres et nous y avait invités. On a joué à la Mamma puis à l’Extension Theater, mais on manquait d’argent. C’est alors qu’on a eu l’idée de faire des parades dans Central Park, les premières parades du Magic Circus où l’on faisait la quête.
C. G.: De retour à Paris, Jean-Louis Perinetti t a invité à jouer ton spectacle ZARTAN au Théâtre de la Cité Internationale. Personne ne vous connaissait et pourtant dès le premier jour, une foule incroyable s’est rassemblée pour venir vous voir. Personne ne comprenait pourquoi.
J. S.: Je me souviens d’un article de Mathieu Galley qui disait : « mille personnes rient, se roulent par terre et je ne comprends pas pourquoi. » Il y a eu une espèce de phénomène de contagion. Le théâtre est à mon sens le seul art qui soit véritablement vivant. Contrairement aux cinéastes ou aux sculpteurs, nous sommes biodégradables, nous ne laissons pas de détritus derrière nous. Le seul théâtre qui m’intéresse est celui qui instaure un vrai dialogue avec le public. Et je crois que c’est cela qui a fait fonctionner ZARTAN. On jouait parmi les spectateurs, comme Ariane Mnouchkine dans 1789, et le fait d’être au milieu d’eux faisait naître une espèce de complicité, une excitation festive ; et puis il y avait de jolies filles, de jolis garçons aussi.
C. G. : Je crois surtout que tu as su faire ce spectacle au bon moment : le public attendait ZARTAN sans le savoir. C’était une parodie du cirque, un décalage sur le cirque, mais qui exploitait en même temps tous les trucs du cirque. Voilà à mon sens l’un de tes grands talents : savoir tomber juste, faire les spectacles qu’il faut au moment voulu.
J. S. : Je crois que c’est parce que je ne sors pas de Normal Sup. Je me suis toujours confronté à la réalité, j’essaye de comprendre comment elle fonctionne, j’écoute ce que les gens disent dans la rue ou au bistrot. Et d’autre part je n’ai pas l’obsession de bâtir une œuvre personnelle. Peu m’importe de laisser des traces. Je pratique un art biodégradable que je refais au jour le jour, comme le boulanger son pain. Et puis je n’avais aussi pas d’autres choix que de tomber juste : j’ai fait quinze ans de théâtre sans subvention avec une équipe qui n était Jamais inférieure à trente personnes. C’est d’ailleurs parce qu’on ne trouvait pas de ressources sufhsantes en France qu’on est allé à l’étranger. Comme aujourd’hui ceux de Jérôme Deschamps et de Macha Makeieff, comme ceux de Bartabas, nos spectacles étaient d’abord visuels et pouvaient être reçus partout. Nous nous sommes produits en Allemagne, aux Étas-Unis, en Espagne ou en Italie, et à chaque fois nous jouions dans la langue du pays. Michel Dussarrat par exemple est capable de jouer le même rôle en quinze langues : c’est absolument hallucinant. et je ne comprends pas pourquoi. » Il y a eu une espèce de phénomène de contagion. Le théâtre est à mon sens le seul art qui soit véritablement vivant. Contrairement aux cinéastes ou aux sculpteurs, nous sommes biodégradables, nous ne laissons pas de détritus derrière nous. Le seul théâtre qui m’intéresse est celui qui instaure un vrai dialogue avec le public. Et je crois que c’est cela qui a fait fonctionner ZARTAN. On jouait parmi les spectateurs, comme Ariane Mnouchkine dans 1789, et le fait d’être au milieu d’eux faisait naître une espèce de complicité, une excitation festive ; et puis il y avait de jolies filles, de jolis garçons aussi.
C. G. : Je crois surtout que tu as su faire ce spectacle au bon moment : le public attendait ZARTAN sans le savoir. C’était une parodie du cirque, un décalage sur le cirque, mais qui exploitait en même temps tous les trucs du cirque. Voilà à mon sens l’un de tes grands talents : savoir tomber juste, faire les spectacles qu’il faut au moment voulu.
J. S.: Je crois que c’est parce que je ne sors pas de Normal Sup. Je me suis toujours confronté à la réalité, j’essaye de comprendre comment elle fonctionne, J’écoute ce que les gens disent dans la rue ou au bistrot. Et d’autre part je n’ai pas l’obsession de bâtir une œuvre personnelle. Peu m’importe de laisser des traces. Je pratique un art biodégradable que je refais au jour le jour, comme le boulanger son pain. Et puis je n’avais aussi pas d’autres choix que de tomber juste : j’ai fait quinze ans de théâtre sans subvention avec une équipe qui n’était Jamais inférieure à trente personnes. C’est d’ailleurs parce qu’on ne trouvait pas de ressources suffisantes en France qu’on est allé à l’étranger. Comme aujourd’hui ceux de Jérôme Deschamps et de Macha Makeieff, comme ceux de Bartabas, nos spectacles étaient d’abord visuels et pouvaient être reçus partout. Nous nous sommes produits en Allemagne, aux Étas-Unis, en Espagne ou en Italie, et à chaque fois nous jouions dans la langue du pays. Michel Dussarrat par exemple est capable de jouer le même rôle en quinze langues : c’est absolument hallucinant.