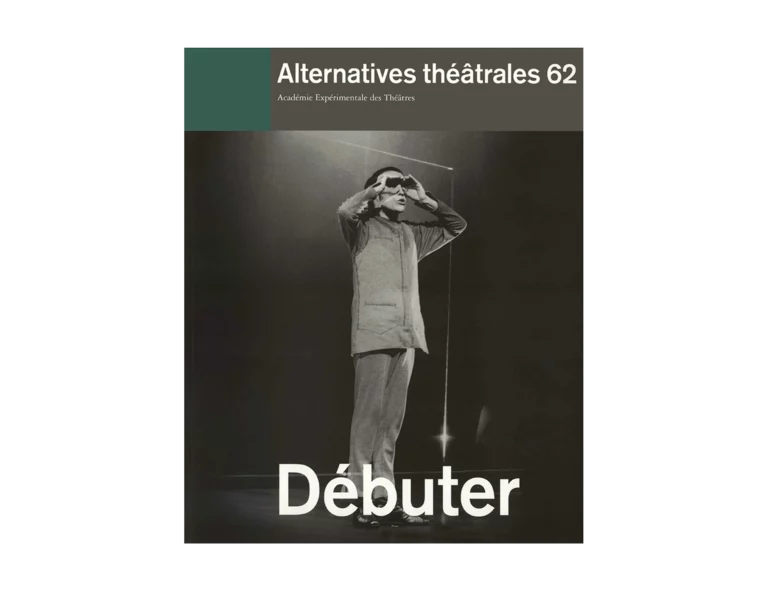FABIENNE VERSTRAETEN : Tu as présenté il y a un an, à Bruxelles, MARINS SINBAD, ton cinquième spectacle. Comment en es-tu arrivé là ? Pourrais-tu revenir sur le parcours qui aboutit à ce spectacle ?
Manuel Pereira : Je ne peux pas parler de parcours sans préciser que l’écriture a été là bien avant la mise en scène, qu’elle m’accompagne depuis très longtemps. La mise en scène commence vraiment en 1995, avec THÉSÉE ( VARIATIONS ). un texte que j’ai écrit moi-même. La même année j’ai collaboré avec Thierry Salmon à l’écriture et à la mise en scène de FAUSTAE TABULAE qui a été joué au Kunsten Festival des Arts à Bruxelles et à Bologne. Dans la foulée, toujours en 1995, le Festival Intercity de Florence m’a passé commande d’un spectacle — je suis d’origine portugaise et le Festival avait pour thème « Lisbonne » ; j’y ai présenté UN FADO PER SINBAD. Tout de suite après, Philippe Delaigue, metteur en scène de la Compagnie Travaux 12 et aujourd’hui directeur de la Comédie de Valence, m’invitait en résidence d’écriture pour trois mois, ce qui m a permis d’écrire une autre pièce, SOLDAT RUIZ. En 1996 j’ai mis en scène un petit spectacle à Bruxelles, au Plan K., POLZOUNKON, d’après une nouvelle de Dostoïveski. Puis l’échange avec Philippe Delaigue, à Valence, s’est poursuivi. J’ai proposé en 1997 un stage pour comédiens professionnels sur le thème de la parole révolutionnaire, à travers des textes historiques de la Révolution russe, LA DÉCISION de Brecht et MAUSER de Müller. À l’issue de ce stage, un groupe de comédiens m’a demandé de transformer ce travail en spectacle. L’idée de prolonger aussitôt cette première recherche me plaisait, et le spectacle fut créé la même année. Il s’appelait MAKHNO, UNE HISTOIRE DES PAYSANS INSURGÉS D’UKRAINE. Il ne s’agissait pas d’incarner des personnages historiques, mais d’interroger et de prendre en charge une parole dans l’optique d’un théâtre documentaire. Ce fut une expérience de théâtre « dévoilé », où étaient exprimés ouvertement sur la scène nos difficultés, nos désirs et nos doutes quant à l’expérience communautaire des communes libres d’Ukraine. C’est durant la tournée de ce spectacle en 1998, que j’ai créé MARINS SINBAD, à Bruxelles, avec le soutien d’Isabelle Pousseur et de Michel Boermans du Théâtre Océan Nord, troisième étape de travail sur le thème du nomadisme et de l’errance, après Clermont-Ferrand et Florence. Dans cette troisième étape, j’ai voulu inclure, dans un souci plus documentaire, les témoignages de migrants contemporains à mes propres textes, à la musique et à l’improvisation des comédiens. Il y a là une matière énorme dont je ne suis toujours pas venu à bout. Ce thème de la migration et du déracinement me touche intimement, puisque j’ai quitté mon père et le Portugal et traversé la frontière clandestinement à l’âge de cinq ans.
F. V.: En quatre années, tu as réalisé énormément de choses !
M. P.: Oui, peut-être trop, souvent trop vite. C’est pourquoi, après ce dernier spectacle, j’ai voulu m’arrêter pendant quelque temps. Avec le recul, c’est comme si j’avais réalisé une série de spectacles de formation personnelle. Ils m’ont permis d’explorer et de préciser ce que je cherche dans le rapport au public, dans la direction d’acteurs … Avant de me lancer dans de nouveaux projets, j’ai besoin d’assimiler tout cela, de comprendre ce que je fais, pourquoi ce théâtre-là. Cela fait du bien de retrouver le rythme de la réflexion, de l’écriture, de la contemplation. C’est aussi pour moi une façon de résister au « marketing » du théâtre, qui oblige à un rendement, à une production régulière : sans nous en rendre compte nous finissons par confondre le rythme de notre nécessité intérieure avec celui des exigences de production, peu à peu nos spectacles se font malgré nous. Nous sommes déjà dans le rythme, les désirs et les attentes des autres, alors que nous croyons encore que ce sont là notre propre ryhtme, nos propres envies, nos purs désirs.
Après SINDBAD, dans la vie comme au théâtre, j’avais l’impression d’en être resté aux prologues, comme si je n’avais fait que jeter les bases de plus vastes projets… Il fallait à présent aborder les chapitres. J’ai traversé une longue période de doute : je n’arrivais même plus à écrire une phrase, cout cela me paraissait vain, le théâtre, la littérature. Au même moment il y a eu la mort de Thierry Salmon.
F. V.: Puisque tu parles de Thierry Salmon, le metteur en scène qui a accompagné tes débuts, peux-tu retracer ce qui a précédé cette rencontre ?
M. P.: J’ai commencé à faire du théâtre en France, à Clermont-Ferrand, au Conservatoire de région, puis au sein d’une petite compagnie que j’avais montée avec des amis. Nous nous sommes produits dans de petits festivals. Puis je me suis concentré sur mes études de philosophie jusqu’en deuxième année. C’est à ce moment-là que j’ai travaillé pour la première fois sur le thème de Sindbad, avec quelques amis. C’était mon premier essai de mise en scène, et ça s’est très mal passé. J’avais présumé de mes capacités. Très vite, les rapports avec les comédiens sont devenus conflictuels. Cette expérience pénible a été le détonateur pour moi : soit j’abandonnais tout, soit je me donnais les vrais moyens de résoudre ces difficultés. J’ai choisi de quitter Clermont-Ferrand et de suivre une formation. Je voulais surtout acquérir une assurance en direction d’acteurs. J’ai passé le concours de l’INSAS1 en 1992. J’ai beaucoup appris en première année et Je suis parti au milieu de la deuxième ; j’avais fait l’expérience de ce que je cherchais : travailler avec des gens, en confiance, se donner le droit à l’erreur, se permettre de douter. C’est d’ailleurs venu très vite, dès les épreuves du concours d’entrée. Pour le reste, j’avais vingt-cinq ans, je me sentais un peu en décalage par rapport à d’autres étudiants plus jeunes et j’avais envie de passer à la mise en scène. Certains séminaires m’ont beaucoup apporté :celui d’Anne-Marie Loop, une comédienne pour qui j’ai un grand respect, celui d’Éric Pauwels en cinéma, qui est venu tenter avec nous une recherche sur Œdipe. Il nous a concrètement fait sentir combien chaque geste, élément, accessoire, est signifiant sur le plateau, ou encore les cours de Jean-Marie Piemme qui a été un des premiers lecteurs de THÉSÉE ( VARIATIONS ).
Quand j’ai écrit cette première pièce, je n’étais pas tout à fait novice. J’écrivais depuis longtemps. Au lycée j’ai eu la chance d’avoir un excellent professeur de français qui est devenu un ami et un lecteur précieux. Avec lui j’ai expérimenté de l’intérieur ce qu’est une métaphore, une correspondance poétique. Je me souviens de la phrase qui m’en a fait prendre conscience : je voulais exprimer une place inondée de soleil, marquée par les ombres des arbres, et j’ai trouvé cette image « une place mouillée d’ombre » … J’ai donc fait mes premières expériences littéraires et poétiques en France, mais c’est en Belgique que j’ai connu mes expériences théâtrales les plus fortes. Et c’est Jean-Marie Piemme qui m’a fait sentir à quel point l’acte théâtral est aussi un acte politique, au sens fort. Par la suite, la pratique de Philippe Delaigue à Valence a confirmé sur le terrain ce sens politique : il avait monté LES DERNIERS JOURS DE L’HUMANITÉ de Karl Kraus et LA VIE DE GALILÉE de Brecht. J’ai commencé à écrire THÉSÉE (VARIATIONS) au moment de mon départ de l’INSAS. J’en ai donné une première lecture publique au Botanique avec deux comédiens, Pierre Renaux et Paul Camus. Puis j’ai envoyé le manuscrit à plusieurs personnes parmi lesquelles Thierry Salmon et Enzo Cormann qui m’a répondu et dont la lettre m’a énormément encouragé. Thierry Salmon est venu assister aux premières répétitions en février 1995 à l’Atelier Saint Anne et c’est à ce moment que nous nous sommes réellement rencontrés.
F. V.: Quelle est la filiation de THÉSÉE ( VARIATIONS), quelles sont les écritures qui t’ont marqué ?
M. P.: THÉSÉE ( VARIATIONS) condensait une série de choses que j’avais accumulées depuis des années. On sentait une urgence dans ce texte. C’était une sorte d’exorcisme. J’ai très vite perçu l’écriture théâtrale comme une lutte entre la littérature et le théâtre : la littérature, la langue résistent au théâtre ; mais à la fin le théâtre doit réussir à s approprier la langue la plus récalcitrante, cette matière qui lui est réfractaire. J’ai été influencé par des auteurs dont l’écriture manifeste cette lutte : pour le théâtre Büchner, Müller dont j avais travaillé quelques textes à l’INSAS, Koltès aussi pour sa langue « métèque » ; puis, en marge du théâtre, Artaud surtout, Pasolini, Guyotat, tous ceux qui ont pétri et déconstruit la langue depuis Rimbaud d’UNE SAISON EN ENFER… Dans T’HÉSÉE ( VARIATIONS ), tout l’enjeu pour moi était de mettre en chair, de rendre vivante à l’extrême une langue qui résiste à la chair comme au théâtre. Dans ce travail, j’ai l’impression d’être allé au bout d’un questionnement. L’élaboration du texte s’est étalée sur un an, il me fallait « épuiser le thème » comme dit Müller, « dévorer toute cette matière pour la recracher ensuite », c’était le seul moyen de m’en défaire. Je suis arrivé aux répétitions très confiant, avec l’envie que les comédiens, Pierre Renaux et Fabrice Rodriguez, s’approprient ce texte, me l’enlèvent, me le rendent à nouveau étranger. J’ai pu me concentrer sur le travail gestuel : travailler le texte par le corps. Je ne voulais absolument pas tomber dans un théâtre de texte tel qu’on le pratique la plupart du temps en France, mais réussir à donner de la chair aux mots au sens où l’entendait Artaud, « faire danser l’anatomie humaine ».
On a joué le spectacle dans la cave du théâtre Le Public. Les spectateurs étaient accueillis dans un bar, le Gambrinus, et on les menait à travers les rues jusqu’à cette cave qui n’était pas encore aménagée. Les conditions de travail étaient éprouvantes, il fallait tenir avec peu de moyens, lutter pour imposer chaque idée. Malgré tout, le résultat fut artistiquement rigoureux, exigeant, intègre dans sa démarche et depuis je n ai plus retrouvé le sentiment d’être allé ainsi au fond des choses.
F. V.: Sur le plan institutionnel, comment cela s’est-il passé pour THÉSÉE ( VARIATIONS ) ?
M. P.: J’avais travaillé sur SABENA mis en scène par Jean-Christophe Lauwers à l’Atelier Saint-Anne Les directeurs du théâtre, Serge Rangoni et Benoît Vreux, avaient vu mon travai et quand je leur ai parlé du projet de monter THÉSÉE ( VARIATIONS ), ils m ont proposé comme soutien une salle de répétitions et la prise en charge de la promotion. J’ai aussi remis un dossier à la C.C.A.P.T.2, qui a été accepté. Le dossier était blindé, avec une analyse dramaturgique plutôt dense. J’y posais la question du crime sur lequel est bâtie notre civilisation, depuis la fondation des cités grecques. Vaste programme … Car si ma pièce se situe dans le Sao Polo contemporain, elle raconte en filigrane la rencontre mythique de Thésée et du Minotaure Une confrontation qui interroge la question du sacrifice nécessaire, le sacrifice des monstres, de la part irrationnelle, de l’animalité, d’une violence archaïque, pour fonder la cité de la raison. Pour moi THÉSÉE (VARIATIONS) raconte ce passage du temps du mythe au temps du logos. J’avais aussi cherché à relier le théâtre et la musique, en incluant trois musiciens de flamenco dans le spectacle. Je voulais cet accompagnement archaïque qui venait soutenir le rythme de la langue : enclume, barre de fer, cane en bois, cajon, guitare, chant. J’ai donc reçu l’aide de la C.C.A.P.T. au premier projet, Soit une somme de huit cent mille francs belges (130 000 FF).