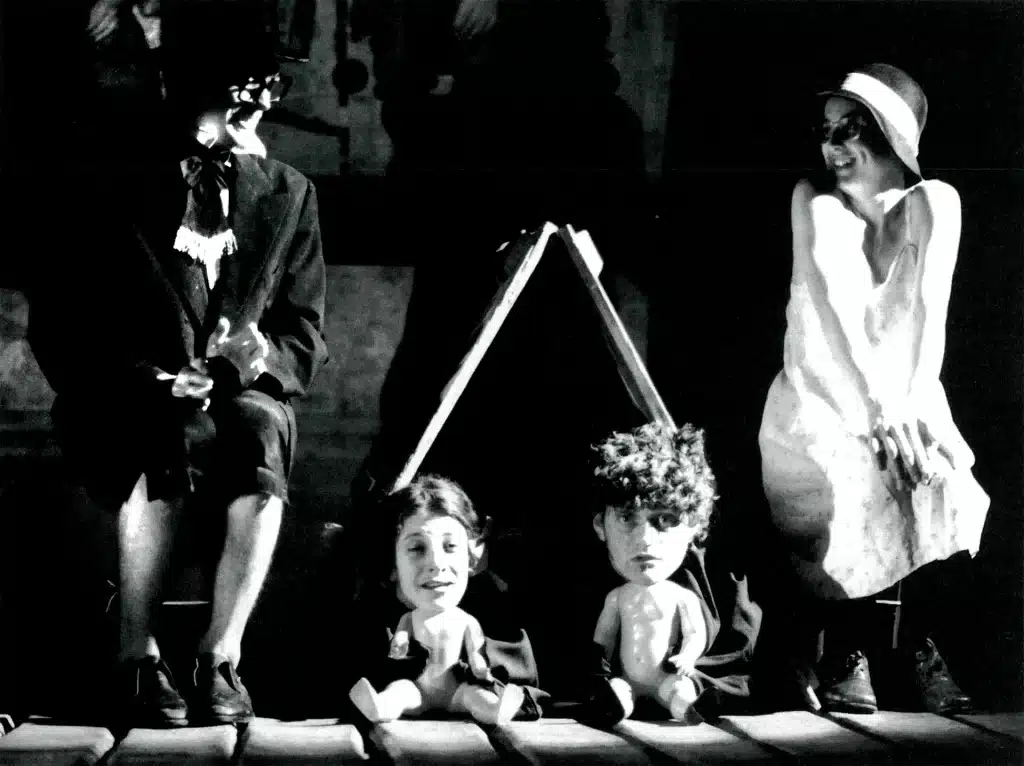ALTERNATIVES THÉÂTRALES : Vous dirigez la programmation du spectacle vivant au Singel à Anvers. Pourriez-vous rappeler comment s’est manifesté votre intérêt pour le théâtre d’Europe de l’Est ?
Myriam De Clopper : Nous avons accueilli depuis des années des compagnies d’Europe de l’Est, et ce d’une façon très régulière. Le premier grand festival que nous avons organisé a eu lieu en juin 1989, en pleine période de Glasnost, avant même la chute du Mur. Il s’appelait « Les Russes viendront ». Nous nous étions exclusivement concentrés sur l’immense Russie ; nous n’avons donc pas présenté de spectacles venus de l’Europe centrale. Notre problématique était politique : nous voulions dresser un état des lieux. Nous collions à l’actualité, c’est pourquoi il était, je crois, encore trop tôt pour percevoir Les conséquences de ce bouleversement politique sur Le théâtre. Le festival était tout autant théâtral que musical et architectural : on a pu, pendant tout un mois, assister à des concerts rock, voir des expositions d’architecture. En 1991, quand Boris Eltsine a pris le pouvoir, Les républiques soviétiques de l’Asie centrale ont acquis leur indépendance les unes après les autres. Nous avons alors ressenti l’envie de nous interroger sur les différentes identités culturelles de ces républiques, très influencées par la culture islamique : dans quel état se trouvaient-elles après ce presque siècle d’impérialisme soviétique ? Ce questionnement a abouti en 1993 à un festival consacré au théâtre de l’Asie centrale. Puis aujourd’hui, une décennie après la chute du Mur, nous avons pensé justifié de dresser une sorte de bilan. Mais c’est seulement grâce à l’initiative de THEOREM que la décision d’organiser un festival s’est effectivement prise. Le projet avait d’abord une dimension artistique :il était guidé par la curiosité de voir et de donner à voir ce qui était artistiquement bien là-bas ; mais il avait aussi une dimension politique : il s’agissait d’interroger une utopie, l’utopie culturelle européenne — ce n’est pas par hasard que nous avons appelé notre festival « Europa/Utopia ». En vérité l’Europe unifée n’a jamais existé, c’est vraiment une utopie. Par contre, nous avons des points en commun , il s’agissait de déterminer lesquels afin de dépoussiérer les préjugés, de changer quelque peu les mentalités, la façon qu’a l’Ouest de concevoir l’Europe centrale et orientale : elle ne se résume pas à la maña, aux réfugiés et aux immeubles HLM gris et tristes. Pour revenir à la question initiale, l’intérêt que nous avons pour le théâtre de l’Est est aussi, évidemment, lié à la grande tradition théâtrale de ces pays : ce sont eux qui ont donné le jour à la plupart des grands dramaturges, pédagogues et théoriciens du théâtre contemporain. Les écoles d’acteurs sont remarquables, il n’y a qu’à voir le travail des comédiens du Théâtre Stary pour s’en persuader. Je suis également frappée par la grande intelligence alliée à la grande culture des jeunes metteurs en scène que nous avons rencontrés ; ils ont un réel don pour l’analyse des textes. C’est pourquoi le mépris ou le désintérêt à leur égard n’a absolument aucune raison d’être.
A. T.: Y a‑t-il des spécificités propres au théâtre de chacun des pays d’Europe de l’Est, ou bien la diversité est-elle telle qu’elle interdit tout regroupement sous une même bannière ?
M. De C.: Il y a en effet beaucoup de différences entre chacun de ces pays ; des différences comparables à celles qui existent entre le théâtre allemand et le théâtre français par exemple. Mais ce qui les rassemble, c’est qu’ils ont baigné dans la même sauce soviétique pendant de nombreuses années. Et cela les a bien entendu très fortement marqués, sur le plan structurel mais également d’un point de vue esthétique. Quand on se promène dans les villes, on voit la mesure du changement, la vitesse galopante à laquelle il s’effectue ; mais il n’en reste pas moins des traces des temps passés, des bâtiments à l’architecture uniforme. Après tout, ça ne fait que dix ans que le régime a chuté. Les deux pôles coexistent : d’un côté l’empreinte soviétique et de l’autre l’élan du changement qui cherche à accentuer chaque identité nationale. On le constate à regarder Les architectures des villes : les nouveaux bâtiments affichent une couleur locale évidente. On retrouve ces deux pôles dans le paysage théâtral : la tradition à côté des forces novatrices. En général, les jeunes metteurs en scène s’intègrent assez facilement aux institutions.
La Pologne, par exemple, reste un pays phare sur le plan théâtral (d’ailleurs, pratiquement toute la région baltique est très vivante dans le domaine du théâtre); Krystian Lupa et son élève Grzegorz Jarzyna en sont la preuve. Jarzyna reste fortement attaché à la tradition du grand répertoire du dix-neuvième siècle. À l’âge de trente ans, il se trouve déjà à la tête d’une grande institution théâtrale, le théâtre Rozmaitosci. Et si l’on va dans un pays voisin, en Lituanie par exemple, on sera frappé par le grand élan novateur qui le traverse. Quand nous sommes allés à Vilnius l’année dernière, l’atmosphère artistique et intellectuelle était étonnante. Pourquoi une telle vitalité artistique existe-t-elle dans un certain pays et non pas dans un autre ? Il parait que la Lituanie, néanmoins tout petite, dispose d’une grande tradition culturelle. Le metteur en scène Lituanien Oskaras Korsunovas y travaille autour des textes contemporains et s’adresse principalement à un public jeune. Prenons un autre exemple, celui de Zagreb en Croatie où nous sommes allés cette année, juste avant les élections de février 2000. Peut-être que la situation a, depuis, complètement changé, mais à ce moment-là, le pays semblait encore très marqué par le régime autoritaire de Tudjman. Alors qu’on s’imagine la Croatie comme un pays assez proche de l’Occident, j’ai été frappé de voir que les jeunes metteurs en scène qui émergeaient n’étaient pas encore sortis du campus universitaire. Le théâtre de répertoire à Zagreb était encore ensommeillé.
Je souhaite plutôt parler d’individus en particulier et des rencontres que j’ai faites car je n’ai pas assez voyagé dans chaque pays pour pouvoir m’exprimer de façon générale. Il y a tout de même une attitude que l’on retrouve chez tous les jeunes metteurs en scène : c’est le désintérêt pour tout ce qui touche au politique. La politique est à leurs yeux synonyme de corruption et de pressions idéologiques. Ils sont très individualistes, et agissent en réaction à La façon dont on faisait du théâtre avant 1989. C’est caractéristique de cette époque de transition. Il n’y a qu’à regarder les résultats des élections : ils sont majoritairement conservateurs. On constate aussi un très fort regain de la religion. Nous l’avons immédiatement ressenti à Zagreb mais aussi en Roumanie. Nous étions à Bucarest durant la guerre du Kosovo. La population orthodoxe était très partagée ; elle veut absolument « plaire » à l’Ouest, mais à cause de leur religion commune sympathisait avec les Serbes. Lors du même voyage, nous avons passé le week-end de la Pâques orthodoxe B‑bas. Or, le samedi soir, les rues étaient mortes, il n’y avait rien d’autre à faire que d’aller à l’église assister à la messe de minuit, ce que nous avons fait avec les jeunes metteurs en scène et les acteurs qui étaient nos hôtes. Ce retour vers la religion est aussi une manière de réagir. Il est toutefois indéniable que bon nombre d’artistes d’aujourd’hui sont traversés par un questionnement religieux. Lupa par exemple est très mystique et il s’interroge, comme Jarzyna d’ailleurs, sur la moralité, le bien et le mal, comme le prouvent leurs adaptations des romans de Dostoïevski, LES FRÈRES KARAMAZOV et L’IDIOT. D’un autre côté, nous avons pu constater avec surprise que les barrières culturelles ont presque disparu entre l’Est et l’Ouest. Bien sûr qu’il y a toujours un mur économique entre les deux Europes. Mais plus un mur culturel : les informations, la mode, la musique des jeunes circulent absolument librement, comme les biens. Ce qui n’est pas le cas pour la diffusion des spectacles de l’Est à l’Ouest. C’est de cette constatation qu’est né le projet de THEOREM.
A. T.: Comment expliquez-vous ces contradictions avec d’une part un traditionalisme exacerbé et d’autre part une grande modernité formelle ?
M. De C.: À mon avis, les artistes de l’Est ne sont pas révolutionnaires dans leur pensée politique. Mais les artistes de l’Ouest le sont-ils davantage ? De part et d’autre, j’ai pu retrouver un langage commun qui exprime un même individualisme. Mais dans les formes, je constate qu’il n’y a pas vraiment beaucoup de différence avec ce qui se passe ici, regardons par exemple ROBERTO ZUCCO d’Oskaras Korsunovas ou LA TRAGÉDIE DE L’HOMME de László Hudi. D’ailleurs, j’ai voyagé surtout dans des pays qui par leur tradition et leur histoire sont dans une relation de proximité avec l’Occident : la Pologne, la Hongrie et même la Tchèquie… Ils connaissent une certaine santé économique et politique et ont donc de l’énergie à consacrer à leur développement culturel. Il y a des pays que nous n’avons pas pu visiter. Comme l’Albanie par exemple. Les voyages que j’ai effectués (par pragmatisme d’abord : je fais avant tout de la prospection pour le Singel), les rencontres que j’ai faites en partie grâce à nos relais que sont les fondations Soros par exemple, me permettent simplement d’avoir des impressions, en aucun cas de théoriser sur l’état du théâtre dans ces pays. Et c’est vrai que ces impressions sont parfois contradictoires ; ça ne fait que dix ans que le Mur est tombé, et nous sommes en pleine transition, incapables de prévoir ce que ce théâtre sera demain. Nous nous occupons du théâtre, mais il est vrai, comme le soulignait Bernard Faivre d’Arcier lors de sa conférence au Singel en février dernier que la question de l’Europe culturelle ne peut pas être dissociée de la problématique de la démocratie aussi bien à l’Ouest avec l’Autriche qu’à l’Est, où la Russie mène une guerre sauvage en Tchétchénie. Les artistes se doivent aussi de prendre position. Leurs discours se gardent aujourd’hui de toute position politique, espérons que cela changera avec Le temps.
Propos recueillis par Julie Birmant.