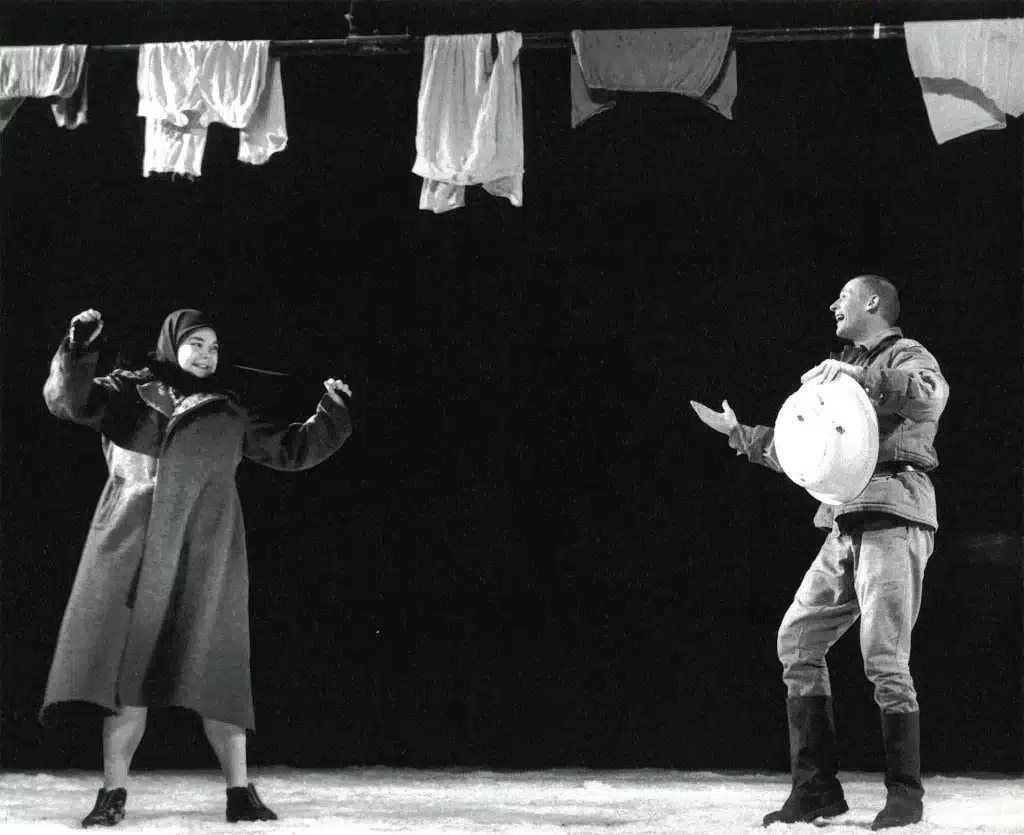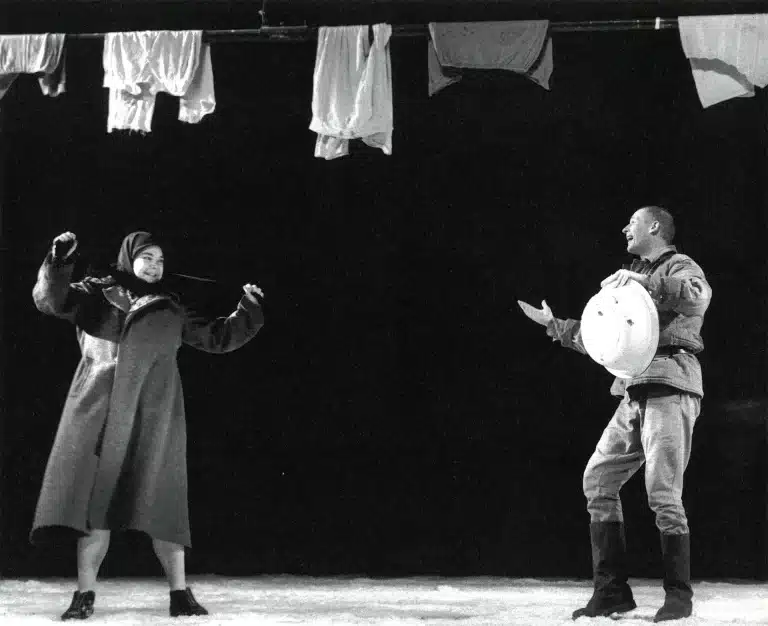ALTERNATIVES THÉÂTRALES : Comment est née l’idée de créer le festival PASSAGES qui invite à Nancy des spectacles de l’Est ?
Charles Tordjman : L’idée est venue en 1996. Elle est née de la jonction de plusieurs facteurs. Je les donne dans le désordre. D’abord ceci que certains spectateurs venaient me parler du Festival Mondial de Nancy, de leur regret de cette période de découvertes théâtrales. Ceci aussi que, 1996, c’était l’année de la forte montée de l’extrême droite. Je pensais qu’une des réponses que les gens d’art et de culture devaient apporter, c’était de dire : il ne faudrait pas faire entendre uniquement la langue française sur les plateaux de théâtres, mais d’autres langues aussi. À la préférence nationale, on répondait par la préférence internationale.
La troisième raison est venue de Sarajevo. Le fait que l’Europe éclate là-bas était le symptôme d’une désunion assez profonde. Sarajevo nous a fait prendre conscience qu’après avoir fait tomber le mur de Berlin, on en reconstruisait un autre, qui était le mur économique. Les projecteurs de l’actualité s’étaient braqués sur l’Est quand le mur était tombé, et puis après on avait laissé le soin à l’économie de marché de régler les problèmes. Pour nous, une des leçons de Sarajevo, c’était de penser que l’Europe ne s’arrête pas à Schengen.
Il y a aussi une raison plus personnelle : le fait que j’ai été quand même assez longtemps communiste, jusqu’en 1980, et que je pensais que le monde allait changer grâce au modèle politique mis en œuvre dans ces pays-là. On a vu que ce n’était pas possible. Je me suis souvenu aussi que la première mise en scène que j’ai faite était LA PUNAISE de Maïakovski, dont la première partie se passe en 1920 et l’autre en 1970. Un monde en chasse un autre. J’avais aussi travaillé sur ADAM ET EVE de Boulgakov qui traite de la même problématique. Un monde se détruisait, est-ce qu’on pouvait en reconstruire un autre ? J’avais donc une attirance politique et poétique vers l’Est.
L’Est est donc venu assez naturellement. Il faut dire aussi que nous sommes à Nancy qui, par son emplacement géographique, est la porte naturelle vers l’Est. En 1996, la manifestation n’était pas un festival. Il s’agissait simplement d’inscrire dans la programmation nationale une programmation internationale venant de l’Est, qui s’adresse au public de la Manufacture.
Ça s’est appelé PASSAGES. J’ai trouvé ce nom après m’être souvenu d’un voyage que j’avais fait il y a longtemps à BerlinEst avant la chute du Mur où j’avais rencontré l’écrivain Christoph Heim. Il m’avait donné une pièce à lire qui s’appelait PASSAGES. Elle raconte l’exil de Walter Benjamin parti de Berlin pour se réfugier aux États-Unis. Il se retrouve parmi d’autres intellectuels dans un petit village du sud-ouest de la France. Certains veulent partir pour les ÉtatsUnis et doivent passer par l’Espagne, d’autres hésitent. La pièce posait en creux la problématique de notre festival : comment répond-on concrètement à l’éclatement de l’Europe ?Faut-il attendre ? Agir ? Avec PASSAGES, nous avons l’impression d’être plutôt utiles. Utiles au rapprochement avec les artistes de l’Est ; utiles au public qui découvre à des choses qu’il ne verrait sinon jamais.
A. T.: Choisissez-vous les spectacles venus d’Europe de l’Est selon les mêmes critères que s’ils venaient d’Allemagne ou d’Angleterre par exemple ?
C. T.: On dit que les critères sont les mêmes, mais je crois que ce ne sont pas les mêmes. On prend en compte avant tout la qualité, la modernité, la recherche. La ligne de programmation de la Manufacture nous porte majoritairement vers le répertoire contemporain. Donc, le penchant naturel, lorsqu’on va à l’Est, c’est aller chercher Les spectacles qui racontent leur vision du monde contemporain. Mais on y va en se disant en plus qu’ils ont été formatés pendant des années par une certaine idéologie et qu’ils s’en libèrent seulement aujourd’hui. Comment s’opère la libération ? À quoi ressemblent leurs imaginaires aujourd’hui ? Le fait d’aller sur place, de ne pas faire la programmation sur catalogue, change plusieurs choses. On tient compte du mode de production et du contexte dans lequel se créent les spectacles. Par exemple, cette année 2000, le seul « institutionnel », c’est Krystian Lupa, qui a son propre théâtre et peut produire sans problème. Nous sommes plutôt attirés vers ceux qui sont en train de fabriquer des lieux indépendants, vers ceux qui, venant de l’institution ou à l’intérieur même de l’institution, essayent de faire gripper la machine, comme Oskaras Korsunovas, que nous avons invité à PASSAGES quand il était encore dans l’institution, ou comme cette jeune femme, Tatiana Frolova, qui est venue l’an dernier. Elle fait du théâtre à Komsomol, un endroit, en face des îles Sakhaline, où objectivement il ne devrait pas y avoir de théâtre. Sa passion pour Le théâtre lui fait dire qu’une société ne peut pas vivre sans poésie. Elle monte là-bas Heiner Müller, Kafka, Maeterlinck. Et peu importe que son spectacle ne soit pas le plus beau du monde : nous ne désirons pas inviter des stars, mais ce qui bouge, ce qui pousse. Tatiana Frolova est émouvante pour ça. Et nous savons que, quand elle va retourner à Komsomol, elle aura une bouffée d’oxygène, qui va accroître son désir ; elle aura rencontré d’autres gens, et ça va redoubler son envie. Un autre exemple est celui du théâtre d’Oulan-Oudé, que nous avons invité il y a trois ans. Oulan-Oudé se trouve tout près de la Mongolie. Il y a là-bas un tout petit théâtre que dirige le metteur en scène Youri Baskakov. Il est venu à Nancy présenter deux spectacles. C’était la première fois qu’il venait en Europe. Quand il revenu à Oulan-Oudé, il a obtenu des moyens supplémentaires pour son théâtre. Ça nous plaît bien d’aller dans des lieux oubliés du Centre, de Moscou, de SaintPetersbourg, dans des endroits « oubliés des dieux ». Pour ceux qui ne sont pas dans l’institution, l’effet de retour de PASSAGES est considérable. Et notre envie à terme, c’est que naissent ici des projets qu’on pourrait nous-mêmes produire.
A. T.: Le langage théâtral des spectacles que vous invitez est-il semblable ou comparable au nôtre ?
C. T.: Le théâtre à l’Est ne se fait pas comme le nôtre. Je pense que la différence est effectivement visible. Et ce que je constate, c’est que les metteurs en scène singularisés par l’Ouest ont parfois tendance à teinter légèrement leur esthétique de départ du désir de nous ressembler. Un peu, pas tous.
Les différences essentielles que je note, au delà de la langue — et c’est pas rien — et du répertoire — ce n’est pas rien non plus — se centrent autour de la question du jeu de l’acteur. Je crois que l’école stanislavskienne est encore très forte à l’Est, et que le travail de l’acteur est très privilégié.
Ce qu’il y a aussi de fondamentalement différent ce sont leurs moyens : ils n’ont pas du tout, mais alors pas du tout, les mêmes moyens que nous. C’est Lupa qui disait en plaisantant : un technicien polonais est capable de prendre un verre en plastique et de faire croire que c’est un verre en cristal. Il y a une tradition de la débrouille qui s’inscrit dans l’esthétique.
Il y a aussi le fait qu’ils ont des écoles de mises en scène, ce qui n’existe pas en France. Ils forment des metteurs en scène. Ils ont une tradition très forte qui, alliée à un génie individuel, donne parfois des résultats époustouflants : les spectacles de Fomenko, de Nekrossius, de Dodine ou de Lupa….
L’autre différence radicale, elle est dans l’organisation des théâtres. Il y a un grand respect de la hiérarchie. Le metteur en scène est au sommet et a un pouvoir très fort sur l’organisation du spectacle et de la production. Il y a chez nous une plus grande porosité entre le travail du metteur en scène et celui des acteurs. Ceux qui naissent sont plus collectifs. Ils sont d’ailleurs séduits par le modèle français : pas de troupe permanente, des spectacles qui puissent tourner, que l’on ne soit pas obligé d’inscrire à son répertoire pendant des années …
J’ai aussi l’impression, notamment à Moscou, que Le théâtre s’adapte plus au public. C’est, je trouve, un phénomène inquiétant. Sous le régime communiste, les gens n’avaient pas le droit de faire plusieurs métiers. Ils lisaient beaucoup, quand ils rentraient Le soir chez eux. Ils allaient aussi beaucoup au concert et au théâtre. J’ai eu récemment une discussion passionnante avec un metteur en scène russe. Je lui ai demandé si aujourd’hui ils lisaient autant. Il m’a répondu : aujourd’hui, on lit tout autant, mais on ne lit plus la même chose ; comme on fait au moins deux boulots sinon trois pour survivre, on est plus fatigué et on lit des romans moins exigeants. Le prix des livres, comme celui des places de théâtre a augmenté. La population n’est plus du tout homogène. Il y a des écarts de salaires énormes. C’est la frange de la population qui a de l’argent qui va désormais au spectacle. Elle y va pour consommer. Et les théâtres s’adaptent à cette nouvelle demande. Le répertoire change : il est plus divertissant, plus boulevardier, moins audacieux. C’est encore moins facile d’inventer du nouveau. Surtout pour les jeunes indépendants. Cette situation redouble, à mon avis, la responsabilité de l’Ouest à l’égard l’Est.
A. T.: Est-il vrai de dire que le jeune théâtre d’Europe de l’Est n’aborde plus la thématique du politique ?