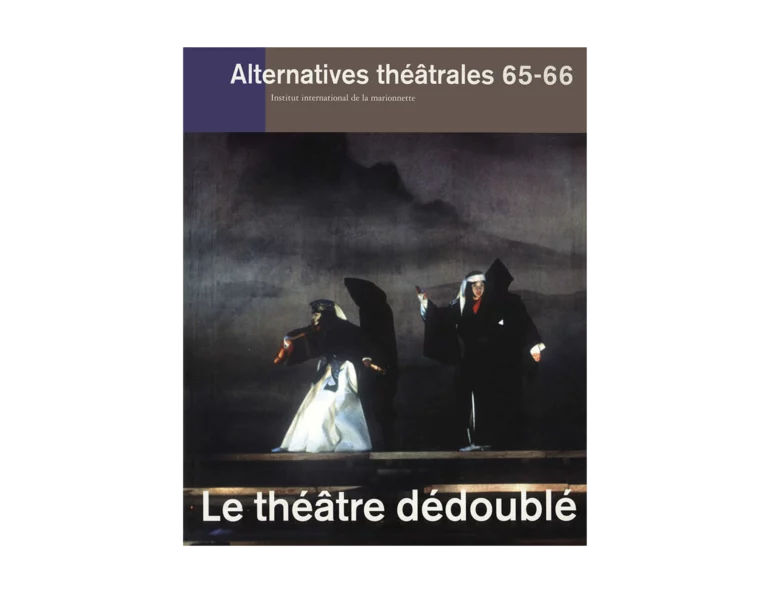DES COUTEAUX DANS LES POULES s’ouvre sur une crise, au sens originel du terme : sous l’apparence d’une simple querelle de ménage (car la pièce va constamment jouer sur les apparences, et tromper nos attentes), le dialogue entre deux paysans, dans une chaumière à l’extrémité d’un village1, marque le moment décisif, « critique », d’un discernement, d’une exigence de distinction, de différenciation. Soulignant l’inadéquation d’une image proposée par son mari, et rejetant par la même occasion la stratégie métaphorique de son discours amoureux, Jeune femme refuse une comparaison qui l’assimile à autre chose : Suis pas un champ. Comment suis un champ ? C’est quoi un champ ? Plat. Mouillé. Noir de pluie. Suis pas un champ. Évidemment, William, son laboureur de mari, est d’accord, ce n’est pas ce qu’il a dit, il parlait en puissance : il cherchait simplement à décrire, trouver la manière de dire, là, pour elle, pour lui (pour eux?), la beauté de son corps, de ses « formes ». Jeune femme n’est champ que par parallélisme, approximation, rapprochement symbolique, abstrait, grammatical, et d’ailleurs le langage fournit pour ce faire des outils spécifiques : C’est fait pour ça… Comme. Si ce petit instrument de syntaxe, c’est-à-dire de tissage et de lien, n’existait pas, et s’il était même légitime d’en contester l’efficacité, on ne pourrait pas davantage parler que labourer sans charrue.
Si la réaction de la jeune femme, et son entêtement pendant la scène, sont d’abord comiques car apparemment excessifs dans la situation donnée, cet excès même alerte l’auditeur/spectateur et inaugure une dérive inexorable de l’horizon pastoral, de plus en plus ouverte- ment fissuré par le désarroi : car c’est par des réflexions sur le langage et les actes de parole que les « personnages » de Harrower vont se faire violence, et c’est là, aussi, que l’écriture de la pièce puisera son énergie interne de progression et d’accumulation. En effet, contester la validité de l’analogie et de la comparaison trouble la perception même de l’être humain, l’image qu’il se donne de lui-même et de son action dans le monde. Ainsi Foucault, dans son exploration archéologique LES MOTS ET LES CHOSES, trace la rupture qui nous a séparés d’une époque où, « jusqu’à la fin du seizième siècle, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale […], organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guidé l’art de les représenter…» La revendication que fait la jeune femme, d’une singularité, à la fois extérieure (je ne ressemble pas à un champ, et donc n’en suis pas un), mais aussi intérieure (quelque chose en moi, une anarchie sémantique, se rebelle, se cabre, refuse la comparaison qui me juge, me jauge, me fige), serait-elle un symptôme de ce moment du temps où, dit Foucault, « la ressemblance va dénouer son appartenance au savoir et disparaître, au moins pour une part, de l’horizon de la connaissance » ? Pour mener peut-être… à la folie, la folie de cette épouse meurtrière devenue à la fin de la pièce accoucheuse de chevaux, ermite aux cheveux sales ? Folie proprement poétique à laquelle mène toute critique abrupte du langage, tout soupçon sur sa capacité à dire, à décrire : Quand le vent fait faire ça à l’arbre… (Elle se secoue) Qu’est-ce que c’est ? Y a un nom pour ça ? Pourquoi ça fait ça ? [ … ] Qu’est-ce que c’est ? Comment dire l’instant du frémissement des feuilles au moyen d’un objet qui paralyse ce frémissement, comment le dire dans l’instant où il définit et irrigue notre expérience immédiate ? Comment être avec ça, être ça, dans des « mots » ? Par quelle pensée sauvage ? Prise dans l’enchaînement de ces questions, transformée par les états-limites et les passages à l’acte où elles l’entraînent, Jeune femme se désaccouple du village, de sa vie organisée au rythme des moissons. Elle bascule. Ce qu’elle est dedans, ce qu’elle voit dehors, (et elle dit bien que pour elle un secret profond de son être palpite à l’intersection de ces deux entités), tout cela ne peut s’accommoder du langage existant, tout cela refuse instinctivement, organiquement, le langage des autres, celui qui permet à la communauté du village de survivre, se perpétuer passivement, sans rien voir de ses yeux cailloux. Quelque chose fuit. À jamais.
Pourtant c’est William, apparemment le plus terre-à- terre des personnages de la pièce « Petit-cheval William » dont le nom même repose sur une métaphore qui finira peut-être par l’écraser, ou le libérer ? – qui subit en premier l’appel du désordre. Dès la fin de la première scène, laissé seul à monologuer (sa femme est tout logiquement partie définir en quoi le fromage qu’elle fabrique n’est pas « comme » la lune), il raconte un souvenir d’enfance énigmatique : un jour, ou un soir – peut-être les deux en même temps – il faisait paître les chevaux et s’est réveillé dans un pré, le dedans dehors, ses organes rouges et mouillés redistribués sur l’herbe, lui-même devenu béance sous le ciel, redevenu composé de création à venir, tout ce qui est « lui » en attente, comme des cœurs de lapin noués avec de la salive de vache. Image étrangement sensuelle et intense d’une intériorité arrachée à elle-même, retournée comme un gant. Plus tard dans la pièce, en écho à cette hallucination, il formulera dans un dernier cauchemar sa vision hurlante de la jeune femme perdant sa peau, arrachée chaude… avec des trous partout… sauf à l’endroit de ses yeux, fermés, obturés, tournés vers un monde intérieur, la protégeant peut-être de cette écorchure sèche par laquelle la glaise terrestre envahit les membres et les nerfs sensitifs : De la boue, mes pieds. Les sens plus. Chez William, donc, avant même les autres personnages qui semblent s’opposer à lui, Harrower trace une individualité à part, complexe, angoissée par le contact avec la matière, le tout de l’univers, et qui transforme cette intranquillité phobique en discours violemment poétique, en quête inlassable de noms pour dire. Uuaaaaghhh!! Uh… oh… T’as pas entendu ça ?
Comment nommer les choses ? L’acte édénique, dans cette Écosse aride et inhospitalière qui ne reflète aucun paradis perdu ou à retrouver, obsède les personnages. Mais le Dieu de l’Ancien Testament, qui confiait à Adam la responsabilité de la dénomination, reste étrangement lointain, constant objet de doute – doute dont les risques de perturbation hantent la pièce. Qu’est-ce que donner un nom, quel est la nature de cet acte vocal, syllabique, mais aussi intellectuel, spirituel, dont la volonté de transformation, de torsion réveille des tentations démoniaques ? Quelle part secrète, indiscernable, étrangère de moi-même est impliquée, possédée, quand je nomme, et que je suis nommé : Suis d’autres choses ?, demande brutalement Jeune femme à William, Feu ? […] Botte ? Lit ? Porte ? Car, comme le fit ironiquement l’homme- corne, Gilbert Horn, le meunier-qui-tue : donner un nom à une chose, ce n’est pas seulement la rendre utilisable, c’est aussi accomplir un acte brutal, tyrannique, qui oblige l’autre, le ligote. Jeune femme n’est pas dupe lorsqu’elle perçoit dans la moqueuse leçon de vocabulaire du meunier : Vois ça ? Là. Là. Ça a un nom. Loquet-de-porte. C’est mon loquet-de-porte…, l’ordre voilé et perversement indirect de la fermer (la porte…). Ordre donné à demi- mot, comme on dit justement. Nommer, découvre-t-elle au moulin, dans le bruit assourdissant de la meule de pierre qui dévore les sacs de grain, c’est agir, se projeter, comme le premier humain, comme le nouveau-né, physiquement, organiquement dans le monde, dans le « réel », et peut-être, dans un vomissement qui retourne l’être tout entier, se vider de ses entrailles comme William dans le champ au-delà, et se retrouver en rond, mimant le contour des lèvres qui prononcent, ce frottement d’organes qu’on appelle parler. Le moment déjà cité est emblématique : Jeune femme se secoue comme les feuilles de l’arbre : Y a un nom pour ça ? C’est-à-dire : y a‑t-il un nom qui puisse décrire ça (ce que je vois), mais aussi qui puisse décrire mon geste, ce geste du monde que je reproduis, la Geste exténuante de ma présence au monde, de mon dire du monde. La question essentielle devient alors celle de l’adéquation de mon acte. Mais cette adéquation est une notion complexe, car je dois, si je veux décrire en personne, exprimer non pas seulement toute chose que je vois, mais le rapport de mon corps, de mes yeux à la chose, ce que je vois de la chose, qui ne correspond jamais, dans cette intériorité pourtant offerte, à ce que vit l’autre. Pour William, le nom juste pour une flaque est « flaque ». Mais une flaque d’eau claire après la pluie fraîche (où tu peux voir la terre dessous) n’est pas (comme) une flaque sombre et boueuse. Car la couleur, la consistance, la luminosité changent mon existence, modifient mon souffle, m’arrêtent. Les choses changent chaque fois que je les regarde, répète Jeune femme, et ce changement modifie en retour mon regard et ma façon de voir, dans un échange inépuisable. On comprend que devant tant de subversion, de réflexion qui désoriente et déstabilise, William oppose son autorité maritale : Tu vas droit où tu vas, femme. Tu marches et t’arrêtes pas.