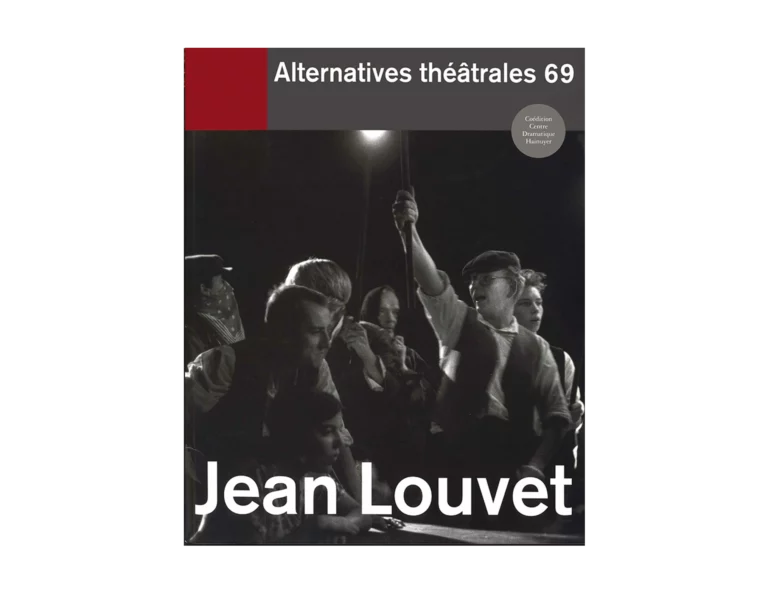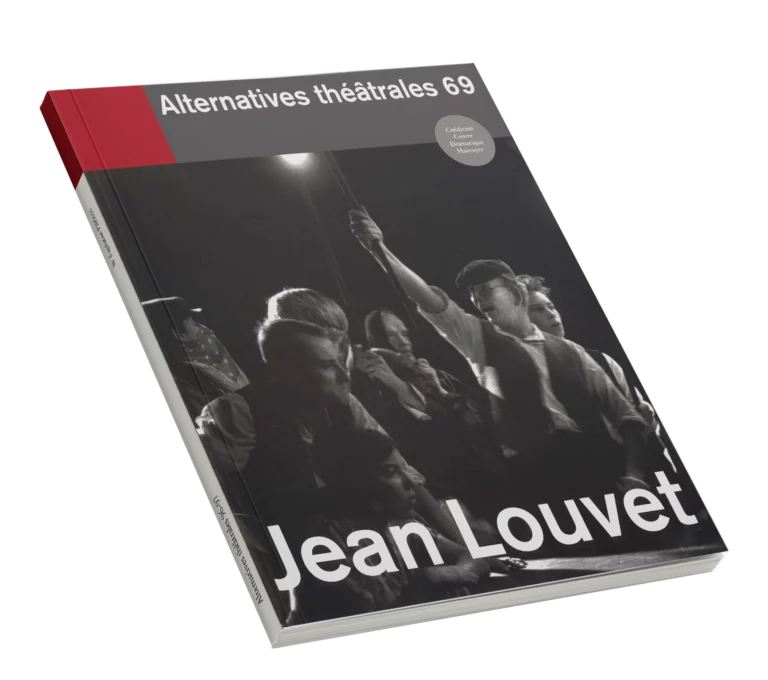AU LENDEMAIN de la grève de 60 – 61, la Wallonie va revendiquer le fédéralisme pour dépasser la débâcle économique qui s’abat sur elle. Depuis les origines, le Mouvement wallon veut permettre à la Wallonie de prendre son envol dans le carcan belge, de gagner son autonomie, l’État fédéral lâchant de plus en plus de compétences au profit des entités fédérées. (C’est plutôt celles-ci qui arrachent des compétences au pouvoir central.) Ainsi nous voilà dotés d’un parlement, d’un gouvernement, d’une capitale.
Le passage au fédéralisme n’a pas apporté la richesse. Il a empêché une plus grande hémorragie et permis un redressement économique certain.
Nous sommes sortis d’une idéologie du déclin, mais nous restons une région pauvre face à une Flandre riche, si tant est qu’il faille sempiternellement se comparer à la Flandre. Après tout, on peut vivre avec des moyens modestes et couper court au ressassement d’une mendicité wallonne, ce qui arrange bien l’arrogance de certaines couches sociales flamandes.
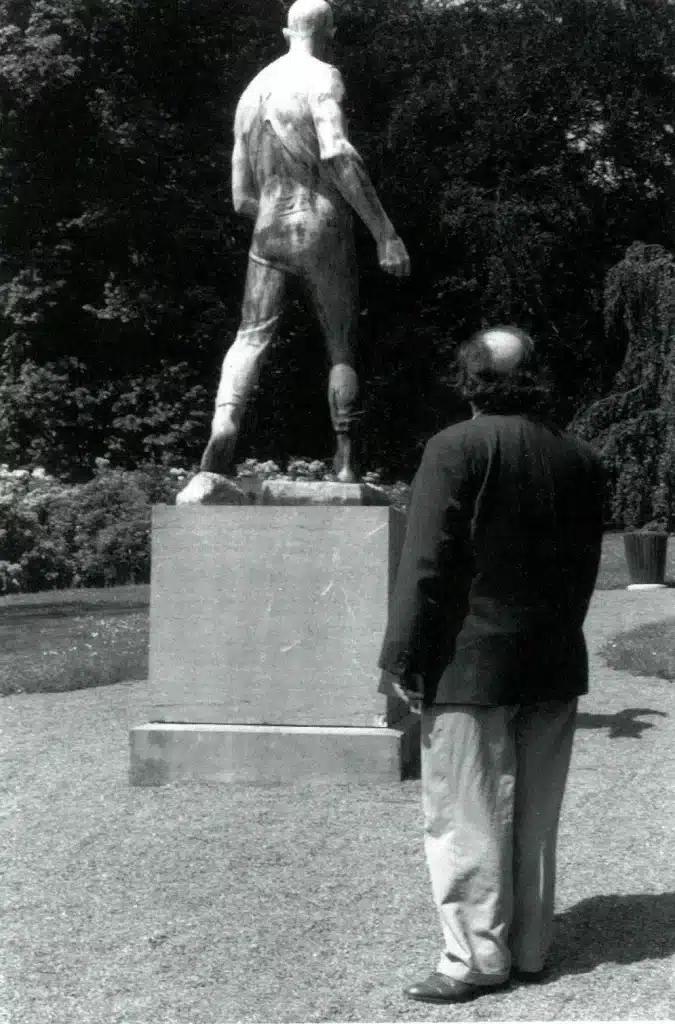
Donc, c’est le règne de la loi du plus fort. Les francophones plient trop souvent dans le bras de fer qui les oppose aux Flamands.
Dans ce paysage miné, une petite éclaircie : nos voisins du Nord sont un peu moins forts à cause de leur fragmentation politique et du poids mort que représente le Vlaamse Blok avec lequel les partis démocratiques ne peuvent faire alliance.
Quoi qu’il en soit de cette maladie brune dans le Nord du pays, rester en Wallonie dans l’état de besoin, c’est rester dans un état de dépendance, c’est perdre sa dignité. C’est perdre la dimension politique. Nous vivons dans le deuil de l’égalité entre Belges. Pour en sortir, il faut défendre, tant en Wallonie qu’à Bruxelles, des valeurs indispensables à la construction de l’égalité.
Le Mouvement wallon n’a pas abouti à créer une nation wallonne. Ce qui met les Wallons plus ou moins à l’abri de dérives antidémocratiques, mais nous manquons cruellement d’une prise de conscience régionale. Et la Communauté française de Belgique est une institution qui maintient Wallons et Bruxellois dans l’insignifance politique.
Échec cuisant donc : la solidarité propre à un État fédéral n’existe pas. Et ce qui reste de commun au Nord et au Sud fait l’objet d’un chantage permanent. Il nous faut donc créer cette dignité politique qui conduit le citoyen à prendre son destin en main. Notre sort dépend de nous. Tâche urgente, car il y a fort à parier que les inégalités vont s’accroître jusqu’au seuil du tolérable. Ne pas le dire, c’est masquer l’horizon d’une communauté qui continuerait à vivre dans le mou, les petits pas. Wallons et Bruxellois ont une appartenance à fonder, sans quoi ils ne seront pas crédibles. Nous n’avons fait que la moitié du chemin.
En écrivant LE COUP DE SEMONCE sur le Congrès de 1945, j’avais appris, surtout en étudiant de près les interventions de Fernand Dehousse, qu’il y a deux sortes d’états fédéraux. Ceux qui cimentent la volonté d’entités fédérées à former un État fédéral et qui ont une chance de survivre et ceux qui proviennent de l’éclatement d’un État central, ces derniers étant beaucoup plus fragiles. La pièce disait aussi que restait faible la chance pour Flamands et Wallons de vivre ensemble dans un État fédéral ; en fait, c’est la dernière chance. Une partie du Mouvement wallon avait sans doute vu clair et peut être allons-nous vers la coquille vide d’un fédéralisme exsangue.
En écrivant quelques pièces sur l’amnésie, j’ai pensé qu’il fallait aider à rendre aux Wallons leur place dans l’histoire.
L’histoire du Mouvement wallon est en voie de publication. Cette œuvre importante, si elle irrigue sérieusement la société wallonne, permettrait de construire une véritable culture théorique et historique de notre fédéralisme.