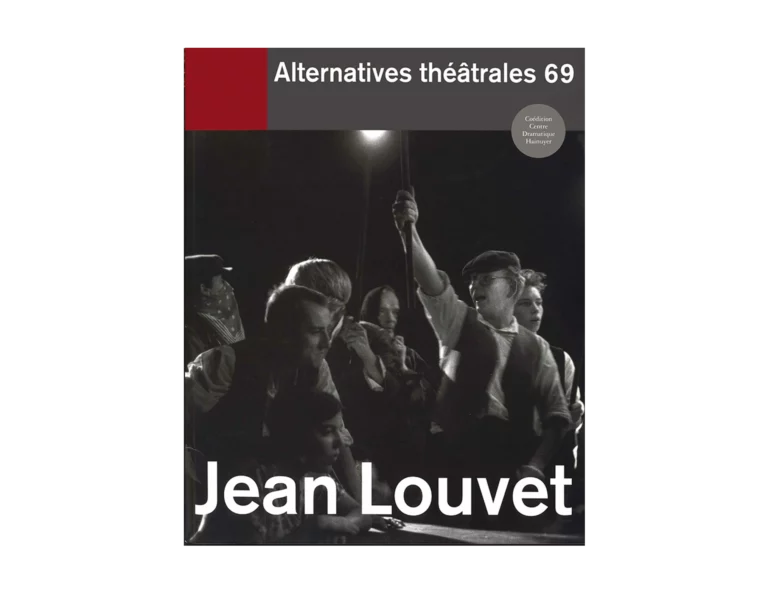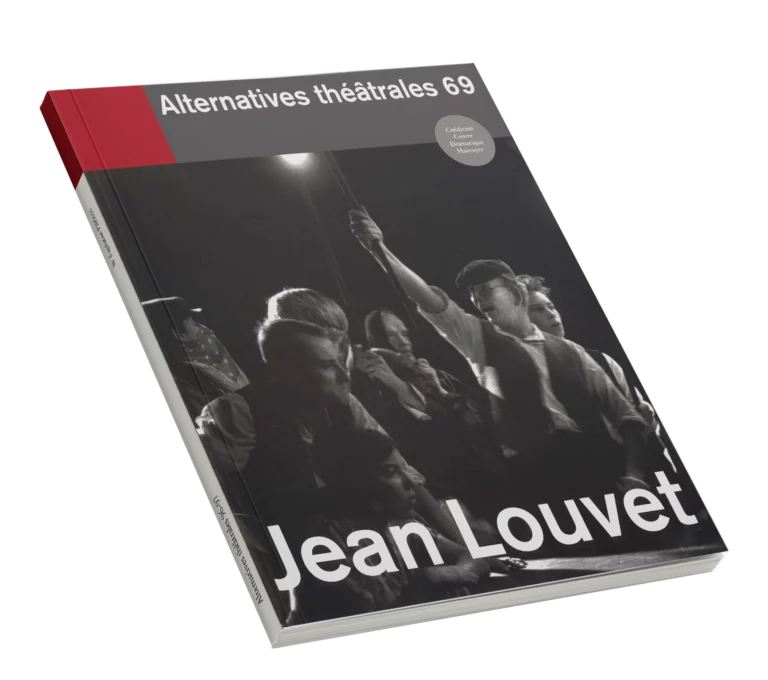NOUS AVONS MANQUÉ le train de l’Histoire comme d’autres ont manqué le train du bon dieu.
Qu’on ne voie là aucune intention de faire passer un aphorisme de notre cru à la postérité. Mais, plus sûrement, le désir d’engager notre question, laquelle se propose d’interroger le rapport entretenu par l’œuvre louvetienne avec l’histoire. Car la lecture !1 que nous avons conduite tout récemment de cette œuvre nous apprend surtout que son auteur, Jean Louvet — auteur d’un théâtre dont on a pu dire, en son temps et à juste titre, qu’il était un théâtre de l’engagement politique, donc, un théâtre de l’avènement de l’Histoire — Jean Louvet, donc, a surtout assisté à un non-avènement. Ou, pour le dire autrement, à une résorption de l’histoire. Ironie de ladite histoire ? Oui, sans doute. Par conséquent, l’histoire n’atteindrait-elle le sommet de son ironie que lorsqu’elle se résorbe ? Sans doute également. Mais là ne sera pas notre propos. Il sera celui-ci plutôt, en forme de double question : à l’ironie de l’histoire, Louvet aura-t-il répondu par une autre ironie dont les formes dramatiques, cette fois, auront fait les frais ? Et, dès lors, que nous apprennent ces formes entamées ?
C’est avec La pièce intitulée LE TRAIN DU BON DIEU que Louvet débuta sa carrière d’auteur dramatique, en 1962. Aujourd’hui, elle revêt un étrange caractère prémonitoire. Dans la pièce, ceux qui ratèrent le train étaient les ouvriers — et aussi Les autres, tous ceux qui voulaient voir la révolution prolétarienne s’accomplir : en un mot tous ceux qui voulaient monter dans le train de l’Histoire et rêvaient de son avènement. Louvet n’avait pas eu à aller chercher bien loin. Au cours de l’hiver 60- 61 s’était déroulée une grève qui paralysa la quasi-totalité de la Belgique durant un mois. Les ouvriers de toutes les corporations furent rejoints par une partie des fonctionnaires et des enseignants (dont Louvet, alors jeune professeur de 26 ans, militant actif du PSB, le Parti Socialiste Belge). Lorsque la grève cessa, le 20 janvier 61, la classe ouvrière reprit le travail avec un sentiment amer : celui d’être resté sur le quai. LE TRAIN DU BON DIEU analyse les causes de la défaite. Pourquoi, alors que toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux forces prolétariennes de s’affranchir du pouvoir des grands patrons industriels et instaurer une société enfin sans classes, pourquoi ces forces avaient-elles échoué ? Pourquoi n’avaient-elles pas su se débarrasser des formes d’aliénation dont le peuple ouvrier se sait victime mais qu’il entretient aussi, à son insu, contre lui-même ? Pourquoi n’avaient-elles pas été capables de se secouer de la gangue d’un imaginaire — aux relents souvent judéo-chrétiens qui font de l’ouvrier une sorte de martyr qu’un bon dieu (d’où le titre) finira bien par sauver — cet imaginaire qui leur interdit depuis trop longtemps de devenir maîtres de leur destin ? Pourquoi n’avaient-elles pas su dépasser leur rapports de pouvoirs internes, les clivages au sein des syndicats, les rivalités de partis ? Pourquoi, enfin, avaient-elles eu peur de vaincre ? Le constat, certes, est alors accablant. Mais, pour Louvet, il ne s’agit pas de baisser les bras. Son engagement d’auteur, il le conduit au sein d’un groupe d’intellectuels, d’ouvriers, de syndicalistes décidés à poursuivre le désir d’action que la grève de 60 – 61 à fait naître. À ce groupe, Louvet donne le nom de « Théâtre prolétarien » (emprunté à un titre d’Adamov). Et, bien sûr, la troupe se tourne du côté de Brecht et de ses continuateurs à Berlin.
Si Le constat est accablant, il ne s’agira pas de s’incliner devant les faits. C’est tout le contraire. Le théâtre sera un vecteur d’éducation des forces populaires, de formation à la lutte des classes, d’émancipation des consciences. La grève de 60 – 61 sera un champ d’observation, elle devra servir à comprendre pourquoi elle fut, au bout du compte, un échec ; et comment les ouvriers ont eux-mêmes été les artisans (sic) de cet échec. Avec LE TRAIN DU BON DIEU, Louvet déploie un arsenal dramaturgique pour empêcher le spectateur de s’installer dans le confort douillet (c’est-à-dire l’irresponsabilité) auquel il aspire lâchement et, au contraire, pour le confronter aux enjeux dialectiques du combat idéologique. Ce qu’il faut, c’est produire de multiples écarts, décalages, ruptures afin d’enclencher l’incrédulité puis, peut-être, l’attitude critique. Les effets de distance doivent être savamment entretenus, réactivés :caricature, dérision, parodie, affirmation-dénonciation du régime théâtral … Le spectateur ne doit pas oublier qu’il est au théâtre. Et que celui-ci, s’il lui présente des hommes et des femmes qui ratent leur grève, hommes et femmes qui lui ressemblent s’il a lui-même été un acteur de la grève de 60 – 61, ou qui lui sont familiers parce qu’il les a côtoyés, ne lui présente qu’une réalité insolite. Suffisamment insolite, pour que l’effet de distance le conduise à cette « mise en perspective critique » qui fut le mot d’ordre du théâtre dit engagé des années soixante et soixante-dix. On pourra dire encore une réalité discutable, au sens premier, voire familier : c’est-à-dire, qui donne à discuter, à débattre. Afin qu’après les applaudissements, le travail — peut-être le temps le plus important ! — commence. Le débat intérieur du spectateur avec lui-même. Et, plus encore, le débat avec les autres : autres spectateurs bien sûr, mais également avec les animateurs-acteurs qui étaient eux-mêmes et avant tout des ouvriers, syndicalistes, militants. Débat avec l’auteur, lui aussi comédien à l’occasion. Que de nuits avancées, polémiques et mouvementées, où se sont forgées des consciences critiques de spectateurs ! La révolution en acte.
Pour le post-brechtien qu’est Louvet, la société ne peut être qu’une société transformable. Et cela donne au théâtre une posture particulière. Il ne pourra convoquer le spectateur qu’à la représentation d’un monde en attente.
Et lui-même, dans cette logique, devra s’effacer devant l’impressionnante tâche à conduire, tendu néanmoins vers cette perspective : l’Histoire, donc, à accomplir, ainsi que la rhétorique marxiste avait réussi à en imposer le concept par un renversement acrobatique. Faire l’Histoire (on ne manquera pas de remarquer la majuscule), faire l’avenir de l’histoire ! Voilà ce qui faisait l’enjeu formidable auquel la communauté des hommes se voyait conviée.
LE TRAIN DU BON DIEU procède à l’autopsie d’un grand ratage. Ce train qui, le croyaient certains, devait les emmener en masse jusqu’à la capitale où ils montreraient à « ceux d’en haut » que le mouvement de la révolution est en marche, ce train n’est jamais entré en gare. Le grand rendez-vous n’a pas eu lieu. L’histoire a repris son cours, cahin-caha, sans la majuscule qui lui donnait des airs de fête. Et sans grandeur.
Que la pièce nous apparaisse aujourd’hui prémonitoire, nous ne savons pas s’il faut le dire avec tristesse. Quarante ans après, nous savons seulement que le train n’est jamais passé. Pis, nous avons appris, confusément, qu’il n’y a jamais eu de train. Le train de l’Histoire nous a manqué — si l’on veut bien entendre le balancement de sens que nous réserve ce verbe. Peut-être sommesnous alors devenus plus lucides ? Peut-être. Nous y reviendrons. Louvet, pour sa part, a continué à écrire des pièces pour le théâtre. Vingt en tout. Et il a accompagné dans l’écriture, par l’écriture, ce lent mais insidieux — ou, en tout cas, sournois — repli de l’histoire. Sa « résorption » avons-nous dit, pour mieux rendre compte de la dimension du phénomène qui a affecté les idéologies.
Louvet a accompagné cette résorption. À son corps défendant — au moins tout un temps. En lui opposant sa résistance obstinée. Puis, comme s’il devait en habiter le mouvement, l’occuper de l’intérieur. Et, même, reconnaître cette résorption, la rejoindre au plus loin de sa perversion et/ou de son génie (par exemple, avec L’ANNONCE FAITE À BENOÎT). Ce trait, à nos yeux le plus marquant de l’œuvre louvetienne, nous voulons en ouvrir ici le questionnement. Et lui adresser l’ébauche de quelques réflexions supplémentaires.
L’histoire d’une résorption (de l’histoire)
Une résorption de l’histoire peut-elle se raconter ? Oui, bien sûr. Le repli des idéologies, la perte des utopies, le recul du sens collectif ou encore celui du lien social …., cela peut se raconter, en effet. Pour notre part, nous nous bornerons à observer le chemin opéré par l’œuvre dramatique d’un auteur pour qui le sens de l’histoire a eu, précisément, un sens ; mais qui, en dépit de ses engagements (sur lesquels nous ne saurions émettre le moindre doute : qu’il n’y ait aucune ambiguïté là-dessus) et sans qu’il n’oublie jamais quels furent ses engagements, n’a pas renoncé à enregistrer les mouvements du temps. Pour en rendre compte, y compris en ce qu’ils pouvaient avoir de déplorable.
Que l’on soit en effet pénétré de cela, faute de quoi l’on risque de ne rien comprendre à l’œuvre de Louvet et à ce qu’il faut bien appeler sa cohérence : Louvet a accepté — quoi qu’il lui en coûta, et l’on peut conjecturer que le ressentiment qu’il éprouva fut de taille — de laisser ses œuvres s’entamer, s’altérer, se désoler lorsque ce qui faisait auparavant office d’ossature a commencé à se défaire. Non par plaisir douteux de nous ne saurions quel masochisme. Mais parce que Louvet — et toute son œuvre en fait la démonstration — n’a eu de cesse de rechercher l’adéquation de la forme au sens. La forme-sens pour reprendre la célèbre formule de Henri Meschonnic. La forme dut-elle se dégrader, pour témoigner à sa mesure de la dépossession du sens et des structures qui supportent (mais alors de moins en moins) le présent et le destin des hommes. Et, c’est en cela à coup sûr, parce que la forme ou plutôt les formes (elles sont forcément plurielles) sont mises à l’épreuve, que Louvet ne s’en tient jamais à la surface des choses (à des thèmes par exemple, comme on le dirait simplement) mais qu’il les rejoint en leur fond — c’est-à-dire pour ce que sont les structures épistémologiques (et leur recomposition) qui régissent le destin des hommes et des femmes de la société contemporaine.
Nous utilisons le terme de forme parce qu’il nous paraît plus ajusté que celui de structure dramatique (on pourrait, bien sûr, parler de dramaturgie, mais l’on risquerait cette fois de pécher par excès de scientificité sans pour autant parvenit à être explicite). Car la notion de forme inclut certes celle de structure dramatique mais elle ne s’y limite pas. Parler de forme, c’est comprendre également le ou les modes de discours des personnages, mais aussi les altérations que l’auteur fait subir à la langue. Ou encore le degré de validité de la parole dans son commerce avec la signification.
Dès lors, pour revenir à l’œuvre et aux œuvres, on peut être tenté de dire que celles-ci se répartissent en deux phases. Et que L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE (1980) opère une charnière entre elles deux. Toutefois cette indication, à laquelle nous avons souscrit par ailleurs, nous paraît ici insuffisante. Car elle risque d’orienter Le lecteur vers l’idée d’une césure et, donc, d’une œuvre à deux facettes contrastées et antagonistes. Or, il faut plutôt retenir l’idée d’une œuvre qui, dans le mouvement continu qui l’infléchit, se voit, au moment que nous indiquons, entrer (il ne s’agit pas d’un basculement) dans un cycle régressif. Certes, des signes avant-coureurs pouvaient nous mettre sut la voie. Mais attardons-nous quelques instants sur L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE. Cette pièce est incontestablement celle qui a marqué le public belge au début des années 80, dans une mise en scène de Philippe Sireuil. Elle est aussi incontestablement la plus sombre de toutes celles que Louvet a écrites. Or, si sa construction en tableaux nous rappelle encore Brecht, il en va tout autrement de la figure centrale. Comme l’avait bien perçu Michèle Fabien, le personnage principal (si tant est que cette appellation puisse encore convenir) n’est plus une figure pivot. Il n’est plus en mesure d’assumer cette fonction structurale et structurante. Pour être plus précis, non seulement le personnage est celui d’un revenant (Julien Lahaut, syndicaliste, grande figure des soulèvements ouvriers d’avant-guerre, déporté à Mauthausen en tant que prisonnier politique, député communiste et leader du Parti Communiste Belge après la guerre ;assassiné en août 1950, quelques jours après l’investiture du Roi Baudouin — trente ans exactement avant la situation développée par Louvet), mais d’un revenant qui revient dans l’oubli le plus total. Voire, pour certains des personnages qui acceptent de se souvenir, dans une certaine hostilité. Ou encore dans le déni de son action d’alors. Il faut voir là une indication majeure — pour ne pas dire symptomatique — dont l’écho ne cessera de se déployer par la suite.
La défaillance de la figure pivot — son impuissance ici, mais il pourra s’agir de son absence dans une autre pièce (JACOB SEUL) ou de son éviction subreptice ailleurs (L’ANNONCE FAITE À BENOÎT) — se pourrait-il qu’elle soit sans conséquence ? Les formes, désormais, ne cesseront d’en souffrir. Car, avec le discrédit porté à cette figure, ce sera chez Louvet la capacité de la scène à jouer un rôle organiciste du monde qui sera mise en doute. Mais également le pouvoir de la parole.
La pièce, quant à elle, met en jeu l’incapacité d’une figure historique à incarner (si l’on peut dire) un modèle identificatoire susceptible de contribuer à accorder une identité à un peuple ; le peuple belge en l’occurrence. Elle met en question le processus de refoulement dans lequel ce peuple s’est engagé au début des années 80, l’individualisme forcené dans lequel il se complaît et Les propensions réactionnaires qui le menacent. Le mouvement de résorption de l’histoire (du sentiment de l’histoire) est entamé et rien n’engage à l’optimisme de ce côté-là.