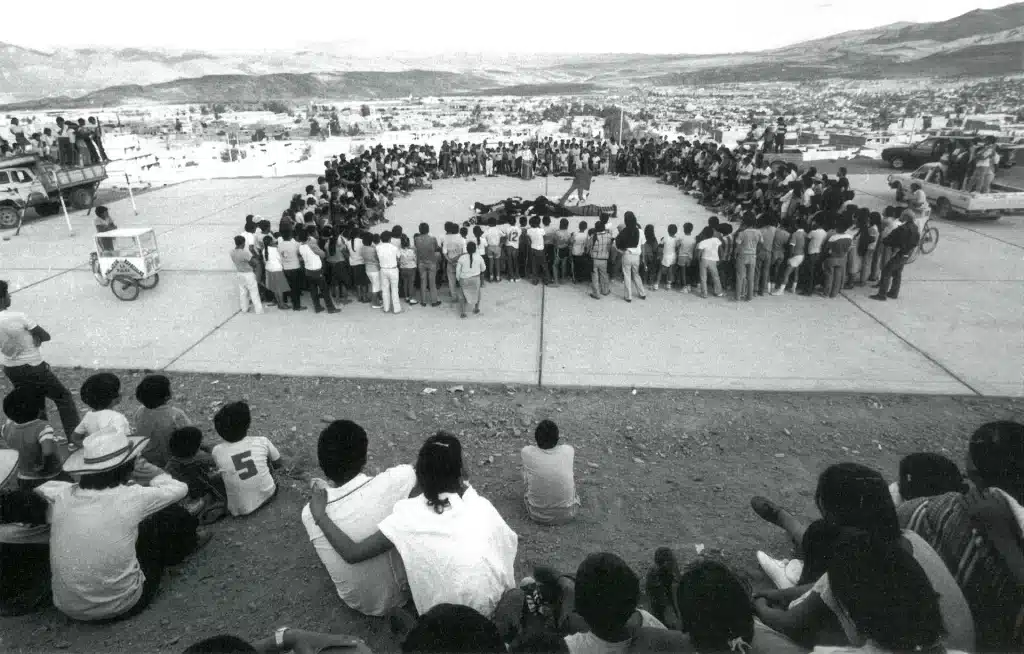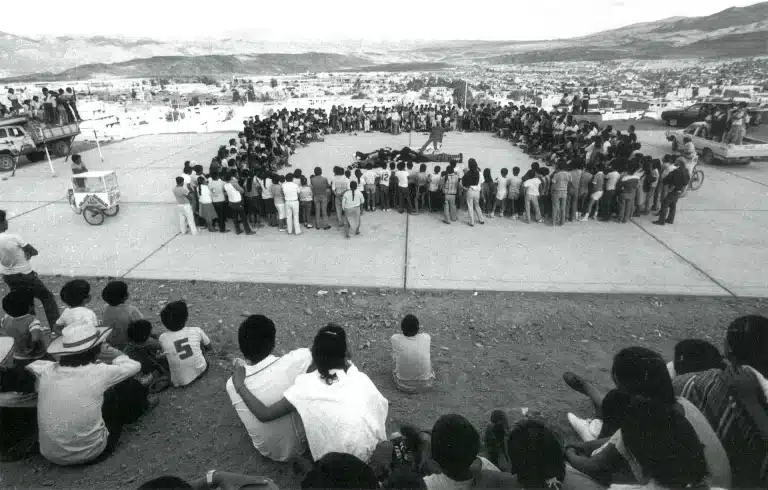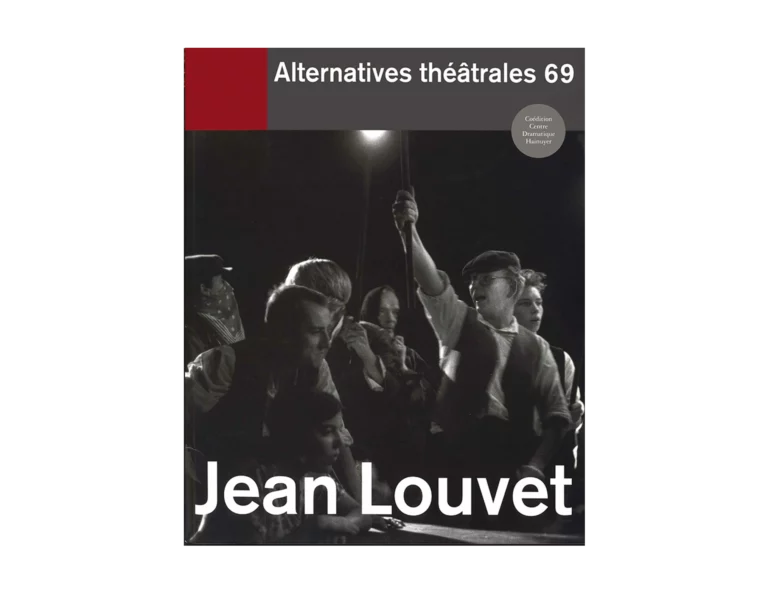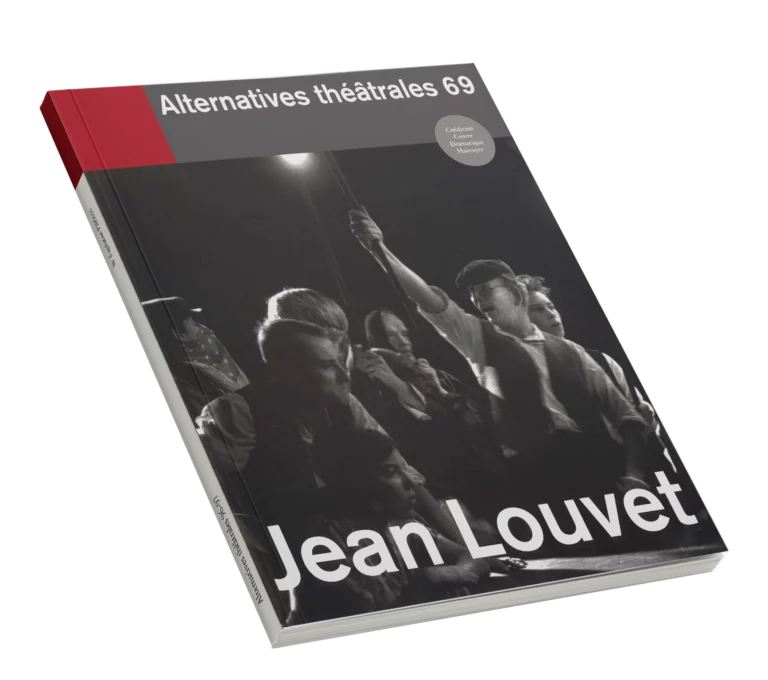Chers amis,
JE VOUDRAIS commencer par un rêve. Il y a un homme attaché à un poteau, sur la terrasse d’un temple. Il essaye de se libérer. En vain. Il s’obstine. Des sphères de verre tombent de ses yeux et se brisent au sol en mille éclats. Deux jaguars dressés sur leurs pattes de derrière s’avancent, dansent sur les éclats de cristal, et leurs pieds — pieds humains et non pattes de jaguar — laissent sur la terre des traces de sang. Soudain l’un des jaguars enfonce un silex pointu dans le cœur du prisonnier. De la blessure ce n’est pas le sang qui jaillit, mais un livre ardent, puis un second livre, et un troisième et une foule d’autres, des dizaines, des centaines de livres en flammes qui s’entassent en un bûcher gigantesque aux pieds de l’homme attaché à son poteau.
L’homme qui fait ce rêve s’appelle Kien ; c’est un intellectuel, quelqu’un qui aime les livres. Dans l’agitation de son rêve il hurle au prisonnier : « Referme ta poitrine, referme ta poitrine ». La victime l’entend et par un effort surhumain elle arrache ses liens, porte les mains à sa blessure, l’écarte davantage encore et une avalanche de livres en flammes s’en échappe.
Le dormeur ne peut supporter cette vision, il se précipite dans son rêve, saute dans le bûcher pour sauver les livres qui se réduisent en cendres. Il est aveuglé par les flammes ; des centaines de personnes hurlant d’affolement et de douleur s’emparent de lui et l’’empêchent d’emporter Les livres. Il s’arrache à leurs mains qui l’agrippent, il les insulte, il fuit loin des flammes. Hors de danger, il voit tous ces êtres se changer lentement en livres qui se consument en silence, comme des héros ou des martyrs.
Kien, l’auteur de ce rêve, est le protagoniste d’un roman d’Elias Canetti, un juif né en Bulgarie, qui a fait ses études en Allemagne et écrit en Angleterre les œuvres qui lui ont valu le prix Nobel. C’est ce même Canetti qui vers la fin de sa vie affirmait qu’on n’habite pas un pays mais une langue. Que reste-t-il pourtant d’un individu qui a perdu et son pays et sa langue ?Peut-être l’essentiel. Et quel est l’essentiel pour nous de l’Odin Teatret qui ne pouvons être identifiés ni à un pays ni à une langue ?
Par commodité ou par convention, les prix sont souvent décernés à une personne, et donc liés à un nom. Mais derrière ce nom se cache un microcosme composite qui vit et agit. La personne et le nom sont la partie visible de l’iceberg alors que reste caché le socle compact, ce réseau complexe de relations, collaborations, affinités, échanges et tensions qui constituent un organisme vivant, lequel sillonne les courants du temps, les suivant parfois, parfois les refusant, mais toujours après avoir pris position.
C’est à cet iceberg qu’a été décerné le prix Sonning. C’est à l’Odin Teatret tout entier, à ce groupe d’hommes et de femmes issus de nations, cultures, religions et langues différentes que l’Université de Copenhague attribue l’honneur et l’argent en reconnaissance de son travail.
Mais cet iceberg compte plus de facettes que le nombre de ceux qui ont fait ou qui font partie de l’Odin Teatret. Il inclut aussi les responsables politiques d’Holstebro qui nous ont accueillis quand nous étions si petits que nous aurions pu passer par le chas d’une aiguille, quand nous étions jeunes et anonymes, à une époque où être jeune n’était pas un signe de vitalité et de créativité potentielle, mais simplement synonyme d’inexpérience. C’est à l’Odin Teatret tout entier et aux responsables de la municipalité d’Holstebro qui l’ont protégé pendant 35 ans que revient aujourd’hui ce prix prestigieux.
L’essentiel émerge toujours à cause d’une privation. Notre origine a été marquée par un manque, une exclusion. Pour l’Odin Teatret l’exclusion fut double. Nous voulions faire du théâtre, entrer dans le milieu et dans l’histoire du métier, et cela nous fut interdit car on nous considérait comme incompétents, incapables, inaptes à devenir acteurs ou metteurs en scène. À cette époque, en 1964, il n’existait aucun groupe de théâtre ni culture théâtrale alternative dont nous aurions pu nous inspirer, auxquels nous aurions pu nous intégrer. Nous étions exclus. Le théâtre était pour nous une nécessité, mais personne n’avait frappé à notre porte pour nous demander de devenir des artistes parce que le monde avait besoin de nous. Nous avons assumé les conséquences de cette situation :Le théâtre n’était nécessaire que pour nous et il nous fallait donc le payer de notre poche.
Telle est l’origine de l’Odin Teatret en Norvège : un minuscule théâtre amateur qui rêve de devenir professionnel, tout juste cinq personnes qui doivent apprendre, sans aucune aide, l’essentiel de l’artisanat théâtral, seules, hors de la géographie du théâtre alors reconnu et reconnaissable.
Quelque deux ans plus tard, ce tout petit groupe se transporte au Danemark, acceptant l’offre incroyable de la municipalité d’Holstebro. C’était la première fois que des « adultes », et qui plus est des responsables politiques, nous regardaient en face, donnant ainsi une valeur à ce que nous faisions. Pour la première fois nous avions le sentiment d’avoir un sens pour d’autres.
Notre transfert à Holstebro fut pour nous une mutilation car nous parlions une langue étrangère. Nous fûmes privés de la parole qui était alors le moyen de communication essentiel au théâtre. En Norvège nous étions un groupe de théâtre norvégien, constitué d’acteurs norvégiens — et d’un auteur norvégien, Jens Bjürneboe —, qui jouaient pour des spectateurs norvégiens. À Holstebro nous devenions un groupe scandinave, avec des acteurs venus de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark et qui avaient beaucoup de mal à communiquer par la parole avec leurs spectateurs. On ne peut pas comprendre l’histoire de l’‘Odin Teatret si l’on ne tient pas compte de ces deux exclusions : le refus du milieu théâtral et l’amputation de la langue. Cette situation d’infériorité et cette mutilation devinrent notre fierté et notre force. Nous étions à nouveau face à cette interrogation : où pouvions-nous apprendre l’essentiel ? Les vivants ne voulaient pas, ne pouvaient pas. À qui devions-nous nous adresser ?
Le théâtre devint le Lieu où les vivants rencontraient les non-vivants. Pas seulement les morts, mais ceux qui n’étaient pas encore nés. C’est à eux qu’il faut s’adresser quand le présent te dédaigne. Tu peux alors parler avec assurance, avec des cris et des silences, aux frères aînés qui t’ont précédé et aux frères cadets qui te suivront, à ceux qui ont déjà vécu cette expérience et à ceux qui rencontreront les situations où tu te trouves : raillé par l’esprit du temps, seul face à l’indifférence de la société et à la froideur du métier.