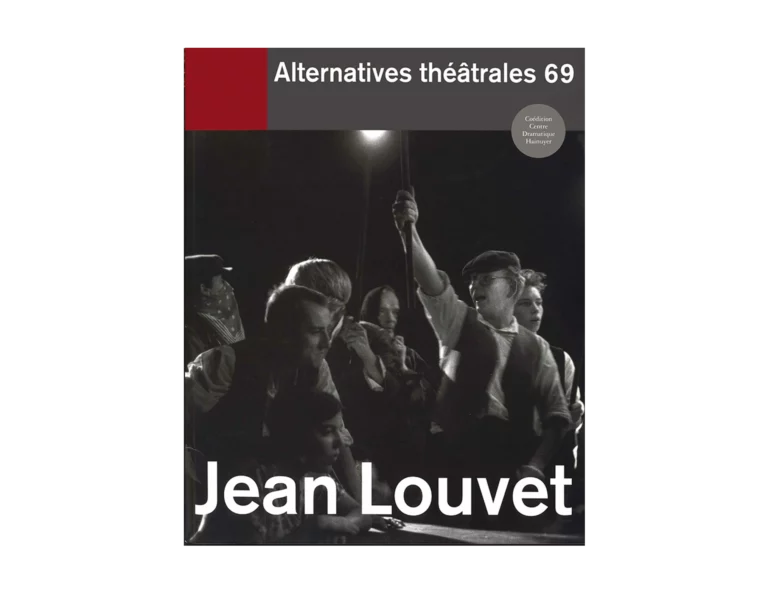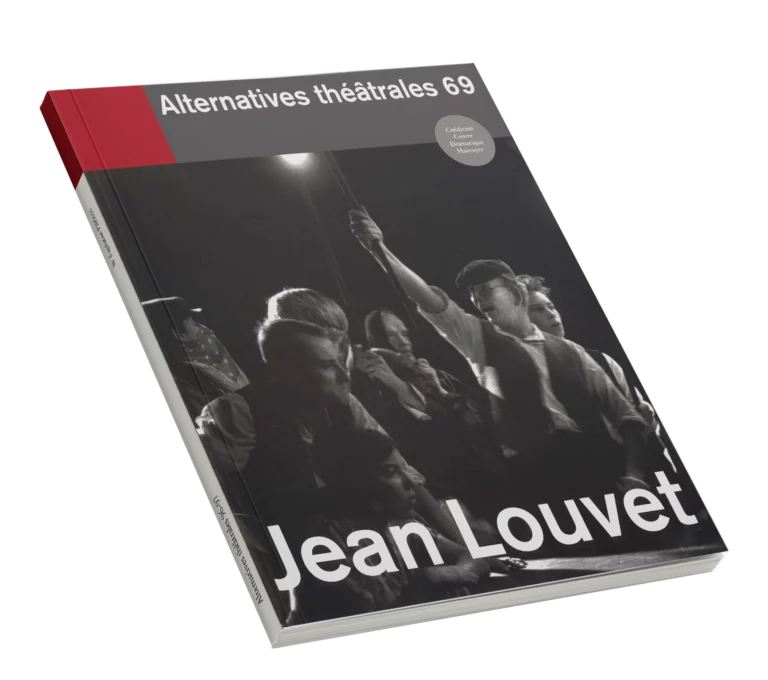Voulant interroger les pratiques artistiques dans les marges de la société, Bernard Debroux, chargé de la programmation théâtrale à Bruxelles 2000, a proposé au metteur en scène Lorent Wanson de rencontrer des familles du quart monde par le biais de l’association ATD Quart Monde, implantée à Molenbeek et animatrice de la Maison des savoirs. Après un long travail d’écoute des familles et d’ateliers d’un genre particulier, Lorent Wanson a réalisé avec l’aide de comédiens du Théâtre National un spectacle où se sont rencontrés comédiens professionnels et public d’exclus. Une aventure artistique singulière qui aura marqué chacun des participants.
FABIENNE VERSTRAETEN : LES AMBASSADEURS DE L’OMBRE est le résultat d’un long processus de travail. Deux années d’ateliers ont réuni différents partenaires : une association implantée dans un quartier, la Maison des Savoirs d’‘ATD Quart-Monde à Molenbeek, un metteur en scène et des acteurs amateurs, les membres des familles. Comment ce projet a‑t-il débuté ? Quels étaient ses enjeux au départ, pour chacun de vous ?
Jacqueline Page : L’idée est venue de Jean-Christophe Pirson et Dominique Ramaert, deux bénévoles d’ATD QuartMonde. À l’occasion de Bruxelles/ Brussel 2000, Ville européenne de la Culture, ils avaient proposé un grand spectacle son et lumières qui aurait dû se dérouler le 17 octobre 2000, journée mondiale du refus de la pauvreté. Ils voulaient faire venir à Bruxelles le metteur en scène Peter Sellars qui avait mené des projets de ce type avec les exclus blacks des faubourgs de Boston. Au couts des premières réunions avec Bruxelles/Brussel 2000, le projet s’est recenttré sur l’idée d’un partenariat entre des praticiens professionnels et des acteurs non professionnels, sous le titre provisoire de « Théâtre de Partenariat ».
Lorent Wanson : Bernard Debroux, coordinateur de la programmation théâtrale à Bruxelles/Brussel 2000, m’a fait rencontrer l’équipe de la Maison des Savoirs. Dès le mois d’octobre 1998, nous avons eu, Élisabeth, mon assistante, et moi-même, des réunions hebdomadaires avec Dominique Ramaert et Jacqueline Page, afin d’élaborer le projet. Les premiers contacts avec les familles ont commencé en novembre 1998, d’abord avec Viviane et son fils, Gwennaël, sous la forme d’entretiens au cours desquels nous avons essayé de retracer l’histoire de Viviane et de sa famille, tout en essayant aussi d’analyser le contexte juridique et social dans lequel cette histoire s’est déroulée. Ces rencontres avec Viviane et Gwenn nous ont permis d’appréhender vraiment une réalité que nous pensions connaître.
J. P.: Lorsque le projet a commencé, des membres d’ATD Quart-Monde m’ont conseillé d’arrêter. Or je pensais qu’il fallait absolument continuer. Il n’y avait pas d’atelier de théâtre à la Maison des Savoirs et ce projet était aussi l’occasion de travailler en familles, notion fondamentale pour ATD, et d’aborder avec elles un langage artistique contemporain et de qualité.
Viviane : Au cours des premières rencontres avec Lorent et Élisabeth, je leur ai raconté ce qui m’était arrivé. J’étais un peu inquiète de ce que Lorent ferait avec toute cette matière, je tenais beaucoup à ce que le récit reste impersonnel. Nous nous voyions une fois par semaine, puis nous avons organisé les premières rencontres à la Maison des Savoirs et les autres participants — Marie-Thérèse, Yvette, Christian, Christine. nous ont rejoints.
F. V.: Le projet des AMBASSADEURS DE L’OMBRE est fondé sur la notion de famille. Comment cela s’est-il passé pour les enfants ? Rudy et Gwenn, vous avez aussi été impliqués dès le début du processus ? Comment se sont déroulées les premières rencontres avec Lorent ?
Giwenn : Je ne me souviens pas très bien. Je n’étais pas là quand il est venu voir ma mère la première fois. J’ai rencontré Lorent un peu plus tard et quand ils m’ont expliqué le projet, j’ai été tout de suite partante.
L. W.: Au début du travail, je n’avais pas de projet précis et je ne savais pas à quoi Le processus aboutirait. À chaque étape, il fallait se reposer des questions, réinterroger le processus de travail. C’est encore le cas aujourd’hui à la veille d’une reprise et d’une diffusion.
J. P.: En effet, nous ne savions pas jusqu’où nous pourrions aller. Ce qui importait le plus c’était l’expérience elle-même, sans savoir si la démarche aboutirait à un spectacle. Lorsque nous avons présenté le projet aux participants, nous n’avons pas parlé de spectacle, à l’époque rien n’était encore défini. La question du spectacle s’est posée plus tard, en janvier-février 2000. Tout s’est construit dans le temps, étape après étape.
En juin 1999, nous avons rencontré les responsables du mouvement ATD Quart-Monde en France, avec Lorent et Élisabeth, parce que je pressentais un conflit vu les différences de points de vue entre ATD, et Lorent et Élisabeth. Je voulais que le metteur en scène puisse travailler librement, en confiance. Nous avons ensuite organisé la première étape de travail théâtral, ouverte à d’autres participants, notamment des membres de la chorale de la Maison des Savoirs. Et c’est à ce moment-là que sont arrivés Christian et Marie-Thérèse.
L. W.: Avec Viviane, nous avions entamé un travail à long terme, nos rencontres avaient débouché sur une matière très importante qui touchait à l’injustice sociale, aux difficultés financières, à la justice, aux expulsions, aux huissiers. Cette première période a abouti à l’écriture de deux textes sur le thème de la « demande de justice ». Ces textes ont constitué la matière de la première présentation du travail en juin. Durant cette première phase d’atelier, nous avons rencontré chaque participant individuellement, nous avons reconstitué l’histoire de chacun. C’était une manière de reproduire à plus petite échelle nos rencontres de plusieurs mois avec Viviane et Gwenn. Il fallait prendre le temps de se connaître et d’établir la confiance. La solidarité entre les participants s’est elle aussi construite peu à peu, chacun a appris à prendre en compte les histoires des autres de façon naturelle. Cette première présentation a été construite en fonction de la singularité de chaque participant et en tenant compte de ce que chacun avait envie de faire : dire, chanter, être simplement là, tomber… Ainsi, Marie-Thérèse qui nous a rejoints à un moment très difficile, puisqu’elle venait de perdre sa fille. Elle a choisi le chant qui l’avait portée toute sa vie et cela a eu un effet libérateur très profond sur ce qu’elle vivait à ce moment-là.
Marie-Thérèse : Chacun a proposé ce qu’il voulait faire. Moi je souhaitais rejouer la scène de mon mariage, ce qui a donné l’écriture de la chanson « La ronde » : « Valse, tourne, tourne… ». Pour moi, à ce moment-là, le théâtre a été une chance. Quand ma mère est décédée, je faisais aussi du théâtre et je n’ai pas arrêté.
F. V.: Christian, comment es-tu arrivé dans le projet ?
Christian : J’ai vécu longtemps dans la misère et le théâtre m’a fait du bien. J’aime jouer avec les autres, je n’ai qu’eux et j’ai confiance en eux. Ma vie a été triste et l’est encore. Au théâtre, on se voyait, nous étions en famille, nous étions plus heureux. En jouant avec les autres, j’ai repris confiance, c’était merveilleux pour moi.
Viviane : Le projet nous a permis de réapprendre une série de choses : la régularité, le fait de venir à l’heure aux répétitions, de refaire fonctionner sa mémoire, Ce qui nous a permis de remonter la pente. Moi cela faisait plus de six ou sept ans que je vivais sans gaz et électricité, et que je me battais, aidée par mon médiateur de dettes pour résoudre ces problèmes.
L. W.: Quand je suis venu voir Viviane, la première fois, Les volets de son appartement étaient fermés, il faisait très chaud, l’atmosphère était confinée. Quelque temps après, lorsque nous sommes revenus pour un nouvel entretien, les volets étaient levés, l’appartement avait été réorganisé, comme si Viviane pouvait désormais à nouveau affronter le monde.
Le spectacle s’est donc construit autour des problèmes et des difficultés que les familles ont rencontrés. Mais plutôt qu’une faiblesse, nous avons voulu en faire une arme. Nous n’avons pas voulu montrer les participants sous le couvert du manque. Le moteur était : « Nous allons vous montrer que nous sommes riches des coups que nous avons reçus, riches de nos expériences que vous, public, ne connaissez pas ou dont vous n’avez qu’une idée abstraite. Et cette connaissance de la réalité, personne ne pourra nous l’enlever ». Les familles sont fortes de leur expérience de cette réalité et c’est cela que j’ai voulu montrer. Quand on entend au Journal Télévisé qu’il y a 12 % d’enfants analphabètes en Belgique, cela reste une notion très théorique et abstraite, mais quand une toute jeune adolescente dit sur scène : « je ne sais pas lire ni écrire », on est alors face à la réalité. Et de savoir qu’un huissier peut faire doubler les dettes par les frais de justice, c’est aussi théorique … Mais quand on voit des bouches dire ces mots sur scène, quand on est confronté aux Corps qui ont traversé cette expérience, c’est autre chose, il y a alors un partage de l’expérience.
F. V.: Comment s’est passée pour chacun de vous cette première étape du passage à la scène ?Ce projet vous a aussi appris comment prendre la parole, comment être sur scène. Il y a eu tout un travail, un véritable apprentissage.
Christian : Le théâtre c’était important pour nous. Quand on joue, on regarde les gens qui vous voient, les spectateurs. On jouait pour nous mais on leur faisait comprendre quelque chose. Quand je jouais avec Gwenn, les gens nous regardaient ; et lui et moi on se comprenait …
F. V.: Est-ce que par rapport à d’autres projets initiés et menés par ATD-Quart-Monde, la spécificité des AMBASSADEURS DE L’OMBRE n’est pas justement la parole, le fait de se raconter et d’entendre les autres se dire aussi ? Ce qui se joue ici, c’est la force des mots.
J. P.: Il faut distinguer les activités proposées par la Maison des Savoirs et le mouvement même d’ATD qui organise notamment à Paris les « Universités populaires » au cours desquelles les participants se racontent en petits groupes pour parler ensuite face à une grande assemblée. Mais ce qu’on évite là — et c’est justement ce que Lorent a voulu travailler, c’est la parole personnelle et individuelle.
Viviane : À l’Université populaire d’ATD, les temps de parole sont limités. Au théâtre, dans LES AMBASSADEURS DE L’OMBRE, nous avons pu expliquer ce que nous ressentions. Lorent et Élise ont retranscrit nos entretiens et puis nous avons choisi ce que nous dirions sur scène. Au cours des premières répétitions, nous avons pris Connaissance de l’histoire des autres.
L. W.: Dans une université populaire, le but est interne. Or ici, il s’agissait de donner à entendre ces paroles, ces expériences, à un public large. À travers ces paroles, il s’agissait de poser des questions au monde. C’est le projet qui était prioritaire. Les familles se sont approprié le projet qui n’était plus inféodé idéologiquement au mouvement d’ATD. Ce qui explique aussi les contradictions, et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés.
Elise : Nous avons voulu aller jusqu’au bout de ce que nous voulions dire et montrer. Certains bénévoles d’‘ATD ont parfois peur qu’on aille trop loin, que cela ne pose des problèmes aux gens. Nous avons travaillé avec ce que les gens avaient à dire et à proposer, dans l’idée que quelque chose pouvait se libérer sur scène.
F. V.: Le spectacle est fondé sur la notion de « croisements », d’échanges d’expériences à tous niveaux :entre Les familles, avec le metteur en scène et son assistante, les comédiens professionnels, l’institution qu’est le Théâtre National, et aussi avec le public. En quoi consistent ces croisements ? Qu’est-ce ce qui a été échangé et appris réciproquement ?
Viviane : Le fait de travailler avec des comédiens professionnels nous a donné confiance en nous, puisqu’eux aussi pouvaient se tromper ou avoir le trac.
L. W.: Pendant les représentations, je restais sur le plateau. Il fallait relativiser : on fait du théâtre, c’est important, mais ce n’est jamais que du théâtre. Et les erreurs, les accidents étaient intégrés à la représentation, cela déstressait tout le monde, y compris le public dans son rapport au spectacle. Il s’agissait de faire en sorte que le croisement soit complet.
Viviane : Ce qui nous faisait le plus peur c’était la scène des procès-verbaux, le moment où nous étions tous debout face au public. Ce que nous racontions là, c’était un morceau de notre vie, un moment très personnel, et le cœur battait à toute allure, j’avais la gorge serrée. Puis nous repartions aussitôt dans la grande salle, pour couper cette émotion. On n’avait pas le temps de pleurer.
L. W.: Ces textes des procès verbaux, nous les avons réécrits ensemble à partir du témoignage de chacun. J’ai voulu les travailler comme je Le fais pour n’importe quel texte : en accordant une grande attention à la ponctuation, aux temps. Il fallait qu’on sente le travail de chaque acteur, tant du point de vue de la mémoire que dans la maîtrise de l’histoire personnelle. Il ne fallait pas plonger dans l’émotion, mais permettre la compréhension de chaque histoire : quelle incidence, quel poids, cette histoire personnelle peut-elle avoir sur la question de l’injustice ? Je voulais que le public prenne en compte les situations et les conditions d’injustice dans lesquelles les familles ont vécu. Pour Christian par exemple, raconter son histoire au passé simple n’était pas facile, mais le passé simple permet justement la mise à distance : nous parlons de notre histoire mais nous la maîtrisons, ce n’est pas tout à fait notre langue, c’est une langue réécrite.
Christian : Ce qui était difficile aussi, c’était de faire face au public, d’être là tout au bord du plateau. Mais après, quand chacun avait dit son histoire, on éprouvait un soulagement. Puis il y avait cette rencontre finale avec le public qui montait sur la scène et nous étions heureux d’avoir réussi. Mais c’était un travail énorme.
L. W.: Dans les PV, je me souviens d’Yvette qui retenait son émotion, non pas au moment de son propre récit mais en écoutant celui de Christian ou de Marie-Thérèse. Chacun devait assumer les histoires des autres, les adultes comme les enfants, les comédiens professionnels comme les amateurs. Il s’agissait d’assumer ensemble le projet, de rétablir un rapport horizontal au monde :tous étaient au même niveau, les techniciens, les comédiens professionnels ou amateurs, les enfants …
F. V.: Qu’en est-il de cette question de l’échange, dans ton travail, Lorent. Qu’est-ce que cette longue expérience des AMBASSADEURS DE L’OMBRE a modifié pour toi, dans ta pratique du théâtre ?
L. W.: Le sujet du spectacle, c’est le processus lui-même, l’expérience, la preuve qu’il est possible de travailler à la transformation de la réalité. Et pour ce faire, il faut casser l’imagerie. Or notre métier, au théâtre, c’est de produire des représentations du monde. Pour ma part, je ne pourrai plus jamais montrer un ouvrier ou un exclu sur une scène de théâtre comme je le faisais avant, parce que je me suis rendu compte que je n’en avais pas réellement l’expérience. Et cela repose la question de notre place dans la société : qu’est-ce que nous mettons en œuvre pour écouter l’autre, non pas d’une oreille compatissante ou condescendante, mais réellement, avec ce que cela implique comme transformation possible pour soi-même ? Dans ce projet, nous nous sommes tous transformés mutuellement.
F. V.: Dans l’évolution de ton travail, je te vois pour la première fois accéder à une certaine notion du « beau » : la scène des majorettes sur fond de musique de Vivaldi, la scène « blanche » à la fin du spectacle avec les enfants, qui n’est pas sans évoquer la fameuse « Marche blanche » d’il y a quelques années. Ces deux scènes induisent un rapport au « beau » presque naïf et qui évoque quelque chose comme « l’enfance de l’art » : une première approche, une approche immédiate.
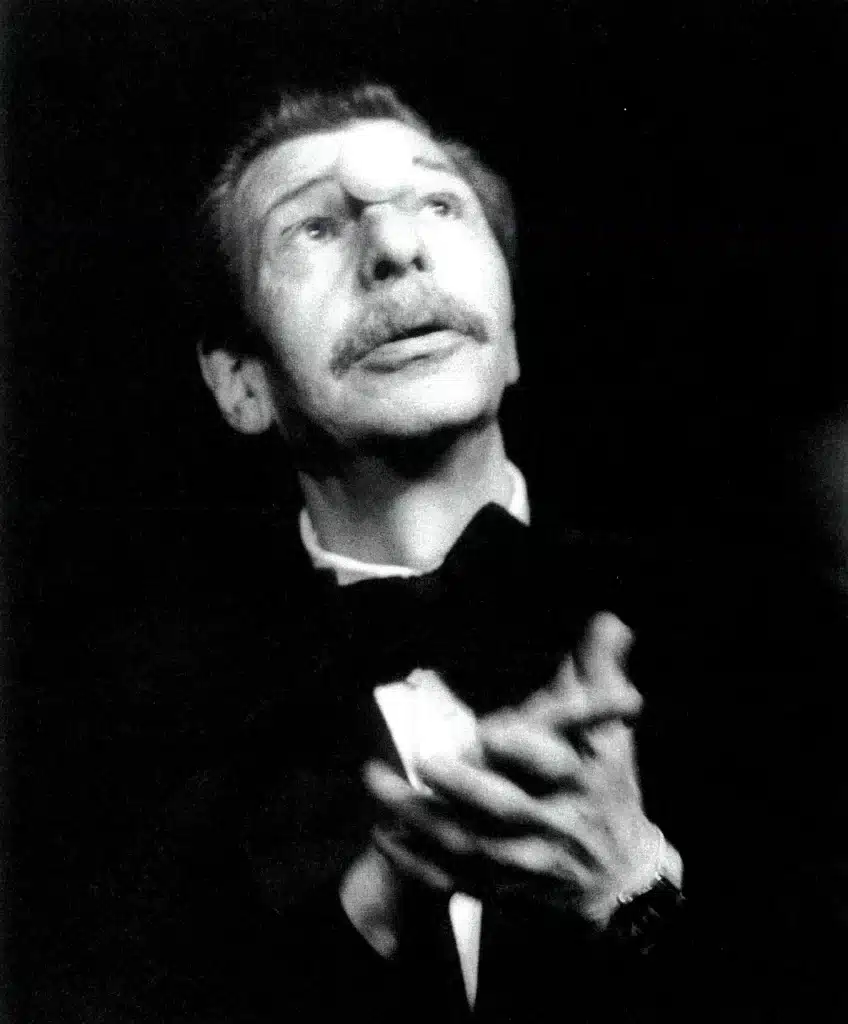
L. W.: Le projet lui-même a induit ces notions, puisque nous ne voulions pas construire à partir du manque mais bien des richesses, la richesse de tous ces gens, qui constitue leur force, leur résistance. Ce travail avec les familles m’a permis de croire que l’amour peut être porteur d’une transformation du monde. Dans la scène des majorettes, où se joue la question de la transmission de la culture populaire, c’est Danielle, l’interprète, qui a construit sa séquence ; je lui ai juste proposé qu’on n’utilise pas une musique de majorettes mais un passage de Vivaldi.
F. V.: Une musique qui rend la scène plus sublime encore…
L. W.: Une musique qui ouvre la scène et qui sort la majorette de son carcan, de son contexte. Que faisons-nous de la culture populaire ? Ici aussi, il est possible d’inventer autre chose, de produire des croisements. Il ne s’agissait pas d’éveiller une éventuelle nostalgie des cultures populaires, mais de valoriser ce savoir-faire, d’en montrer la richesse.