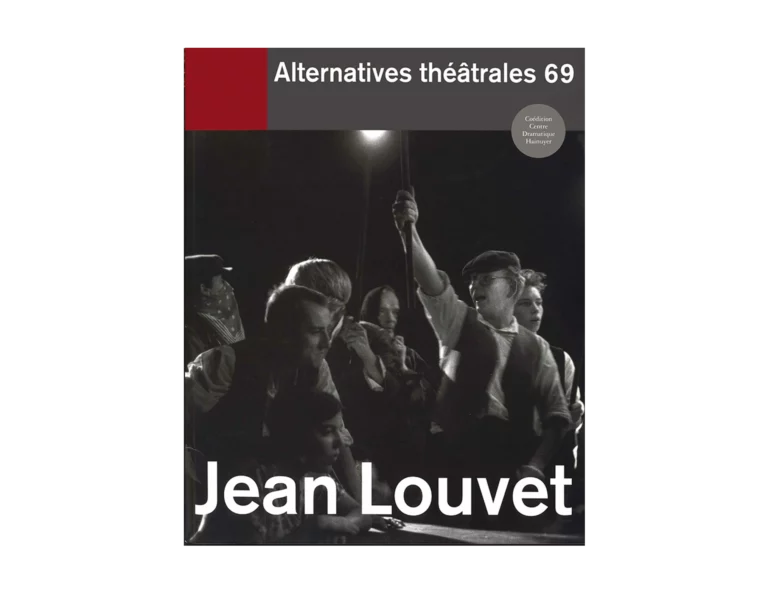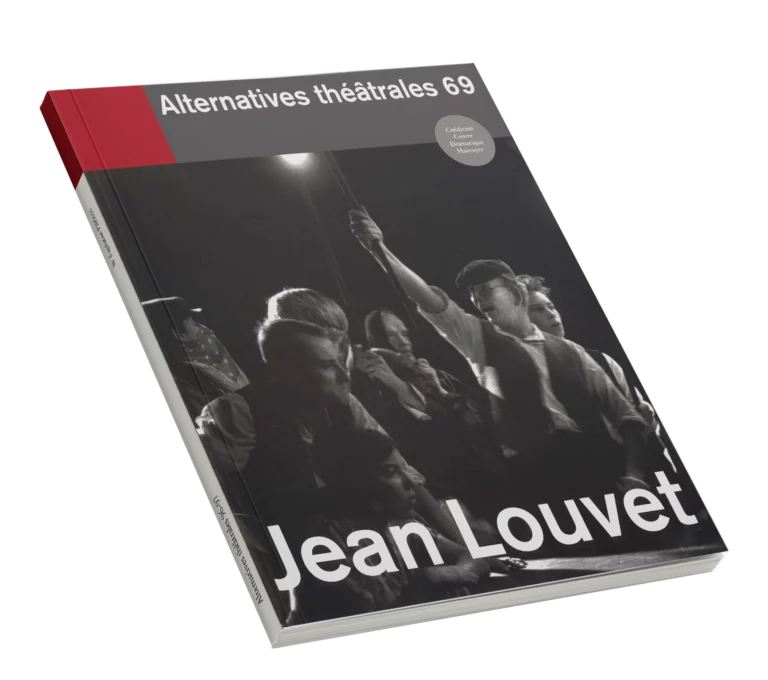L’AMÉNAGEMENT et JACOB SEUL. Ce sont les deux pièces de Jean Louvet que j’ai mises en scène à Paris, respectivement début et fin 1990. Avec le recul, je m’aperçois qu’en montant ces deux pièces coup sur coup je prenais un raccourci énorme dans le temps, lui faisant en quelque sorte outrage. Je ne savais pas alors que le temps était précisément au cœur de l’œuvre de Louvet, la façonnant et la modifiant sans cesse, la pulsant et la corrodant à la fois. Comment imaginer par exemple que JACOB SEUL allait inaugurer d’un nouvel axe dramaturgique qui ignore superbement celui de L’AMÉNAGEMENT et lui tourne résolument le dos ?
Revenir sur ces deux lieux de drame permettrait peut-être de comprendre, onze ans après, pourquoi des spectateurs et des critiques qui ont porté aux nues un spectacle comme
L’AMÉNAGEMENT ne s’y sont pas retrouvés devant JACOB SEUL. Par ricochet, cela permettrait de voir un peu plus clair dans cette dramaturgie qui n’a qu’une seule obsession : l’homme, et qui n’hésite pas à arpenter tous les chemins qui y conduisent. L’AMÉNAGEMENT, écrit au début des années 70, appartient à ce qu’il était convenu d’appeler le Théâtre du quotidien — ce théâtre-là donne à voir et à entendre comment l’idéologie dominante traverse le langage et les comportements. On y voit un homme et une femme (probablement l’unique « histoire d’amour » dans le théâtre de Louvet) s’aimer et se déchirer ; elle bourgeoise, lui genre intello de gauche, tous les deux engoncés dans les désirs contradictoires de leur appartenance sociale. Louvet Les traque dans l’intimité de leur corps comme de leur langage et quand il laisse Jo, son héros, pratiquement exsangue, c’est comme pour montrer les effets aliénants et dévastateurs de la fascination qu’exerce l’idéologie dominante sur les prolétaires et les classes moyennes. Dans cette pièce, l’auteur engagé du TRAIN DU BON DIEU, réconcilie en quelque sorte Brecht avec l’impensé de sa théorie : la mise en relation du psychisme des individus avec la structure sociale. Et la petite histoire de Jo et Hilde de se dévoiler à la lumière de la grande. Tout cela, cependant, Jean Louvet l’opère sur la scène traditionnelle du théâtre. C’est-à-dire avec des personnages identifiables, des décors référentiels et une fiction dramatique. À charge du seul « sens » de faire prendre conscience et de tout torpiller, éventuellement.
La théâtralité proposée par le texte devrait donc conduire à la prise de conscience par le biais de l’illusion. Ici, la représentation devrait être à son comble. Je n’ai pas hésité d’ailleurs en mettant en scène cette pièce. Même les écarts devaient participer à l’«identification », au rapprochement. Ceci par exemple : j’avais choisi de faire jouer la pièce en flash back, commençant par la fin, juste avant que Jo ne se tire une balle dans le sexe. Comme s’il déroulait lui-même le film des événements qui l’ont amené là. Comme le jeu, tous les éléments du spectacle, costumes, musique et mobilier, étaient « naturalistes » et référaient au début des années soixante dix. C’était une façon comme une autre de mettre à distance cette fiction afin de mieux la regarder. Ou encore ceci : la mise en scène avait distribué les spectateurs dans l’espace même du couple — comme Jo, ils étaient eux aussi aménagés.
Le théâtre comme espace de reconnaissance et de démonstration.
Jacob est seul dans une forêt où un arbre vient de mourir. Il s’occupe à réparer des écrans qui ne fonctionnent plus et. parle, s’adressant à un autre, imaginaire. Sur lui-même il ne raconte pas grand-chose. On apprend qu’il a une femme et une fille avec lesquelles il regarde la télé, qu’il est un expert, qu’il fait ses courses dans un supermarché — donc il y a une ville pas loin où il y a aussi un bureau de poste. C’est à peu près tout. Et encore, ces informations Jacob les énonce au détour d’une phrase sans s’y attarder. Et pourquoi est-il là, isolé du reste du monde ?On ne le saura jamais.
La théâtralité, ici, surgit d’une parole qui avance nue, mal assurée, délestée du poids d’un passé, d’une fiction ou d’une quelconque appartenance psychologique ou sociale. Une parole en creux. Dès lors, elle semble se charger de sa propre profération, et à l’instant même où elle est proférée. D’où son besoin vital de l’Autre quand bien même serait-il fictif. C’est l’unique « drame » de Jacob d’ailleurs : il n’est que parce qu’il parle, il n’est que tant qu’il parle. Drame de l’humanité ! Drame de l’acteur !