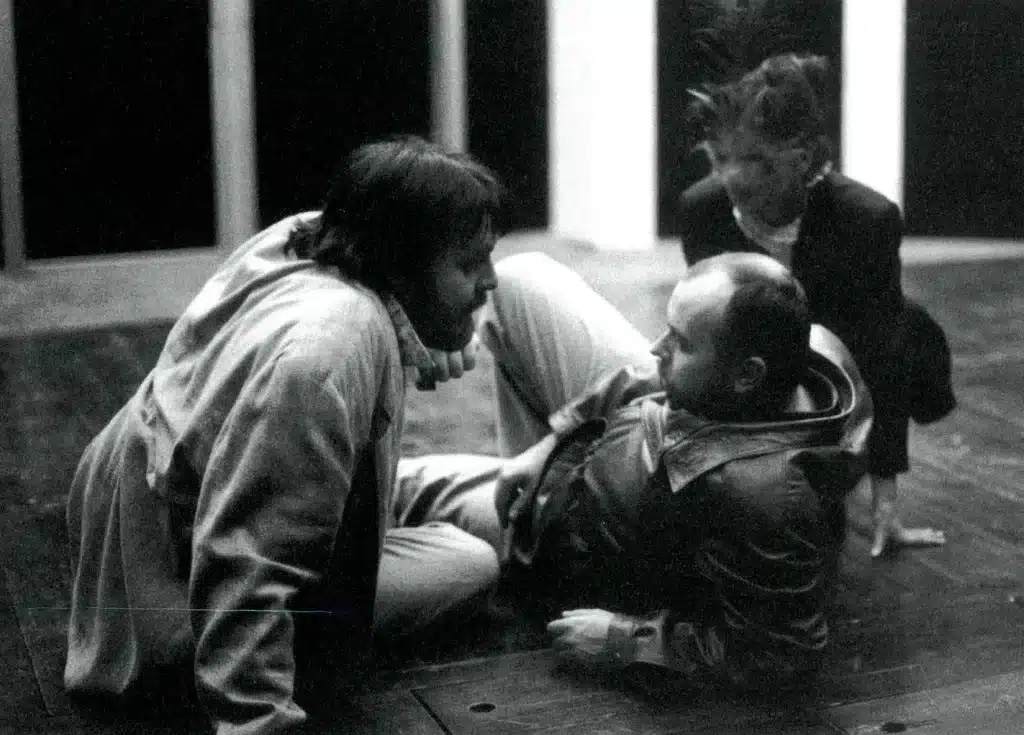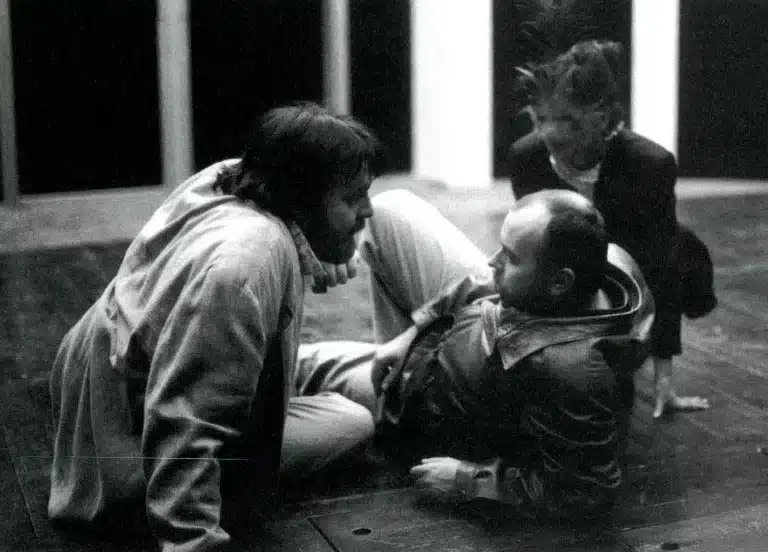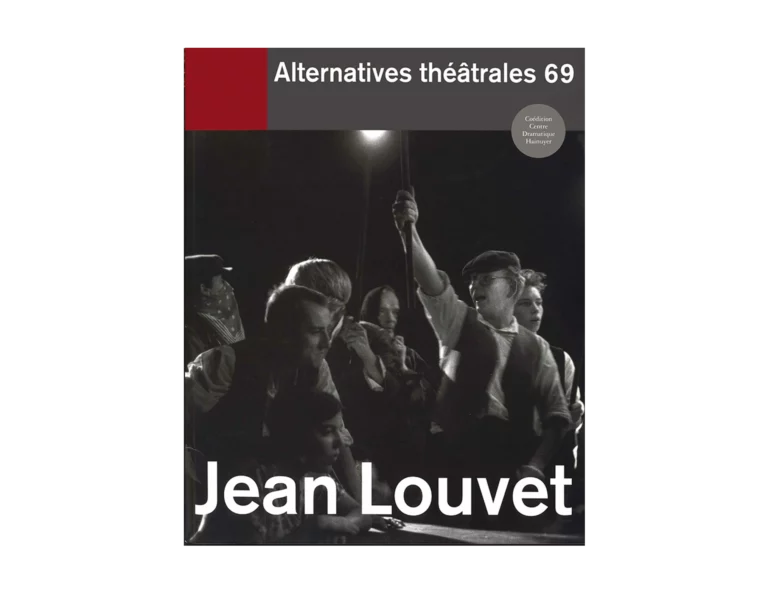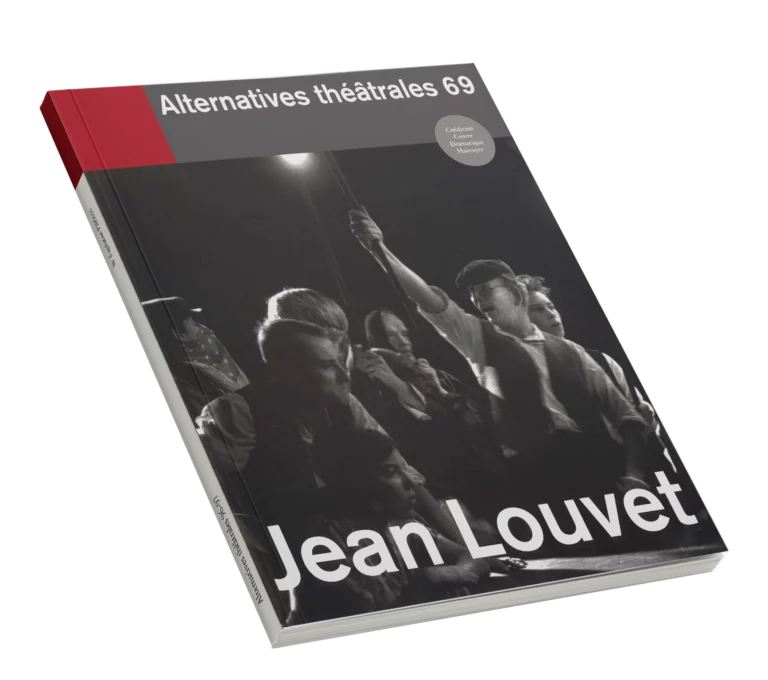ET BIEN quand je pense à lui, je vois un homme sur son seuil, une main tendue, on le salue, il salue, Louvet est un homme public, il interpelle, conseille, milite, écoute, c’est un voisin, un ami, un professeur, un écrivain, une figure qu’on ne croise pas en toute mondanité, la mondanité n’a rien à faire avec la fraternité populaire, quand Louvet est là on s’y heurte, il vous secoue, prenez position s’il vous plaît, ne laissez pas filer le réel comme si rien ne pouvait en infléchir le cours, réfléchissez, faites marcher votre cervelle, regardez le monde, regardez et agissez, il joue de la voix, appelle à la rescousse, sa solide carcasse de tribun du peuple vous énerve, vous emballe, vous subjugue, dragueur va !
C’est Bernard Dort qui m’en a parlé le premier lorsque, jeune étudiant, j’avais débarqué dans son cours en Sorbonne (autant dire juste après les guerres napoléoniennes, en tous cas largement au siècle dernier). « Piemme vous connaissez Louvet, dans le Hainaut, Jean louvet, c’est de chez vous ça ? Non ? Vous ne connaissez pas, il fait des choses intéressantes ». Armand Delcampe était revenu à la charge un peu plus tard parlant de Louvet comme si c’était son frère de lait (mettez-les côte à côte vous verrez qu’il y a du vrai là-dedans). Liebens avait fait sonner le nom une fois encore avec À BIENTÔT MONSIEUR LANG au théâtre du Parvis. Finalement, c’est par lui, plus tard, que je rencontrerai l’ours en personne, main tendue vers moi sur le seuil de l’Ensemble Théâtral Mobile comme sur le seuil de sa porte, prêt à toutes les joutes dialectiques qu’on voudra. Pour moi, à ce momentlà, il est le premier auteur vivant que je vois, un vivant à qui on peut poser des questions je veux dire. À Nancy, j’avais bien assisté un jour à une conférence d’Adamov (conférence n’est évidemment pas le mot qui convient), l’amphithéâtre était bondé, le festival de théâtre expérimental battait son plein ; j’avais vu Adamov, oui, mais de loin, à la façon dont Fabrice à Waterloo voit l’empereur. Avec Louvet tout était différent. Je pouvais faire l’intellectuel, jouer de la complicité de nos deux origines sociales, risquer des analyses de textes, penser sottement, stupidement, que j’en savais plus que lui sur ses pièces, plonger mes pattes dramaturgiques dans la mécanique de son écriture (avec Marc Liebens et Michèle Fabien, puis Philippe Sireuil), croire un temps que nos versions scéniques donnaient à ses pièces l’ultime touche de cohérence qui leur manquait : foutaise, il suffit de lire ses versions et les nôtres pour s’apercevoir que les siennes sont plus riches, qu’il écrivait un théâtre plus large, plus généreux, plus dangereux, plus attrayant que nos (mes) remises en ordre.
Au fond, la situation n’a rien d’exceptionnel, elle traduit le plus classiquement du monde la relation du texte à sa mise en scène, elle redit simplement que là où un auteur existe, le passage à la scène est un facteur d’apparition et de réduction, simultanément. Pour un auteur de théâtre, quelque chose de fondamental naît avec la mise en scène d’une de ses pièces, l’œuvre devient corps, le temps devient chair, les mots trouvent une sensualité nouvelle, mais cette mise en scène, aussi réussie soit-elle, est aussi une manière de tailler du sens dans le sens, de fabriquer à l’œuvre un costume significatif vraisemblable, de faire sonner en premier ce qui sonne clair dans l’époque. Et que dit l’époque, justement ? Que Louvet est un auteur politique, ce qui doit bien être un peu vrai puisque tout le monde le proclame, à commencer par Louvet lui-même, pas mécontent de passer pour autre chose qu’un homme de lettres. C’est entendu, Louvet parle de la classe ouvrière, du prolétariat wallon, des façons d’en être et de ne plus en être, il parle d’aliénation, du devenir-marchandise, de la mémoire et de l’oubli, des trahisons, de la mauvaise conscience des intellectuels, de leur rêve foireux, oui, bon !
Du coup, ce faisant, on laisse dans l’ombre d’autres caractéristiques, plus souterraines, moins immédiatement liées à l’énoncé du sens, des qualités d’énergie, de stimulation, de provocation, une musique des mots, un impact de la prise de parole, on feint de croire que ce n’est qu’un contenu qui parle tout seul, on y cherche une rationalité que les pièces ne demandent pas à chaque ligne ; avec un embarras certain, on repousse au second plan tout un aspect de l’œuvre fait d’écarts, de ruptures, d’hétérogénéités, de surgissements fantasmatiques, de contradictions, d’ellipses, de sautes, d’irrégularités, bref, on feint de ne pas voir le bordélique pêle-mêle qu’est aussi l’œuvre de Louvet, son jeu avec les mots, la jouissance qu’il tire de son acte d’écriture. Lisez ceci, par exemple, tiré du FAUST : « Mon bel oiseau, mon bel oiseau tout chaud comme un cou de femme. Et si tu étais le dernier de ton espèce ?
Le loup, la loutre, le blaireau, le hamster d’Europe, le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, le rat noir. Tous disparus ou en voie de disparition.
Je recueille les cadavres, les duvets poussiéreux, les plumes au vent, les âmes mortes, les nids éteints.
(il ouvre la porte de la cage)
La barbastelle commune, le daim, le loir, la musaraigne bicolore, la genette vulgaire, le noctule de Leiser, la pipistrelle de Nathusia, le lièvre commun, l’œillard méridional, le versperstilion de Brandt.
(il regarde l’oiseau)
Autant te tuer et t’’empailler tout de suite. » (p. 137)
Ou encore les premiers mots de Faust : « Boue, feuilles mortes, eau de pluie, salive de chien, fraîcheur du bouleau, j’ai oublié tout ?
(il caresse un bâton)
Cadeau de bête, rapporté dix fois, vingt fois comme s’il ne m’avait rien donné depuis des années. Qui es-tu ? Brave bolide qui me guide entre mes pas : suis-moi, la vie, c’est là. »
Ou encore ces quelques phrases de Marguerite : « Un rien suffit. Je ne me contrôle plus. Je tombe dans un trou sombre. Je ne sais pas ce que j’ai. Je n’existe plus. Ce n’est pas moi qui parle. Qu’est-ce que cela veut dire : moi ? Il n’y a plus de moi ! Ne reste que mon corps dans tes bras impuissants. » (p. 217)