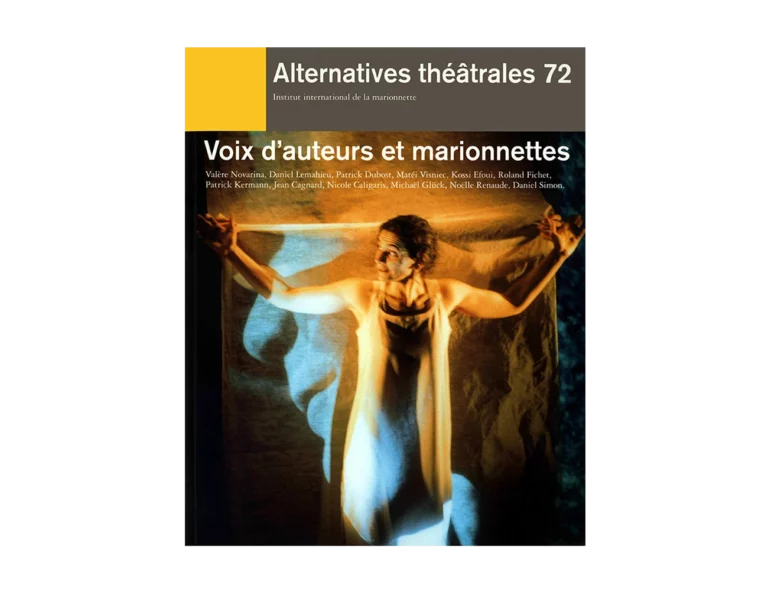I
Multiplier les origines. L’auteur n’est pas mort, mais simplement de plus en plus décentré par rapport à lui-même. Sa tête est habitée de citations, ouverte aux voix, saturée par des icônes. Tout cela il faut l’agencer : traduire n’est pas trahir, mais détourner. Le nombre de sources pour chaque texte, chaque idée, chaque œuvre est infini ; toute origine citée est un piège-à-sens, une fausse piste, au mieux une belle anecdote. Si je mentionne que l’inspiration qui m’orienta vers le théâtre est la proposition de Richard Foreman de faire une mise en scène de l’œuvre de Valère Novarina au Sint Mark’s Theater (un projet jamais réalisé, mais qui constitue le noyau de l’actuelle pièce), je le dis simplement pour objectiver ma lecture de Novarina ou pour imaginer une généalogie ; les vraies sources de la dramaturgie sont les autres de théâtre refoulées, les scènes refusées, les textes détournés.
II
Neutraliser la technique. À une époque où la forme même de la pensée est de plus en plus rapidement transformée par la technologie, une résistance possible est la mise en transparence de la technologie dans l’art. Voici un nouveau baroque : maintenant où le deus ex machina existe sous forme électronique, l’avant-garde doit chercher des nouvelles manières d’exposer les ressorts (pour mettre au premier plan la matérialité du signifiant, comme le soulignerait une certaine sémiologie). Ne pas refouler le fétiche, mais le dépecer. Ne pas supprimer les parasites, mais les encourager. Si la marionnette est sans fils — comme c’est le cas pour Le THÉÂTRE DES OREILLES — il faut révéler les ondes.
III
Accepter les interférences. Avant l’arrivée sur scène de notre opérateur, Mark Sussman, nous ne savions pas avoir créé une marionnette ; nous l’avions appelée soit poupée, soit robot. Car c’est la présence du marionnettiste qui a fait la marionnette. En revanche, la forme de la marionnette déforme le marionnettiste. L’inquiétude que suscite la marionnette, les transformations de notre corps et de notre âme qu’elle exige, sont la source même de sa beauté. Ici, la mise en scène est l’interface entre marionnette et marionnettiste ; le metteur en scène n’est qu’un parasite (dans les deux sens — biologique et électronique — du terme). L’auteur (Novarina) doit assister à une lutte littéralement à couteau tiré : après la violence (amoureuse) du découpage et du collage de textes, après la violence (intellectuelle) du montage et du mixage, s’il en reste des sentiments liés à la première lecture du texte, soit tout est raté, soit on a réussi un miracle.
IV
Brouiller les genres. Le Gesamtkunstwerk (Théâtre total) est mort ; à l’heure actuelle, la perception est conçue comme un système synesthésique, ce qui supprime la hiérarchisation des sens et des arts ; l’hybridation des genres artistiques s’établit comme paradigmatique. Chaque art porte tous les autres arts comme ses fantômes. Par conséquent, c’est grâce à une logique de la séparation (quelque peu situationniste) qu’on peut agir dans un monde totalement connecté. Cage et Cunningham l’ont bien compris, d’où leur mode de collaboration : fixer le cadre temporel, et travailler à part. Si la marionnette du Théâtre des oreilles a été créée par Zaven Paré au California Institute of the Arts sur la côte ouest des USA, tandis que la bande son originale l’était par Gregory Whitehead à Seacrow Media sur la côte est, ce n’était pas par mon désir d’être l’éminence grise de l’affaire, mais pour que l’œuvre soit ouverte au hasard, au hasard qui, depuis trois quarts de siècle, est la plus belle des muses.
V
Valoriser la polyphonie. Jouer avec les limites de la signification. Si le texte est déjà équivoque à cause de l’ambiguïté, de l’amphibologie, du néologisme, du solécisme, la voix peut ajouter un niveau de non-sens par toutes ses imperfections, toutes ses pathologies, toutes ses blessures. Le montage et le mixage peuvent démultiplier davantage les seuils de signification, de sorte que l’oreille se perde dans un labyrinthe sonore. Les plaisirs du texte s’articulent sur les plaisirs de l’écoute. Écouter est une façon de créer.
VI