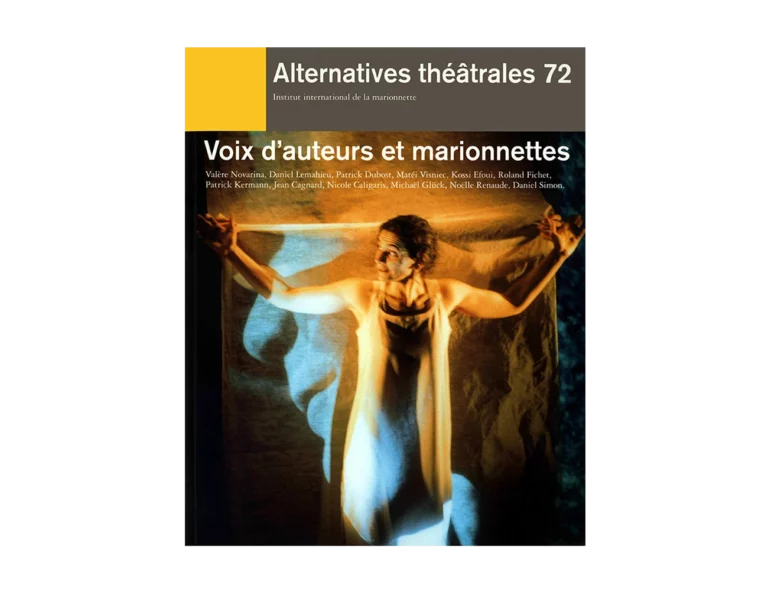Evelyne Lecucq : En tant que metteur en scène de spectacles de marionnettes, ou de théâtre d’acteurs, tu montes depuis des années des auteurs contemporains. Qu’est-ce qui t’a amené à entreprendre une démarche qui apparaît, dans sa constance, comme un véritable soutien à l’écriture de notre temps ?
Alain Lecucq : La danse contemporaine ! (rires). Je m’explique. C’est à travers la richesse de la création dans ce domaine que j’ai ressenti la nécessité d’inscrire résolument mon travail dans un dialogue avec notre époque. Il faut dire que ma formation à l’art du spectacle s’est faite pendant deux ans, à Londres, dans les années 70, auprès de John Wright, un grand maître de la marionnette à fils. Ses mises en scène ne s’écartaient pas de la tradition et de la forme du conte. Ma culture était classique — à l’exception d’un goût très marqué pour le nouveau roman — et, au milieu de son équipe, je vivais dans un univers « immobilisé ». Grâce aux invitations que nous recevions, j’ai fini par sortir beaucoup et par découvrir où en étaient les autres arts : la photographie, la musique, les arts plastiques en général, et surtout la danse contemporaine avec l’explosion formelle de Cunningham ou Nikolai’s… Cela a déclenché en moi une profonde révolution mentale et, en partant créer ma compagnie, j’ai eu la conviction qu’il ne s’agissait plus de revisiter un quelconque répertoire mais d’explorer ce que nous étions en train de vivre.
Pendant des années, j’ai monté des spectacles d’ombres, pour les adultes ou pour la jeunesse, dans cet esprit. Plus tard, avec des acteurs, j’ai mis en scène Enzo Cormann, Copi, Heiner Müller… En contrepartie, mes activités pour mettre en valeur le théâtre de papier ne sont pas entrées immédiatement dans cette démarche. J’ai plutôt essayé, dans un premier temps, de porter un regard ironique et moderne sur des sujets anciens à la façon du cabaret. Et le tournant a été pris, dans ce domaine également, lors de ma rencontre avec Michel Deutsch. Il est venu à Troyes, où ma compagnie est implantée, grâce à une manifestation sur les auteurs contemporains qu’organisait une librairie en partenariat avec les éditions de l’Arche. Il m’a vu jouer du théâtre de papier, et m’a proposé de monter sa pièce Empire-collage.
E. L.: À partir de là, tu as travaillé sur des textes de Baptiste-Marrey, Matéi Visniec et, en dernier lieu, Mohamed Kacimi, auteurs que tu as tous rencontrés. Est-ce que le contact direct avec celui qui écrit, par la possibilité d’échanges et de dialogues qu’il implique, joue un grand rôle dans tes choix ?
A. L.: Je ne passe pas du tout commande d’un sujet à un auteur. Je ne lui demande pas non plus d’écrire pour une matière formelle. Ce sont des attitudes possibles mais que je n’adopte pas. Mon désir naît de la lecture d’un texte préexistant, dans le plaisir que provoque sa formulation complète. Une fois que l’envie de m’approprier cette langue existe, je suis très heureux de dialoguer avec son auteur.
E. L.: Cette nécessité d’un texte qui est allé jusqu’au bout de sa proposition paraît liée à une autre constante dans ton parcours, dès son origine — et y compris lorsque tu pratiquais cette forme de théâtre de papier que tu rapproches du cabaret et que je nommerais plutôt « épique » parce que totalement dépourvue de gratuité —, c’est la référence importante au monde, à la société, au poids de l’Histoire. Cela peut prendre des détours à peine voilés comme chez Matéi Visniec, mais, du Maïakowski de tes débuts au référent israélo-palestinien de la pièce de Kacimi, le fil politique est nettement tendu.
A. L.: …C’est tout à fait juste. Néanmoins, ce n’est pas du tout le fruit d’une préméditation. La dimension politique est dans le questionnement, pas dans le militantisme. J’ajouterai qu’on retrouve toujours l’histoire d’une relation amoureuse forte dans mes spectacles, à l’exception de la pièce de Matéi…
E. L.: Le contexte d’oppression mentale, que Matéi nous livre dans Théâtre décomposé, la rend invivable !
A. L.: Son texte évoque, dès le début, un cercle dans lequel chacun vit seul. Impossible d’y vivre à deux. L’exclusion de l’autre est posée. Elle est en creux, elle n’est pas éludée.
E. L.: Cette notion idéologique nous ramène au sens de l’Histoire…
A. L.: Et à mon goût pour les auteurs contemporains… Nous pouvons rapprocher les pièces du puzzle si j’ajoute que la forme par laquelle je m’exprime, le théâtre de papier, est conçue pour un petit public. Elle crée une relation très proche avec les spectateurs qui engendre souvent des discussions après la représentation. Autrement dit : j’aime interpréter un auteur vivant avec lequel j’ai pu échanger des pistes de recherche, j’aime rencontrer directement un spectateur avec lequel je peux parler du fruit de ces recherches. Non pas pour donner des réponses mais pour se poser des questions ensemble et dialoguer.