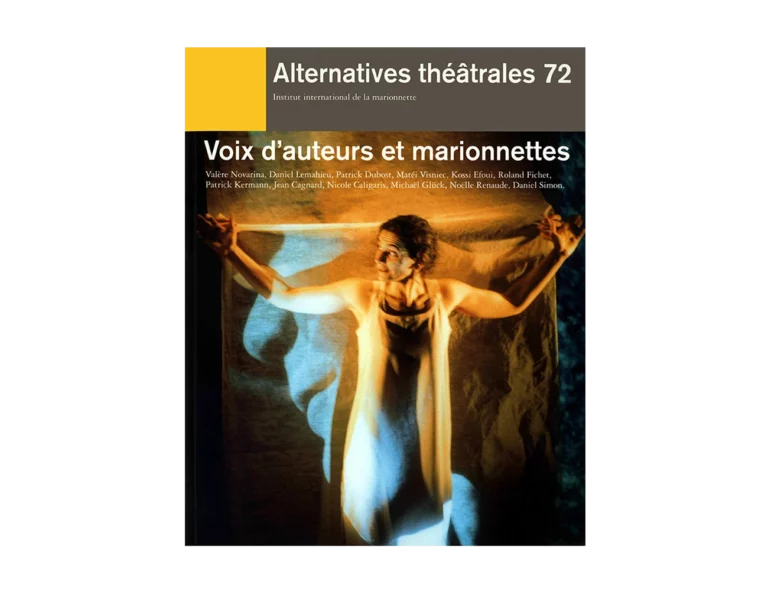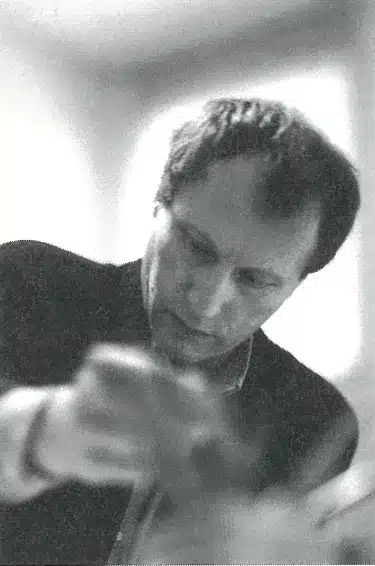
J’ÉCRIS pour faire un vivant avec un mort, par rebond, lapsus, main qui fourche, langue qui gauche, oreille qui bute, j’écris par les oreilles, par rebond sur un déchet, toujours chutant, toujours butant sur un reste. J’aime le faire près d’un fumier, au milieu des décès, non loin des morts, des restes animaux. Par prolifération, par lapsus, par gendrée, je crois toujours voir dans le mort un vivant vivre encore. C’est aux morts qu’il faut donner vie et non faire du vivant avec du vivant, ce qui serait trop facile… Parce que c’est d’une reproduction qu’il s’agit. Mais seul, sans sexe, sans corps. Et d’une reproduction qui ne produirait rien. Pas reproduire tout ce qu’on a devant mais reproduire tout ce qu’on a derrière. Voir derrière la tête. Tout ce qui tremble derrière la tête, pas le bloc fixe qui est devant. (…) Bientôt on n’échangera plus des idées mais des sauts aériens, des danses, des jets de vitesse, des foudres. Penser par foudres, dès maintenant, voilà ce qu’il faut faire, penser plus vite, plus ramassé, à la mesure du monde qui va se précipiter.
Entrée dans le théâtre des oreilles, in Le THÉÂTRE DES paroles, P.O.L., 1984, p. 74.
Bouche, anus. Sphincters. Muscles ronds fermant not’ tube. L’ouverture et la fermeture de la parole. Attaquer net (des dents, des lèvres, de la bouche musclée) et finir net (air coupé). Arrêter net. Mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange, là-bas, sur ce plateau. Qu’est-ce qu’ils mangent ? Ils se mangent ? Mâcher ou avaler. Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses (lèvres, dents) ; d’autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés. Mange, gobe, mange, mâche, poumone sec, mâche, mastique, cannibale ! Aïe, aïe !… Beaucoup du texte doit être lancé d’un souffle, sans reprendre son souffle, en l’usant tout. Tout dépenser. Pas garder ses petites réserves, pas avoir peur de s’essouffler. Semble que c’est comme ça qu’on trouve le rythme, les différentes respirations, en se lançant, en chute libre. Pas tout couper, tout découper en tranches intelligentes, en tranches intelligibles — comme le veut la diction habituelle d’aujourd’hui où le travail consiste à découper son texte en salami, à souligner certains mots, les charger d’intentions (…), le jeu consistant à chercher le mot important, à souligner un membre de phrase, pour bien montrer qu’on est un bon élève intelligent — alors que, alors que, alors que, la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d’air, un tuyau à sphincters, une colonne à échappée irrégulière, à spasmes, à vanne, à flots coupés, à fuite, à pression.
Lettre aux acteurs, in Le THÉÂTRE DES paroles, P.O.L., 1984, p. 9.
Il avait renoncé à toute idée d’expression, d’échange, de communication, de maîtrise, d’apprentissage. Il aurait voulu désapprendre, ne plus parler la langue qui dicte, qu’on nous a dictée. Il ne cherchait pas à dominer le français, le posséder, mais au contraire à l’empirer, à le mener à sa fin. Il écrivait en français crépusculaire. Il pensait perdre la tête. Il croyait habiter une machine qui descend. Encore pire, toujours plus dessous, toujours plus bas, il voulait mener son esprit, le pousser jusqu’à ce qu’il aille là où rien ne vaut plus. Dans un endroit sans valeur. Il croyait plonger, descendre là où on ne va pas plus loin. Il voulait mener lui-même son esprit à sa fin, empirer toujours. C’est un assassinat. C’est un esprit qui se détruit. C’est quelqu’un qui se tue en parlant. C’est quelque chose qui va disparaître. C’est parce qu’il croit être du temps, parler avec son propre temps, être le temps qui s’écoule en parlant.
Entrée dans le théâtre des oreilles, in Le THÉÂTRE DES PAROLES, P.O.L., 1984, p. 67.
Le langage n’est pas un outil, le langage est toujours notre corps même qui est à retraverser entièrement, et on n’écrit jamais que pour tenter de sortir vivant encore une fois de la prison humaine. La parole est résurrectionnelle. Les mots sont notre tombe, dont nous sortons en parlant. Chaque mot est un drame, parce que chaque mot se tait. Le plus petit d’entre eux contient tout le mystère de parler. Le vrai langage ne dit rien et la parole humaine est tout le contraire d’un échange marchand, d’une petite pantomime de communication où les messages seraient télégraphiés ou vendus. Pas de message dans la parole : la parole est passage. Celui qui parle est sur le seuil.
Chaque mot est un drame, in Le Magazine littéraire, n° 270, octobre 1989.