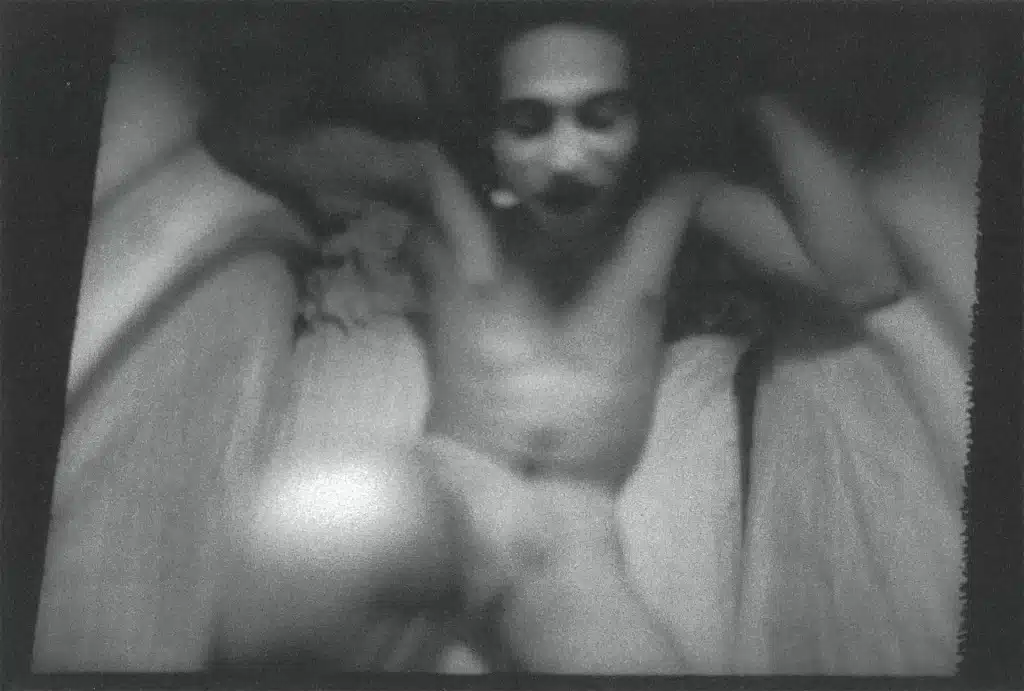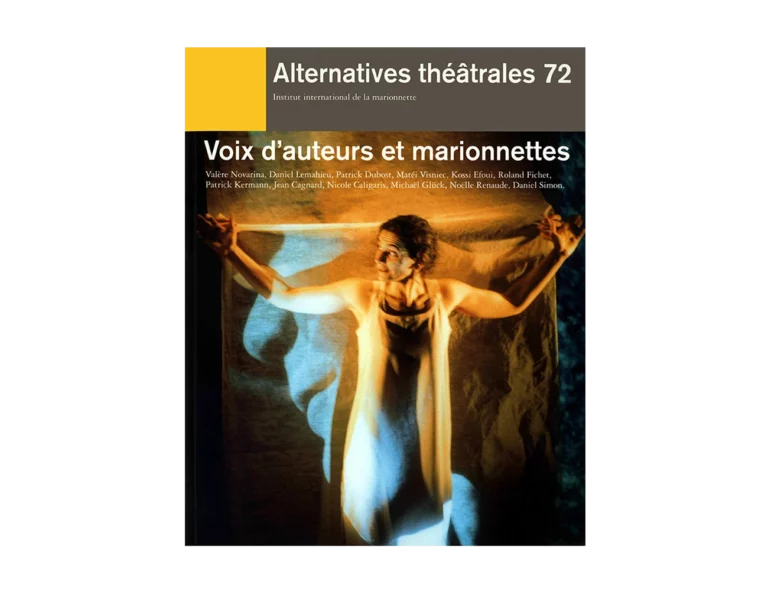CLAIRE Derouin : Dans l’expression « écriture dramatique » où se situent pour vous l’écriture et la scène ?
Renaud Herbin : Mon travail de marionnettiste est un travail d’écriture. Il se trouve que j’écris avec différents langages scéniques en m’appuyant sur des éléments dont certains sont effectivement écrits avec des mots. L’écriture dramatique est avant tout une histoire de posture. Que ce soit une nouvelle, un monologue, une série de dialogues ou une écriture poétique, j’ai un texte en face de moi et la question est : comment je m’en saisis ? Le texte est un objet mort. Un dictionnaire, c’est un cimetière de mots. Ce qui rend le texte vivant, c’est la rencontre avec l’interprète. Frédéric Fisbach dit — je le cite de mémoire : « L’auteur est un interprète, il traduit quelque chose du monde avec des mots, le metteur en scène traduit l’univers de l’auteur, l’acteur traduit les désirs du metteur en scène, et le spectateur traduit l’ensemble de ce qui se passe sur scène ». C’est peut-être tout ça l’écriture dramatique. Ce qui m’intéresse dans la marionnette au sens large, c’est l’espace qui se dessine entre les langages. La marionnette est un terme générique pour parler de cette articulation.
C. D.: Depuis votre sortie de l’ESNAM à Charleville-Mézières et la création avec Julika Mayer de la Compagnie Là Où Théâtre, vous avez expérimenté la relation de la marionnette et de l’objet à des formes d’écritures variées, textes d’hier et d’aujourd’hui, écrits ou non pour la scène, de Kafka à nos contemporains — je pense à Roland Fichet, Kossi Efoui, Noëlle Renaude, Lothar Trolle que vous avez longuement pratiqués dans le cadre du projet Naissances / Le chaos du renouveau orchestré par Roland Fichet. Cela a‑t-il tracé des chemins spécifiques dans votre démarche de metteur en scène et de marionnettiste ?
R. H.: D’abord il y a eu Kafka puis Maeterlinck. Pour Un RÊVE, je n’ai rien gardé du texte de Kafka. Ce n’est ni l’écriture ni la forme du texte que j’ai voulu traduire dans mon spectacle. C’est l’univers de la nouvelle, les thèmes, que j’ai voulu donner à voir dans un langage visuel d’aujourd’hui. Pour INTÉRIEUR de Maeterlinck, on a eu à peu près la même démarche qu’avec le texte de Kafka. Mais en moins radical. On en a gardé des morceaux et la question qu’on se posait, c’était : comment rester fidèle au récit en faisant des coupes ? Bon… Mais même si on ne travaillait pas dans un rapport fidèle aux textes, on travaillait sur des dramaturgies. Avec Roland Fichet, cela a été différent. Quand on est arrivé à la Passerelle à Saint-Brieuc pour le projet Naissances / Chaos du renouveau, il nous a remis un certain nombre de textes d’auteurs contemporains, on a fait des propositions intuitives et il nous a donné son feu vert en retour. On a donc commencé à travailler. Mais au lieu de reprendre les textes, je les ai posés et je suis tout de suite parti dans ma traduction personnelle de ce que j’avais lu. J’ai rêvé des images à partir de ma caméra obscura. En fait, j’avais la même attitude avec ces textes contemporains qu’avec du Kafka ! Je crois que cela intriguait Roland autant que cela l’énervait. Avec beaucoup de tact et de subtilité, il m’a dit : « Renaud, c’est très beau ce que tu me montres, mais ce n’est pas mon texte ». Alors, j’ai appris à enlever de la matière visuelle pour laisser le texte resurgir. J’ai appris à faire vivre les mots comme vecteur d’une sensation ou d’un propos. Jusqu’à cette expérience avec Roland, le texte s’était résumé pour moi à un prétexte. Ne pas sentir le travail sur la matière des mots dans Les pieds dans le ruisseau, plaisir relevait de l’innocence. D’ailleurs, je n’ai pas encore complètement abouti à cette dimension dans mon spectacle. J’en donne trop à voir.
C. D.: Que vous ont apporté les collaborations avec des metteurs en scène qui ont une grande expérience du traitement du texte tels que Frédéric Fisbach et Robert Cantarela ?
R. H.: Je crois que j’avais une grande méfiance vis-à-vis du texte. Il ne faisait pas partie de mon univers. J’y étais sensibilisé mais sans plus. La rencontre avec Frédéric a été décisive. Il m’a appris à placer toute ma concentration dans le texte, de la ponctuation en passant par la mise en page… Quand on a commencé à travailler sur le texte de Noëlle Renaude, le premier jour des répétitions, Fred a lu le texte avec cette façon de faire qu’il a, si incroyable. Et puis, il a dit aux comédiens : « les virgules, c’est un temps, les points c’est deux temps, vous respectez les retours à la ligne, les espaces entre les paragraphes ». Et rien qu’en respectant la ponctuation du texte on s’est rendu compte que cela suffisait à faire naître les personnages. Fred a une façon de révéler un texte qui lui est vraiment propre. Son travail s’apparente à celui d’un archéologue. Il fait un travail d’ajustement des voix avec les comédiens. Les déformations ne sont pertinentes que si elles existent déjà dans le texte. C’est passionnant. Dans son texte, l’auteur donne des clés, il induit une forme qu’il faut révéler. Nous sommes des gens de plateau, on cherche à inventer des formes qui nous sont propres et l’auteur aussi. La rencontre peut être créative.
C. D.: Où en êtes-vous aujourd’hui dans ce rapport complexe entre le texte et l’image ?
R. H.: Cette question peut rejoindre la problématique de l’acteur, du scénographe. Qu’est-ce qu’on donne à voir et dans quelles marges ? Quelles parts donner à l’abstrait et au figuratif ? Cette notion de dosage est terriblement importante. Cela soulève également la question de la posture du spectateur. D’où regarde-t-on ? En ce qui concerne la marionnette, ce qui m’intéresse c’est de travailler sur l’écart, ces petits entre-deux où le texte se met à jouer avec l’image. Par exemple dans Dans la nuit, cette femme et moi, créé d’après Le faiseur d’histoires de Kossi Efoui, nous sommes toujours dans le décalage. Même quand le texte a un rapport d’illustration à l’image. L’écart n’est d’ailleurs jamais le même. Le texte ne se réinjecte pas sur un principe rythmique régulier. Il croise l’image en des points de rencontres. Et la connexion est plus fine parce qu’invisible.
C. D.: Votre démarche est-elle compatible avec celle de la commande d’écriture ?
R. H.: Pour moi, travailler avec un auteur vivant, c’est la même chose que de travailler avec un comédien ou un compositeur. Si on ne travaille pas ensemble, cela n’a pas de sens. La commande d’écriture du genre — tiens, j’ai envie de travailler sur tel thème, je vais demander à l’écrivain untel de m’écrire un texte là-dessus ! — ne tient pas pour moi. Je ne conçois la commande d’écriture qu’intégrée à un travail d’équipe.
C. D.: J’ai l’impression que ces dernières années ont été pour vous un véritable « apprentissage » du texte contemporain. Et fructueux qui plus est. Alors, pourquoi n’êtes-vous pas parti d’un texte pour votre nouvelle création Les grands poissons mangent les petits (détails) ?
R. H.: Je me suis libéré de l’écriture textuelle dans ce projet parce qu’il y a une grande liberté dans l’écriture propre. Cette façon d’écrire un spectacle à partir d’enclencheurs, un ensemble de matériaux qui nourrissent mes préoccupations — textes littéraires, textes scientifiques, articles de presse sur la biologie, l’imagerie médicale, la représentation du corps au Moyen-Age, l’univers pictural de Bruegel, etc. — alimente pour moi un formidable canal de concentration. Il y a mille façons d’écrire un spectacle. L’essentiel étant qu’il y ait une écriture.