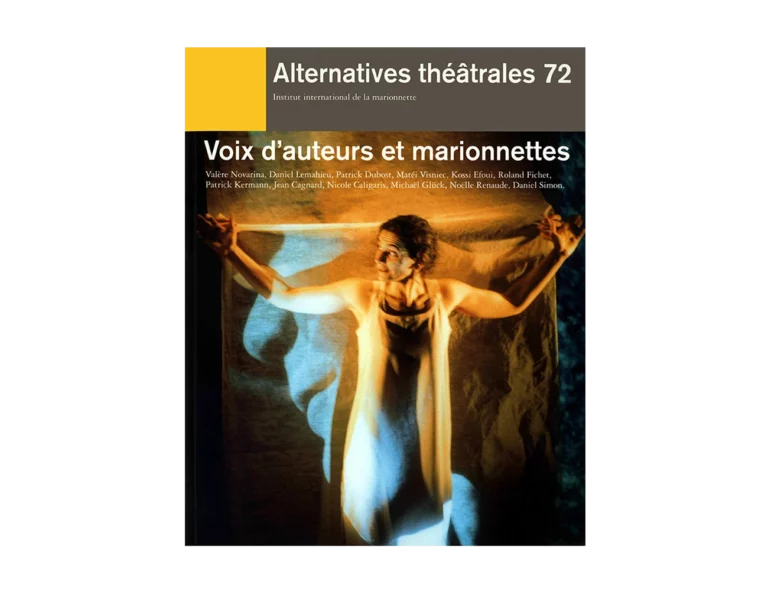Didier Plassard : La marionnette naît souvent dans l’enfance : d’un petit théâtre avec lequel on a joué, d’un spectacle qu’on a vu. Quelle a été pour vous la première marionnette ?
Valère Novarina : Gugusse de la « Loterie Pierrot », un minuscule militaire à grosse tête qui chantait léami Bidasse et des airs de Bourvil. Je l’ai vu toutes les années, à Thonon, pendant la foire de Crête, chaque premier jeudi de septembre, du début des années 50 à 1999, avec sa sœur, vêtue d’un frac et qui lançait la roue.
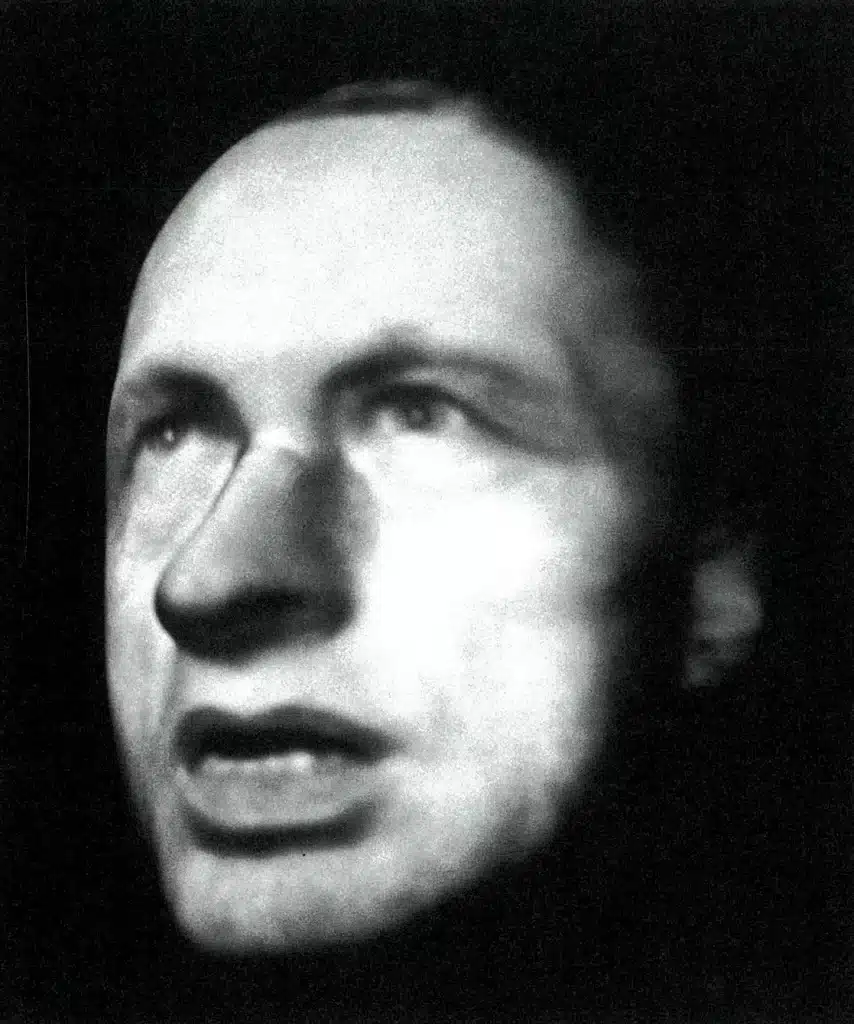
D. P. : Que peut la marionnette que ne pourrait l’acteur ?
V. N. : S’effondrer et renaître dans un instant, tomber plus vite qu’une pierre, se redresser hors pesanteur, se mouvoir dans un espace et un temps discontinus, nous démontrer visuellement que tout est saut dans la nature, passage brutal d’un monde à l’autre, paradoxe… Saltation, pratique du saut, saut et salut, saut du temps, grand trouble dans l’espace : la marionnette renverse tout : elle met l’homme bas.
D. P. : La marionnette est-elle une chose qui fait l’homme ? Ou bien est-elle un portrait de l’homme en chose ?
V. N. : L’homme en chose, offert comme une chose, un présent. Un projectile qui surgit. Et aussi quelque chose de jetable.
D. P. : Dans le théâtre de marionnette traditionnel, préférez-vous la poupée à gaine, qui est agie par en dessous, à la marionnette à fil ou à tringle, manipulée par au-dessus ?
V. N. : J’avoue avoir horreur de tout ce vocabulaire de la marionnette : gaine, tringle, fil, marionnette, manipuler… Utilisons plutôt le vocabulaire de Jarry : le théâtre des Pantins — ou bien, comme les Allemands, parlons d’un Théâtre de Figures. On peut aussi appeler les marionnettes des fétiches, des hommes faits de main d’homme. Ce théâtre-là serait alors un lieu où, dans la mêlée des fétiches, par leur lutte et par leur chute en catastrophe, on irait voir l’idole humaine se défaire. Un lieu d’insoumission à l’image humaine. Les pantins nous disent à la fin : « Allez annoncer partout que l’homme n’a pas encore été capturé ! »
D. P. : La marionnette électronique du Théâtre des OREILLES a votre visage. Les pantins de La chair de l’homme et de L’origine rouge ont la tête des acteurs. Quel doit être le visage de la marionnette ? La marionnette est-elle nécessairement un double ?
V. N. : Ce qui est beau dans la marionnette, c’est la sortie d’homme. Mais ça, l’acteur bien dédoublé (comme il y a le clavecin bien tempéré) peut le faire aussi. L’acteur, au sommet de son art, est une marionnette ; il est à la fois le tigre et le dompteur — on disait ça de Mounet-Sully… Aujourd’hui Dominique Pinon devient sous nos yeux une effigie en bois de Dominique Pinon ; Znyk offre le corps de Znyk ; Agnès Sourdillon est mue par les fils qu’elle tient. L’acteur n’est pas quelqu’un qui s’exprime, mais un dédoublé, un séparé, un qui assiste à lui, un spectateur de son corps. Un homme qui va hors d’homme. Au théâtre, c’est toujours la sortie du corps humain que l’on vient voir. On vient pour l’offrande du corps : corps porté, corps offert, parole portée devant soi. Il y a dans le pantin et dans l’acteur véritable, l’offrande d’un homme. L’homme hors de lui. Tout théâtre, en petit ou en grand, en castelet ou à Bayreuth, dans Shakespeare ou dans Gugusse, tend vers ce sacrifice, ce don de la figure humaine.
D. P. : L’équilibre, le rythme, la pulsion. Quel est pour vous, parmi ces trois mots, celui qui définit le mieux la marionnette ?
V. N. : Le rythme, le travail du temps, la chute instantanée.