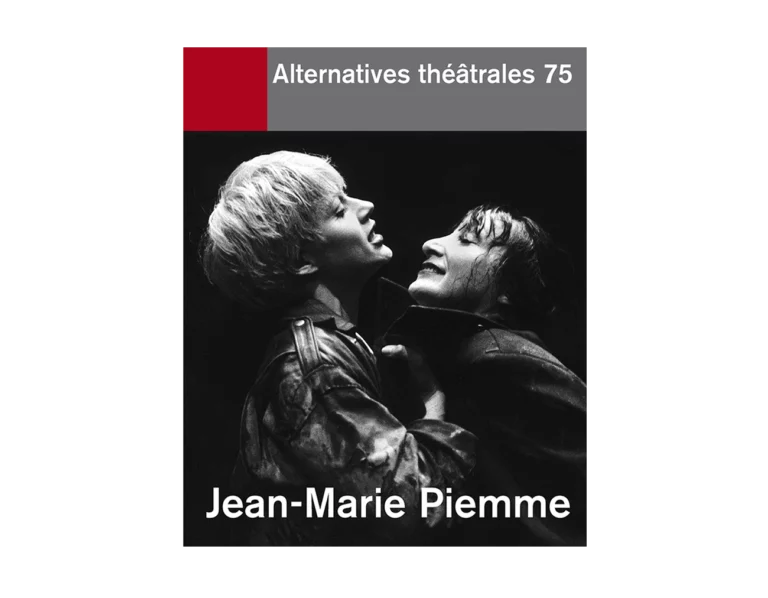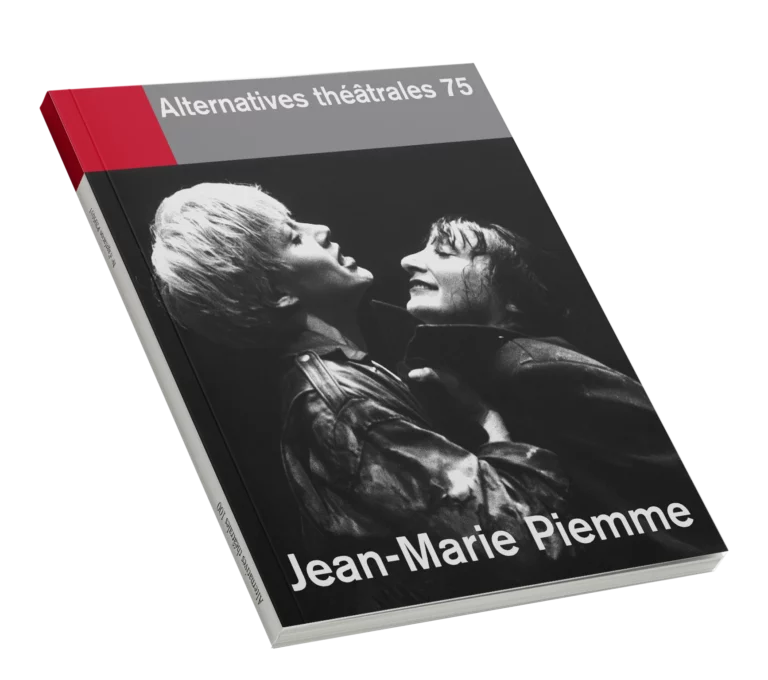Alexandre Koutchevsky : Comment es-tu entré en contact avec l’écriture de Roland Fichet ?
Jean-Marie Piemme : Je crois que la première pièce de Roland que j’ai lue, c’est De la paille pour mémoire. Elle m’a à la fois séduit et étonné. Séduit parce que j’ai bien aimé la façon dont tout ça était traité. Et étonné parce que ce sont des thématiques qui m’étaient assez étrangères d’une certaine façon.
Marine Bachelot : A l’époque, tu en es où dans ton parcours ?
J.-M. P. : Pas très loin, j’ai commencé à écrire relativement tard, puisque j’ai écrit ma première pièce en 1986. Après ça je crois que j’en ai encore écrit deux. Je devais en être à ma troisième pièce. Représentées toutes les trois. Mais je n’en étais pas moi-même à trop bien savoir — enfin je ne gère pas mon trajet d’écriture comme un général d’armée ses troupes.Je cherchais des directions, je ne savais pas trop bien quelles étaient mes potentialités ou mes possibilités d’écriture.J’étais au fond dans un démarrage réel, j’avais écrit trois pièces et elles étaient représentées. Et puis j’avais derrière moi un passé de dramaturge. Mais sur le plan de l’écriture, il faut dire que ça m’a fait un bien énorme de rencontrer d’autres auteurs, de rencontrer les paroles de metteurs en scène également sur les auteurs contemporains. Tout ça m’a considérablement stimulé, m’a un peu désenclavé également. Maintenant, à Bruxelles, il y a pas mal de gens qui écrivent du théâtre, mais au moment où moi j’ai commencé, en 1986, finalement, il n’y en avait plus tellement. On était un peu dans le creux de la vague de l’écriture. Quand j’ai commencé à écrire, on ne peut pas dire qu’on pouvait se rencontrer fréquemment ente auteurs à Bruxelles. Ça m’a désenclavé certainement. Et puis, je ne sais pas, ça a donné de la dialectique — enfin, ça a donné du regard, de l’envie, du désir, tout ça, une mayonnaise qui finit par prendre. Et on se trouve embarqué dans une aventure dont on ne sait pas soi-même où elle aboutira, mais on sent qu’on a envie d’aller quelque part ensemble, de faire un bout de chemin.
A. K. : Te souviens-tu d’une rencontre en particulier ? Y a‑t-il une idée qui t’est restée de la semaine de rencontre à Binic ?
J.-M. P. : Oui, je me rappelle des contacts que j’ai pu avoir avec Roland, où justement il parlait de la nécessité de se rassembler, non pas de se rassembler comme une école qui aurait la même base de travail, qui penserait la même chose sur le théâtre, mais de se rassembler dans une exigence commune.J’avais eu aussi des conversations avec Azama ; il était en balance, lui aussi, entre sa fonction de dramaturge à Dijon et sa fonction d’auteur et s’interrogeait sur le chemin qu’il souhaitait prendre. « Quel genre de choix fait-on ? N’y a‑t-il pas des choix à faire lorsqu’on décide d’écrire ?» Il y a des gens qui peuvent mener beaucoup d’opérations de front, tant mieux pour eux.Je ne veux pas dire qu’il y a un modèle, mais en ce qui me concerne, il fallait que je fasse un choix.J’ai fait un choix très violent quand j’ai commencé à écrire, non seulement j’ai quitté mon métier à l’opéra, ce qui sur le plan financier posait un certain nombre de problèmes, mais de surcroît, j’ai décidé de ne plus faire de dramaturgie du tout. C’est-à-dire de ne plus écrire une ligne de « théorie » entre guillemets… On a beaucoup discuté à Binic de ce que pouvait être l’écriture en général, et l’écriture de chacun. Ecrire n’est pas seulement un acte de confrontation entre soi et la machine, c’est aussi une relation à d’autres écrivains, une relation à des écrivains d’avant et des écrivains possibles d’après. Tous ces problèmes-là nous avaient quand même pas mal agités à Binic à cette époque.
A. K. : Cette première rencontre de juin 1991 a duré toute une semaine et il y avait pas mal de monde.
J.-M. P. : Il y avait à Binic cette semaine-là des auteurs, des metteurs en scène, des traducteurs, tous concernés par les questions que pose l’écriture dramatique d’aujourd’hui : Pascal Rambert, Thierry Bédart, Robert Cantarella, Catherine Anne, André Markowitz, Françoise Morvan, Marcel Delval, Michel Azama, Nordine Lalou…
A. K. : Et la thématique que propose Roland Fichet, juste après la semaine de Binic de 1991 ? Te rappelles-tu comment il vous amène ça et comment tu prends cette idée de « naissances » ?
J.-M. P. : Au départ, ça passe par un coup de téléphone. Roland me dit : « Tu pourrais faire un récit de naissance ?» À ce moment-là, je ne mesure pas toute l’ampleur de la chose.Je n’imagine pas que ça va exister dix ans, qu’il va y avoir tous ces auteurs qui se rencontrent, ces manifestations.Je me dis, oui, pourquoi pas, sans avoir vraiment d’idée ni sur ce que ça signifie, ni sur ce que ça implique. Et ça tombe au moment où je suis en train d’écrire Le Badge de Lénine, je m’en souviens très bien. Il y a un certain ton, un certain humour dans Le Badge de Lénine. Et finalement, dans la foulée du BADGE, je vais écrire RÉCIT DE MA NAISSANCE, qui est au fond un petit récit — comment dire ? — accidentellement court, volontairement court ; enfin c’est la même chose ; c’est-à-dire que je ne cherche pas à faire une forme courte ; je fais quelque chose qui dure cinq minutes. Mais au fond, à ce moment-là, je pourrais aussi faire cent cinquante pages sur ma naissance ; je ne serais pas le premier qui l’eût fait. Donc ça dure cinq minutes, parce qu’il faut que ça dure cinq minutes, ou en tout cas que ce ne soit pas trop long. Mais je n’ai pas de volonté de chercher ce qu’est une pièce courte ; j’écris un petit monologue, dont je ne sais d’ailleurs pas très bien s’il plaira à Roland, si c’est la chose qu’il cherche.Je fais ce que je fais, voilà.Je ne m’interroge pas longuement sur ce que ça signifie d’écrire sur la naissance. J’ai une idée, je la développe, je la fais fonctionner, je l’envoie par la poste.Je reçois des nouvelles un peu plus tard : « Ça passe bien ».J’apprends que c’est un des premiers textes qui arrive. Les choses s’enclenchent comme ça. Il y a tout à coup quelque chose qui se noue — toujours cette idée du lien, du nœud, de la mayonnaise qui prend.
M. B. : C’est la première fois que tu réagis à une commande ?
J.-M. P. : Oui, effectivement. Jusque-là, les trois pièces que j’ai écrites sont des pièces que j’ai décidé d’écrire, écrites en toute liberté, sans contrainte particulière. On ne me demande d’ailleurs pas du tout un monologue, parce que c’est un monologue. Roland m’a dit « un texte sur la naissance ». Et a priori je fais ça dans une forme qui est, d’une certaine façon, peu théâtrale, si on veut. Le monologue c’est toujours un peu théâtral, mais… C’est pour ça que je dis que le point de départ a été vraiment la conjonction entre la proposition de Roland et le fait que j’étais enchâssé dans une écriture du BADGE DE LÉNINE. RÉCIT DE MA NAISSANCE est une espèce d’effet collatéral de la commande et de l’écriture. Mais ça ne correspond pas à un mode d’interrogation, ni sur la naissance en particulier, ni sur le fait d’écrire court, ni forcément sur le fait qu’il va exister, plus tard un événement « Récits de Naissance » qui va prendre des visages, des figures très différentes.
A. K. : Et la thématique en elle-même, est-ce quelle te parle ou pas du tout ? Ou est-ce qu’elle est simplement le résultat de cette conjonction ?
J.-M. P. :J’ai a priori — sans avoir exploré la chose de manière particulière — une bonne relation à ce sujet. Naissance c’est un mot qui me semble à la fois conjuguer beaucoup de choses, aussi bien au niveau de l’anecdote que du mythe, quelque chose qui fait penser, forcément, au surgissement, au changement de voix (voie ?), au problème de génération, au temps. Je sens intuitivement qu’il y a là quelque chose qui me plaît bien et que ce n’est pas un thème qui va tout à coup se refermer, s’assécher, qu’entre le mot dans sa factualité et toutes les connotations qu’il entraîne, il y a au contraire une large place pour que tout à coup une commande soit aussi quelque chose qui m’appartienne à moi. Je n’aimerais pas répondre à des commandes qui ne me concernent pas vraiment.J’aime beaucoup la commande, c’est très stimulant, parce qu’au moins quelqu’un vous désire, désire quelque chose de vous, vous parle.Je trouve ça extrêmement important ; mais il ne faut pas que ça devienne une espèce de système de dévoiement de ce qu’on veut écrire. Il ne faut pas que la commande me traîne dans des lieux qui ne sont pas les miens. Mon problème, c’est de trouver dans la commande ce qui résonne intimement chez moi, pour pouvoir l’accomplir. Mais je ne l’accomplis donc qu’à ma façon. Bizarrement, je ne peux répondre à la commande de l’autre qu’en la faisant mienne, au sens où peut-être même je vais d’une certaine façon déroger aux principes qui m’ont été donnés. Cela dit, moi ça m’arrange bien. Et dès l’instant où, tout à coup, elle rejoint une thématique dont je pressens, effectivement, qu’elle est ouverte, alors je trouve ça productif.
M. B. : Et la réponse à la seconde commande : CE QUI NAÎT QUI MEURT, est-ce plus difficile ?