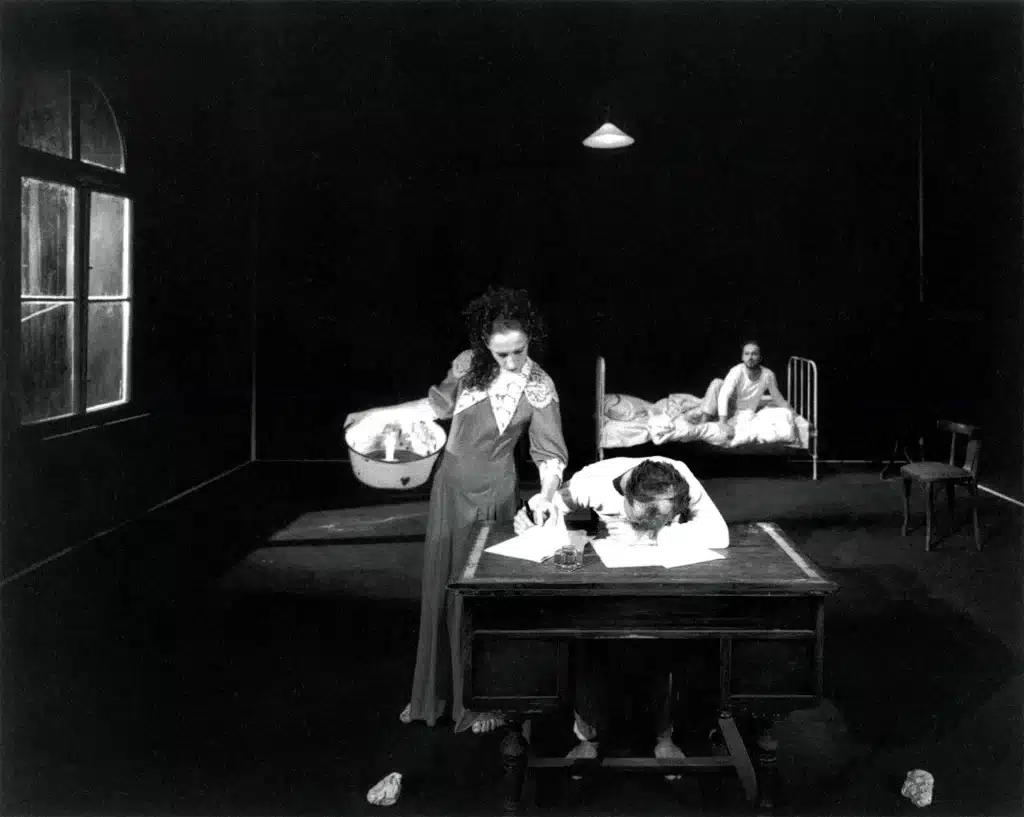I
Quel est le lien entre les œuvres littéraires vers lesquelles se tourne Krystian Lupa ? Il est difficile de définir précisément les traits particuliers de cette littérature. Ils ne se trouvent pas, en effet, dans la forme des œuvres ou dans leur construction, mais plutôt dans leur façon de concevoir le monde ; dans leur sensibilisation aux motifs irrationnels du comportement humain, dans les aspects symboliques de l’existence, dans un certain type de contact humain, ainsi que dans la vision de la réalité dans son état de décomposition, de crise.
De Mathias Korbowa et Bellatrix de Witkiewicz, il disait : « ce drame est génial par son thème ». Et il définissait ce thème comme « l’union de gens qui, profitant de la situation extrême du monde dans lequel ils sont amenés à vivre, aspirent à accomplir une œuvre inconnue jusqu’à présent, un acte de création qui les élèverait au-dessus de la religion, au-dessus de l’art et, bien sûr, de la vie ».
La littérature autrichienne, qu’il a mise en scène, l’attire par « le motif du voyage en soi-même », et il définissait L’Homme sans qualités de Musil comme « un modèle d’homme qui construit en lui-même une sorte de laboratoire vérifiant le monde, avec une légèreté quasi suicidaire, pariant sur le fait qu’il pourrait aboutir nulle part, qu’il pourrait aboutir à la négation de tout sens ». Quant à Kalkwerk de Bernhard, c’était « une tentative de pénétrer dans la folie humaine ».
Les œuvres littéraires montées par Lupa se situent dans un cadre temporel clairement défini. Entre Dostoïevski et Schwab. Dans ce cadre se trouvent Musil, Rilke, Kubin, Broch, Bernhard et aussi les auteurs polonais montés antérieurement : Witkiewicz, Gombrowicz, Wyspiański. Lupa cherche en effet dans la littérature les symptômes de la crise morale de notre époque. C’est ainsi qu’il comprend le but de son théâtre.
Il croit, après Jung, que les souffrances de l’homme contemporain ont une caractéristique propre à notre époque, que la décomposition de certaines formes culturelles européennes, qui s’accomplit depuis au moins un siècle, est la source d’un égarement et d’une incertitude particulière ; car, comme l’écrit Jung, « il n’y a rien d’étonnant dans le fait que les gens soient névrosés. La vie est trop rationnelle, il n’existe aucun espace d’existence symbolique dans lequel ils pourraient jouer un autre rôle, dans lequel ils devraient être les acteurs du drame divin de l’existence ».
Le thème de la crise, de la décomposition des valeurs apparaît déjà dans L’Abattoir de Mrozek (c’est avec ce spectacle que Lupa débute en 1976). Il concernait alors, avant tout, le modèle de l’art, la décomposition de ses formes et de ses buts traditionnels. Mais ce qui intéressera surtout Lupa, c’est la crise métaphysique, thème qu’il reprend dans les mises en scène des drames de Witkiewicz, et qu’il développe ensuite et enrichit dans l’adaptation de la prose autrichienne du XXᵉ siècle : De l’autre côté de Kubin, L’Homme sans qualités de Musil, Malte de Rilke, Kalkwerk de Bernhard, Les Lunatiques de Broch.
La littérature qu’il met en scène se donne en général pour ambition un diagnostic approfondi de la crise qui a touché la culture européenne et son étude, essentiellement dans l’espace intérieur de l’homme. Lupa se réfugie habituellement dans la représentation directe de la vérité historique. D’un côté, il a l’ambition de saisir la sensibilité spécifique, caractéristique de l’époque, de l’autre, il recherche des éléments intemporels, les aspirations spirituelles de l’homme, et tente de montrer de quelle manière elles transparaissent dans l’époque de la décomposition des structures, des systèmes sociaux, éthiques et religieux.
Ces restes de comportement rituel et mythique de l’imagination, Lupa les recherche au fond de situations en apparence banales, ainsi que dans l’espace de la « langue oubliée » des rêves et de l’imaginaire. Il pourrait répéter après Eliade : « Le mythe ne domine plus dans les secteurs fondamentaux de l’existence, il a été repoussé dans les sphères obscures du psychisme ou dans les sphères secondaires, et même dans les actions irresponsables de la communauté. »
Parler de la crise et de la décomposition des valeurs, en liaison avec l’image du monde dans l’art contemporain, frôle, il est vrai, la banalité. Chez Lupa, l’effacement des valeurs, la vision éclatée de la réalité, la décomposition des liens sociaux et des normes éthiques, sont le récit de l’expérience quotidienne.
Les héros des spectacles de Lupa, tout comme les héros des œuvres qu’il met en scène, recherchent l’accomplissement aux marges de la réalité, dans les espaces frontaliers de l’existence. C’est justement dans ces espaces de passage, entre le conscient et l’inconscient, entre le corporel et le psychique, entre l’éveil et le sommeil, entre la réalité et le rêve, qu’ils vivent leur existence ; il n’y a que là qu’il est possible, au moins momentanément, d’atteindre la plénitude.
Dans le théâtre de Lupa, la tension entre les personnages, son intensité, sa température vient du rejet des rôles sociaux, de la disparition des liens familiaux. Il en est ainsi chez Musil, Witkiewicz, Bernhard. De même chez Dostoïevski.
Les liens entre les hommes, dénués de toute garantie sociale ou morale, se forment selon des règles nouvelles, imprévues. Dans la sphère de ces relations, tendues en permanence, s’ouvre aussi la possibilité de diverses manipulations de soi-même et du partenaire. Ces manipulations, ces expérimentations, ces jeux inter-humains ont toujours pour but, soit l’obtention d’états intérieurs extraordinaires, soit l’établissement de ses relations avec le monde et les autres dans de nouveaux registres de sensations.
La vision du monde dans laquelle compte avant tout l’intensité des états intérieurs et des tensions interhumaines et leurs conséquences sur la connaissance, implique le rejet des catégories du péché et de la faute. Cela peut surprendre, d’autant plus que les héros de Lupa se permettent beaucoup, non seulement vis-à-vis d’eux-mêmes mais aussi vis-à-vis des autres. Et si le problème de la faute et du péché apparaît dans le théâtre de Lupa, il acquiert alors un autre sens. La faute consiste à s’arrêter à une étape de son développement personnel, à fuir devant soi-même, à avoir peur de la connaissance de soi-même.
Seuls les hommes avec des qualités sont enclins chez Lupa à juger facilement. Leur jugement des actions d’autrui provient de la conviction que chaque homme a un caractère défini et stable, et que ses actions découlent de bonnes ou de mauvaises intentions. Tout le théâtre de Lupa s’insurge contre ce type de pensée. Il recherche une littérature qui lui permettrait de créer sur scène une dramaturgie de personnages ouverts, dans laquelle les actions humaines se verraient retirer leurs mobiles univoques. Il en est ainsi chez Musil. Il en est ainsi chez Dostoïevski où, comme le montrait Bakhtine, l’homme ne peut devenir l’objet d’une autre conscience, c’est-à-dire une création définitivement définie et fermée.
Si on rapproche ses spectacles montés au cours des années, on pourrait voir comment Lupa, à partir de textes très différents, extrait toujours des motifs semblables, soulève des problèmes similaires. Le contact avec de nouveaux auteurs modifie cependant la perspective, et apporte un éclairage différent. Witkiewicz, Gombrowicz, Kubin, Musil, Dostoïevski, Bernhard, Broch, chacun de ces auteurs (qui apparaissent dans le théâtre de Lupa dans cet ordre) élargit progressivement sa façon de voir l’homme et le monde. Chacun d’eux détermine une nouvelle étape de sa création.
En choisissant telle et non telle autre littérature, Lupa tente d’exprimer l’état actuel de sa propre conscience en tant qu’artiste et en tant qu’homme : « Ce n’est pas la présentation du récit de chacun de ses drames qui m’intéresse, mais mon propre processus intérieur de mûrissement de l’histoire et leur participation à cette individuation. » Le choix des textes justifie souvent un moment de biographie personnelle : La Ville du rêve, tout comme le roman de Kubin, De l’autre côté, furent à la base d’un spectacle exprimant une crise de la création… La mise en scène d’Emmanuel Kant de Bernhard était la première tentative de se mesurer à l’expérience de la vieillesse.

L’expérience de l’existence que raconte le théâtre de Lupa se compose souvent d’une sorte de biographie. De la littérature allemande qui lui est proche, de Hesse, de Mann, de Kubin, de Musil, de Broch, Lupa dit qu’elle a créé un modèle de roman en tant que biographie. Mais c’est une biographie intérieure ou, comme l’appelle Lupa : une individuation. Dans ces biographies, ce n’est pas le principe de la chronologie qui prévaut, mais le rythme intérieur du vécu. Il organise les faits de la vie selon un ordre et une hiérarchie différents, dans lesquels le souvenir ou le rêve peuvent être des événements de la plus haute importance, formant l’axe du spectacle.
Des passages entiers de la vie peuvent être laissés de côté ou à peine évoqués. Les biographies individuation se forgent toujours autour d’une puissante crise intérieure qui peut conduire à la folie, à la décomposition de la personnalité, à la négation de toute l’organisation antérieure de la vie. C’est un moment dans lequel l’homme perd la sensation de l’évidence de sa propre existence, où toutes les vérités sur la vie et sur soi-même vacillent. Ce type d’aventure intérieure commence en général à partir d’une sensation de stérilité spirituelle, puis apparaît le désir d’une autre vie, sous l’influence duquel le héros prend une décision en apparence irrationnelle : il part en voyage, il abandonne sa carrière, il rompt ses liens antérieurs. Cela prend souvent la forme d’une sorte d’idée fixe.
Dans ces biographies se reflète le modèle de Faust, avec ses motifs caractéristiques : sensation d’inassouvissement, rejet de la vie suivie jusqu’alors, aspiration à une autoréalisation, initiation, plénitude atteinte sur le chemin de la défaite.
La quête la plus puissante, qui ébranle et met en mouvements les personnages dans ce théâtre, est l’aspiration à atteindre la plénitude des possibilités spirituelles, l’élargissement du moi, la mise en vibration des sens. C’est pourquoi Lupa s’intéresse, dans la biographie de l’homme, à toutes ces phases transitoires dans lesquelles s’efface l’identité univoque, dans lesquelles l’homme côtoie diverses images, parfois contradictoires, de lui-même. Dans ses personnages cohabitent différentes images de l’homme, représentant ses diverses potentialités spirituelles : l’enfant et l’adulte, la femme et l’homme. La mythologie de l’enfance et le mythe androgyne reviennent constamment dans ses spectacles ; non seulement ils apparaissent simultanément, mais ils s’interpénètrent. Mécontent des limites imposées par la condition humaine, le héros de Lupa tente d’atteindre un état de coincidentia oppositorum, ou, pour utiliser la symbolique alchimique, de réaliser l’opus magnum.
Ces personnages rejettent opiniâtrement tout rôle social. La véritable auto-réalisation est en effet la perception intense des possibilités et non l’action. Ce rêve d’auto-réalisation a des figures symboliques constantes : le personnage de l’hermaphrodite interprété à travers la symbolique de la plénitude de Jung ; les jumeaux siamois comme images du moi intérieur dédoublé, et le symbole de la transgression des limites de la condition humaine ; enfin le double, l’autre moi du héros qui accomplit les aspirations plus ou moins secrètes de celui-ci. Dans Les Frères Karamazov, Smerdiakov, le moi obscur d’Ivan, tue le père. Dans Kalkwerk, Konrad, après avoir écrit une étude dans son sommeil, regarde son double endormi avec les pages manuscrites sur la tête. De façon caractéristique, la plupart des actes, des gestes ou des actions ultimes représentés le sont dans la sphère du sommeil, du rêve, des possibilités intérieures.
Lupa représente un homme mû par son désir d’atteindre le summum des possibilités spirituelles. En décrivant ce processus, il se réfère soit à Kierkegaard et à ses trois types de vie clairement hiérarchisés (esthétique, éthique, religieux), soit à Jung et à ses étapes de l’individuation. Cela ne signifie pas, cependant, que sa création se déroule selon des plans établis d’avance. Aussi bien dans la théorie de Kierkegaard que chez Jung, la vie spirituelle consiste en crises, en périodes d’épuisement, de stagnation, de régression et de brutal développement. Elle ne se déroule pas selon un plan linéaire. Elle forme un tissu aux nombreuses fibres mêlées. On peut, sans grand risque, dire que le modèle de l’aventure spirituelle de l’homme avec lui-même et avec le monde reste, dans le théâtre de Lupa, toujours le même.
De divers textes littéraires, Lupa tire toujours les mêmes thèmes. Il en modifie cependant, comme je l’ai déjà écrit, la perspective. Chez Witkiewicz, les personnages étaient mus par un désir d’atteindre des états de perception extraordinaires. Chez Musil, par contre, les héros sont embourbés dans des relations réciproques, des obligations quotidiennes qui compliquent leur aspiration à l’auto-réalisation. La manipulation de sa propre vie et de celle d’autrui révèle la problématique éthique : la sensibilité envers la souffrance d’autrui. Avec Dostoïevski et Rilke, la problématique religieuse entre dans le théâtre de Lupa. La modification spirituelle du héros se transforme en questionnement sur Dieu. Dans Kalkwerk, par contre, pour la première fois, Lupa a montré un homme au travers des limites de sa condition physique : avec une suggestivité naturaliste, il a montré les manifestations du handicap, du vieillissement, comme du poids de l’existence quotidienne.
II
Dans ses spectacles, Lupa extrait ce qui est le récit caché des événements (les modèles rituels, magiques, symboliques) ainsi que ce qui constitue le moi obscur des héros, les mobiles honteux de leurs actions. Ce n’est pas un hasard si la littérature qui le passionne est issue du modernisme. Elle trahit son profond lien avec le symbolisme, l’expressionnisme. Dans le programme de L’Esprit de la Terre de Wedekind, le metteur en scène écrivait : « Écartelés entre des sensations contradictoires, nous choisissons le plus souvent ce qui est en accord avec les préceptes moraux et nous formulons ainsi notre comportement officiel face à la réalité ; mais dans l’autre attitude, qui vibre en nous d’autant plus passionnément qu’elle est secrète et officieuse, nous pressentons la vérité. »
Les premiers spectacles de Lupa se préoccupent essentiellement de rechercher les aspects obscurs, secrets, des comportements humains. Les relations entre les hommes sont imprégnées de cruauté, d’aspiration à la domination. Elles sont gouvernées également par l’érotisme, souvent démoniaque, pervers (Sophie dans Des Mignons et des Guenons de Witkiewicz, Lulu de L’Esprit de la Terre de Wedekind), ou homosexuels (Pandeusz-Tarkwiniusz des Mignons).
Ses spectacles sont souvent des études d’états névrotiques : le dandysme plein de motivations psychologiques complexes, l’immaturité émotionnelle, des tendances à l’autodestruction, au suicide. Il y a toujours des entrées dans la sphère du rêve, des souvenirs traumatiques ou des fantasmes obsessionnels.
Cette façon de lire les œuvres littéraires trahit sa parenté avec les méthodes d’interprétation provenant de la psychanalyse. Freud, comme on le sait, traitait les personnages de la littérature comme des personnages réels. Il adoptait envers eux les mêmes méthodes d’analyse qu’envers ses patients. Il lisait les caractéristiques et les méthodes de modification artistique de la réalité dans l’œuvre littéraire, comme des symptômes qu’il rapportait soit à l’auteur, soit au personnage.
Dans le cas de Lupa, il ne s’agit pas toutefois d’une psychanalyse doctrinale. C’est l’aboutissement de la construction scénique d’une réalité dont des tensions particulières imprègnent toutes les strates.