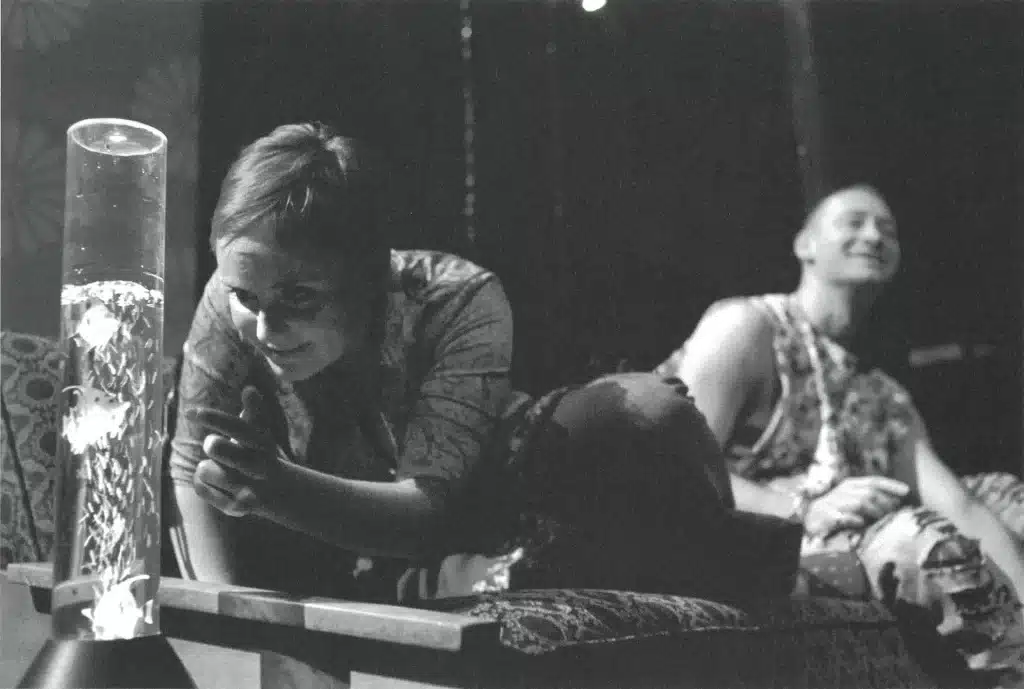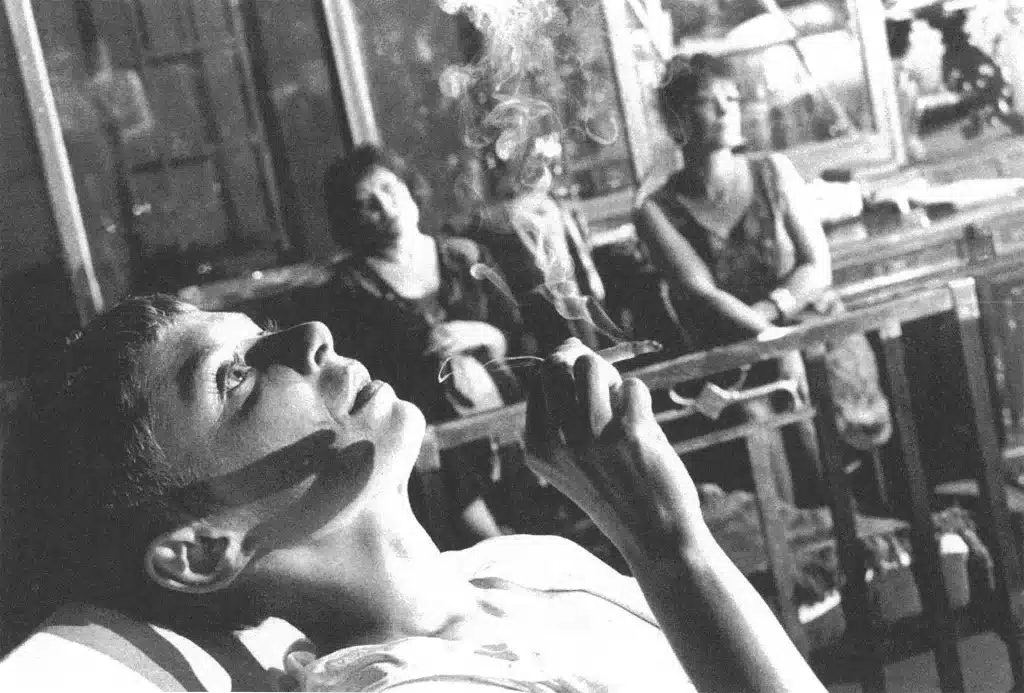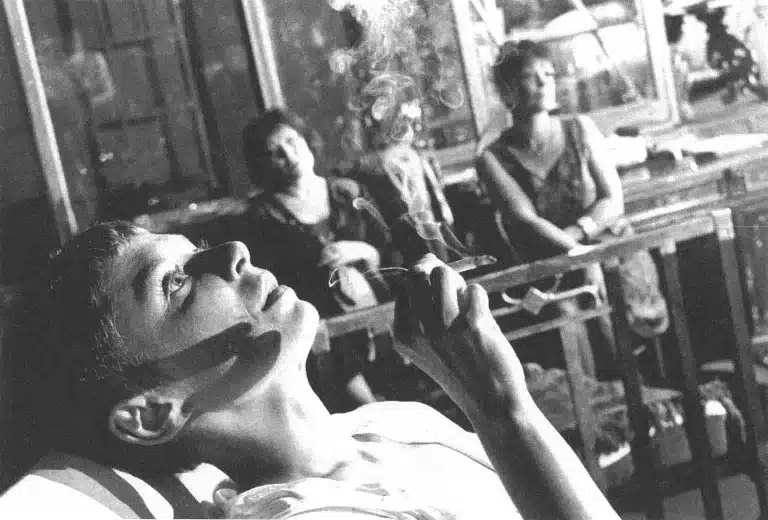Est un homme celui qui a affronté la vie. (…)
E. Canetti, La langue sauvée
Celui qui fuit devant la réalité ne mérite pas de vivre.
Une récompense pour sa perspicacité dans la lecture de la littérature théâtrale du XX siècle, pour l’originalité de la langue artistique et la force de sa création, c’est ainsi que fut justifié le verdict du prix « Paszport », attribué en 2000 par Polityka à Pawel Miskiewicz. « Le prix que je reçois constitue une confirmation du chemin que j’ai choisi et la preuve que l’on peut être remarqué en pratiquant un théâtre introverti », a déclaré le metteur en scène lors de la cérémonie de remise des prix.
Pawel Miskiewicz a attendu longtemps et patiemment une telle reconnaissance officielle. Il ne s’est pas dirigé d’emblée vers les études de mise en scène théâtrale. Il a d’abord tenté à plusieurs reprises d’entrer dans le département de formation de l’acteur, parallèlement à des études de théâtre suivies à l’Université Jagellonne (il a obtenu un diplôme d’historien du théâtre). Il n’a cependant pas réussi à concilier théorie et pratique et, en 1989, il a obtenu sa maîtrise d’acteur de l’école théâtrale de Cracovie. Il a travaillé durant quelques années au Théâtre Stary à Cracovie comme acteur, avant de débuter en 1994 par l’adaptation du Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote au Théâtre Slowacki de Cracovie.
Pendant longtemps encore, il s’est trouvé soit d’un côté soit de l’autre de la rampe (surtout dans les spectacles de Krystian Lupa). Il n’a quitté le métier d’acteur qu’en septembre 2000, lorsqu’il a pris la direction artistique de l’un des théâtres les plus importants de Pologne : le Théâtre Polski à Wroclaw, (mais le choix ne fut pas encore définitif car en janvier 2003, il a joué le rôle de Satine dans Asile de Krystian Lupa, d’après Les Bas-Fonds de Gorki).
Deux expériences semblent avoir une signification fondamentale pour sa création en tant que metteur en scène : sa rencontre avec Krystian Lupa et son métier d’acteur.
Ce n’est ni le moment ni le lieu dans cet article d’établir des comparaisons entre les réalisations du maître et celles de l’élève, même si elles dominaient les critiques des premières mises en scène de Miskiewicz. On recherchait alors à repérer des emprunts dans la construction de l’espace, dans la direction des acteurs, car « comme Lupa il aimait épier les gens et cela lui procurait du plaisir ». Récemment encore, on a écrit qu’« il se présente comme le plus fidèle acolyte ». Miskiewicz lui-même ne se défendait pas de cet héritage bien qu’il reconnaisse qu’au début cela le gênait vraiment. Avec le temps, il a commis un « parricide » (selon les termes utilisés par Piotr Gruszczynski pour qualifier l’attitude de toute sa génération vis-à-vis de l’héritage du Maître) et a commencé, avec de plus en plus d’assurance, à construire son propre monde autour d’une autre thématique, avec d’autres colorations mais avec une technique semblable.
La seconde expérience, tout aussi importante, qui distingue le style de son travail au théâtre, est son profond besoin d’être sur scène, de jouer, de transmettre à travers lui-même les sentiments et les pensées des divers personnages. Ce qui fait qu’aucun de ses spectacles n’est ni froid ou soupesé, ni politiquement ou socialement engagé. La scène n’a jamais été pour lui une tribune de parlement ou une chaire d’église, mais plutôt un confessionnal discret. Son théâtre est le lieu d’une expression individuelle très intime qui dérange et qui touche. « Je tente avant tout de monter ce qui m’intéresse moi-même à un moment donné, ce qui me fait mal, ce qui se transpose directement dans mes propres émotions. (…) La vie a déjà eu le temps de me moudre, de m’obliger à des compromis, de me priver d’illusions. Et, souvent, je raconte l’histoire de tels gens, privés d’espoir, solitaires, qui tentent de se protéger devant la douleur et le découragement. »1
« Il y a toujours eu au milieu de mes centres d’intérêt un homme semblable à moi, recherchant toujours son visage, confronté à la réalité qui le détermine. Je tente de parler de moi-même, car c’est la seule expérience qui m’est accessible. »2
Dans une de ses interviews, interrogé sur l’essence de l’acteur, il a répondu qu’elle consistait non dans le fait de montrer ce que l’on sait mais dans le fait de creuser en soi-même les douloureuses strates inconscientes. En transposant cette conception sur l’ensemble de sa création, on peut risquer d’affirmer que son théâtre souhaite pénétrer précisément ce que dans l’homme il y a de plus profondément caché.
Le premier spectacle complet de sa biographie théâtrale fut En attendant Godot de Beckett qu’il mit en scène en 1994, lors de la préparation de son diplôme de quatrième année dans le département de l’acteur, à l’école de Cracovie3. La mise en scène, presque sans scénographie et sans costume (les étudiants jouaient dans leurs vêtements personnels) obligeait les acteurs à n’avoir confiance qu’en eux-mêmes et en leurs partenaires. La même année, il a débuté officiellement sur les planches du Théâtre Slowacki par une adaptation de la prose de Truman Capote.
Ce premier choix d’un texte, d’un roman comme base de matériau théâtral, est caractéristique pour sa voie créatrice ultérieure. Les critiques enthousiastes soulignaient le talent incontestable du jeune adaptateur et avant tout sa capacité à saisir l’aspect dramatique de ce qui n’était apparemment ni dramatique ni théâtral. C’était aussi la preuve (qui fut confirmée par la variété des réalisations suivantes) que Miskiewicz est toujours d’abord fasciné par un livre, par son aventure personnelle de lecteur face à un texte. Même s’il décide de présenter une œuvre dramatique, le texte du metteur en scène ne se confond jamais avec l’original de l’auteur. Ce sont le plus souvent des variations autour d’un problème ou d’un thème, des scénarii dictés par une interprétation très individuelle, une incrustation d’autres textes raccourcis (comme Cosmos, Le Mariage et Histoire), transposés ou au contraire « réécrits à nouveau » (comme La Cerisaie), « frottés l’un contre l’autre » (comme La Souricière, La Transformation). Il arrive que le spectacle mûrisse en lui très lentement, qu’il porte l’idée d’un spectacle pendant de nombreuses années4. Parfois, comme dans le cas de Cosmos de Gombrowicz, il revient au même titre à plusieurs reprises.
Ce besoin d’une création totale, d’une construction scénique à tous les niveaux, en commençant par la forme du texte déclamé, entraîne derrière lui un certain nombre de conséquences. Avant tout, le fait que Miskiewicz intervient considérablement sur les choix scénographiques (il est souvent lui-même l’auteur des scénographies) mais aussi sur les choix sonores. Lorsque l’on regarde La Faim de Knut Hamsun, montée à Lódz, La Souricière de Rózewicz, ou Le Retour de J. Lukosz, on comprend clairement pourquoi cela se passe ainsi ; l’espace est l’un des acteurs du spectacle, il faut jouer avec ou contre lui, ce n’est jamais un espace neutre. Parfois, comme dans La Souricière, c’est un long mur gris foncé, couvert de meubles, plein de courbures et de niches, rappelant un labyrinthe, s’ouvrant ou se refermant dans un nombre infini de combinaisons, permettant la superposition de scènes de films, l’interpénétration de deux mondes, qui cernent le héros tout comme les autres le cernent. Parfois, comme dans La Faim, le public est installé sur la scène avec le Héros sans nom, dans une suite de « mansions », de petits lieux d’actions autonomes. C’est de cette manière fragmentaire que le héros perçoit le monde et les gens qu’il rencontre sur son chemin. Parfois la scénographie est chargée, pleine d’écrans et de téléviseurs, l’espace recréant la poubelle multimédia quotidienne dans laquelle nous sommes amenés à vivre (Les Relations de Claire).
Miskiewicz a un talent inhabituel pour organiser la scène. Il est capable, à l’aide d’une table, d’une paroi à demi transparente, de gens assis des deux côtés, de quelques sons et d’une projection rythmée sur le mur du fond, de donner la sensation d’un voyage en train ; ou en installant en enfilade trois chambres meublées de manière identique, séparées par des parois de tulle, de nous transposer dans les appartements-clapiers des cités du temps de « notre petite stabilisation » (Le Jardin du Paradis).
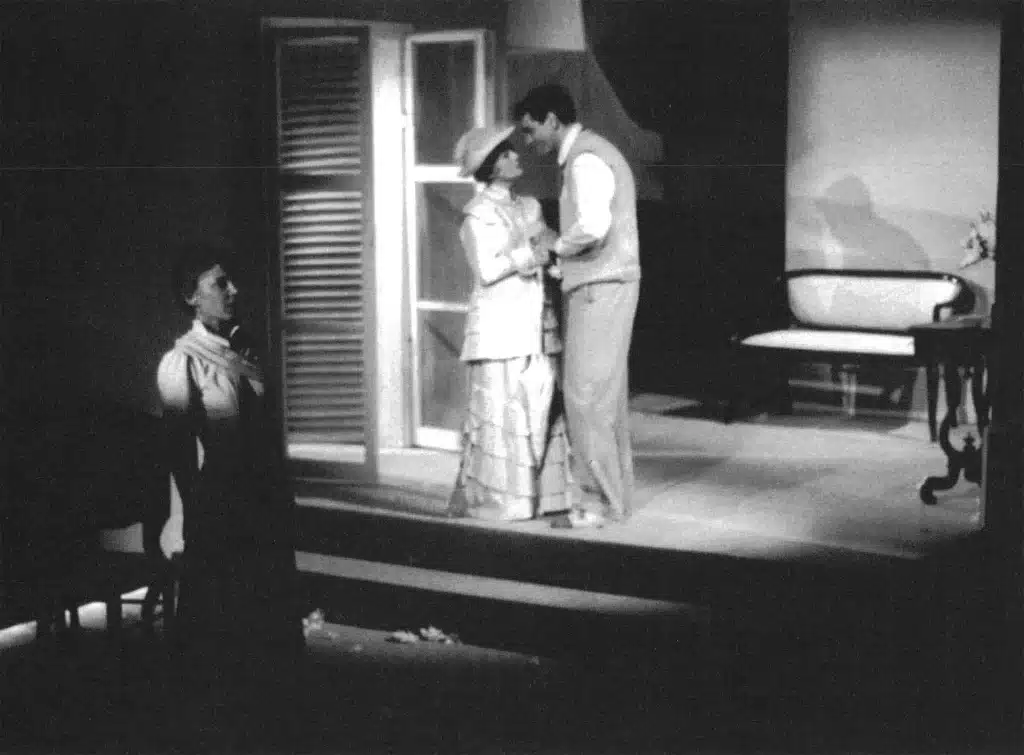
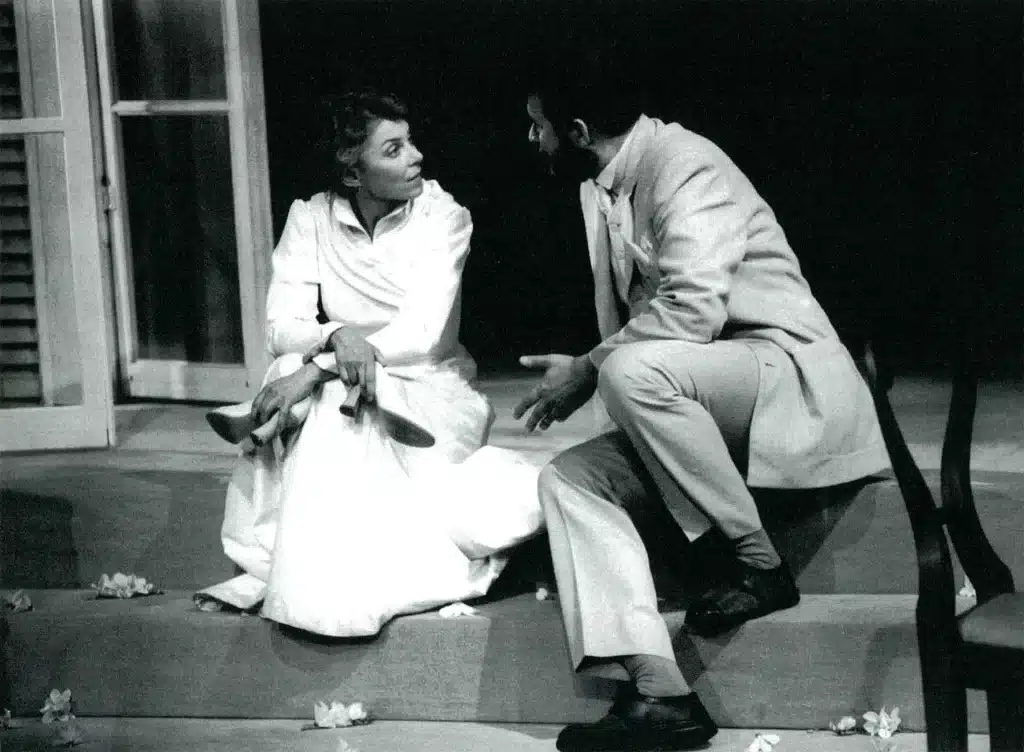
Il en est de même de la musique dans ses spectacles. Ce n’est jamais un son indifférent, décoratif, qui remplit le silence. Dans Petit déjeuner chez Tiffany, les émotions de Fred, le narrateur, qui raconte l’histoire de Holliday, étaient accompagnées (frôlant parfois la tautologie) de fragments de la Traviata de Verdi avec l’extraordinaire Maria Callas. Dans Le Jardin du Paradis, il a utilisé de manière géniale les chansons de Wanda Warska qui n’introduisaient pas seulement le climat de l’époque de la naissance des drames de Rózewicz mais, ce qui est essentiel, évoquaient de manière très naïve ce que ne savaient pas ou n’osaient pas dire les héros sur scène. C’est sans doute dans Les Relations de Claire qu’il est allé le plus loin, lorsqu’il a brisé la structure du drame et introduit un ensemble hip-hop sur la scène, accompagné de récitatifs-mélopées enregistrés. La présence des membres du groupe Grammatika, entrant en interaction improvisée avec les personnages-acteurs, rappelait, plus que les commentaires d’un chœur antique, les songs de Brecht, détruisant ou suspendant pour un instant l’illusion du théâtre, introduisant la réalité sur la scène.