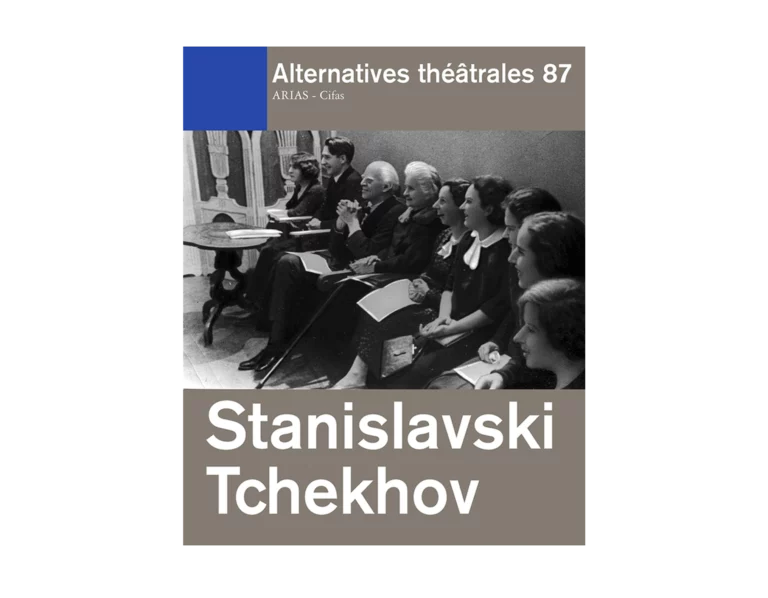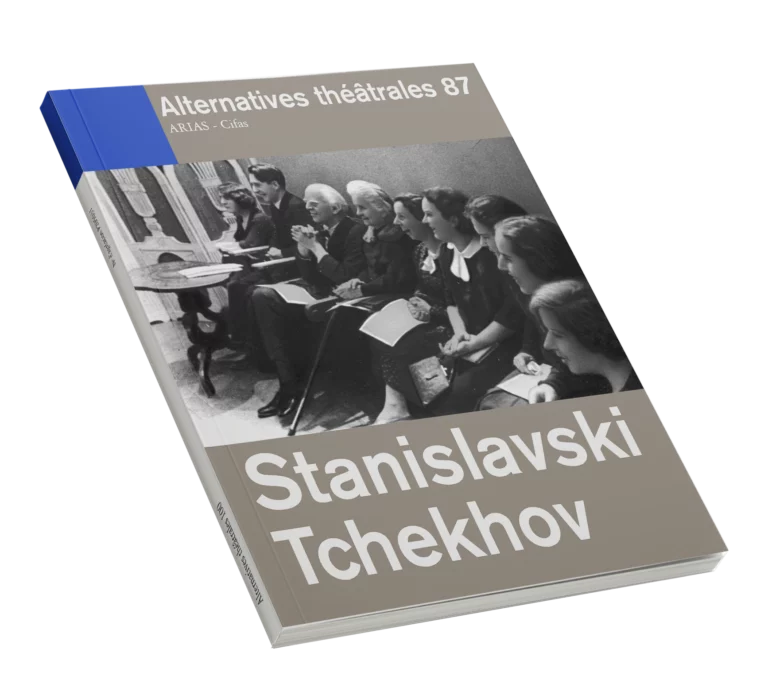LE CRITIQUE Nikolaï Efros, proposait, en 1923, de placer le Studio du Théâtre d’Art sous le signe du « grillon » comme le Théâtre lui-même se reconnaissait sous celui de la mouette 1. L’équivalence n’est pas tout à fait exacte. Car si le triomphe de la pièce de Tchekhov au Théâtre d’Art en 1898 est à proprement parler un commencement et est l’amorce d’un puissant cheminement théâtral, le succès du GRILLON DU FOYER 2, joué pour la première fois en novembre 1914 sur la minuscule scène du Studio, apparaît surtout comme un point d’équilibre, un sommet presque inattendu dans une recherche aux destinées incertaines.
LE GRILLON DU FOYER est une réussite unique en son genre dans l’histoire des mises en scène du « Studio ». Avec ce spectacle, le Studio accède à une « justification » (N. Efros) de sa propre existence. Le spectacle révèle ceux gui seront les principaux acteurs du Studio : Grigori Khmara, Vera Soloviova, Sofia Guiatsintova. Il confirme le talent de Mikhaïl Tchekhov. Alors que les mises en scène des années suivantes répondront à d’autres impératifs artistiques, LE GRILLON incarne ce à quoi est parvenu le Studio sous l’égide de Soulerjitski. Dès 1918, alors que 286 représentations ont déjà eu lieu, Nikolaï Efros va faire entrer le spectacle dans l’histoire du théâtre en lui consacrant un livre superbe orné de photographies et des esquisses du peintre Mikhaïl Libakov 3. En 1922, après 509 représentations 4, LE GRILLON est toujours joué, mais son succès n’est plus d’actualité ou d’urgence, mais de mémoire ou de nostalgie 5.
En 1914, le spectacle remplissait une attente. Rappelons quelle est la situation du Studio du Théâtre d’Art en 1914, au moment où Souchkevitch et Soulerjitski portent à la scène le CONTE DE NOËL de Dickens. Le Studio, « imaginé » par Stanislavski dès 1906, constitué peu à peu entre 1910 et 1912, mis en place en 1912, officiellement ouvert en 1913 6 , n’a pas été conçu par son fondateur comme un petit théâtre, même expérimental, destiné à doubler la grande scène du Théâtre d’Art. Il a été pensé et voulu comme une école de l’acteur, lieu de mise à l’épreuve d’une méthode d’apprentissage et d’exploration du jeu encore en gestation 7. Un matériau humain jeune, talentueux et passionné (quelques-uns des meilleurs élèves des écoles de théâtre proches du Théâtre d’Art) a été placé sous l’égide d’un mentor doué d’une intuition théâtrale et d’un sens de l’humain exceptionnels, Leopold Soulerjitski. « Le Studio n’est pas un théâtre, affirmait Soulerjitski. Nous ne jouons pas de pièces, nous ne faisons que travailler à l’élaboration d’un matériau théâtral [ … ] dont la plus grande part demeure invisible au public » 8.
C’était compter sans le désir des jeunes acteurs du Studio. Décidés à construire un répertoire et à devenir une troupe, ils ont pris l’initiative de mises en scène complètes et signées, qui déjà portent la marque d’individualités fortes. Avant même l’ouverture du Studio, l’entreprenant Richard Boleslavski, qui a joué Tourgueniev 9 sur la grande scène du Théâtre, est autorisé par Stanislavski à mettre en scène LE NAUFRAGE DE L’ESPÉRANCE ’ du dramaturge néerlandais Heijermans 10, pièce « naturaliste » qui raconte une malversation et un naufrage avec ses conséquences familiales et humaines. Fourmillant de personnages violemment dessinés, le spectacle inaugure le Studio, connaît un vif succès et sera souvent repris. De plus, il révèle, dans son premier rôle de « vieillard » (le vieux Kobus) le génie d’acteur du jeune Mikhaïl Tchekhov. Le second spectacle du Studio (novembre 1913 ), LA FÊTE DE LA PAIX de Hauptmann, sombre drame familial, monté par Evgueni Vakhtangov, échoue sur les écueils du naturalisme et de la convention 11. Stanislavski se déchaîne contre un spectacle « hystérique ». Pourtant on y trouve déjà la dominante des travaux ultérieurs de Vakhtangov : acuité, radicalité, mise à nu des procédés. La pièce, jouée trois saisons, ne restera pas à l’affiche du Studio.
Cependant, critique et public voient clairement qu’il existe dès cette date une « personnalité » du Studio, une « ligne artistique » commune, un projet global, qui détermine un répertoire, des contenus, un type de jeu, une forme, des choix de mise en scène. La dévotion à Stanislavski, au « Système » en cours de formulation, est manifeste. La critique académique hostile à Stanislavski verra dans le Studio la pointe extrême de ce qu’elle considère comme une démarche artificielle, stérile et prétentieuse. Du côté des « studistes » (stoudiitsy ), la préoccupation d’unité n’est cependant pas unanime. Même si Vakhtangov, à cette époque, respecte, parfois à son corps défendant, une discipline de groupe et maintient avec Soulerjitski les liens d’une affection ancienne, Boleslavski fait preuve de la plus grande autonomie, et Mikhaïl Tchekhov, comédien d’abord, construit ses rôles à sa façon. Le Studio, conçu comme dépendant du Théâtre d’Art, s’en démarque manifestement. Sans doute n’y a‑t-il pas de projet global formulable et formulé, mais il se dégage une tendance.
Elle se définit par l’association étroite d’un projet humain et d’un projet artistique à l’intérieur d’une cellule de dimensions réduites. Déterminante est, de ce point de vue, la personnalité de celui entre les mains de qui Stanislavski a remis le Studio : Leopold Soulerjitski. Écrivain et peintre de talent, marin, aventurier, homme de conviction et d’engagement, énergique et chaleureux, tolstoïen convaincu, venu tard, mais avec passion, au théâtre, il servira, jusqu’à sa mort en décembre 1916, de « maître de vie » au Studio dont il fait le lieu privilégié d’une exigence éthique 12. Le collectif théâtral n’est pas, pour « Souler », un but en soi, mais l’occasion d’amener à plus d’humanité un groupe de jeunes gens en pleine formation morale. De ses convictions tolstoïennes, Soulerjitski retient surtout des positions spiritualistes, humanistes et pacifistes, la revendication d’un travail ancré dans des valeurs terriennes et des structures de type communal. « Rapprocher les gens, construire une œuvre commune, des buts communs, un travail commun, une joie commune, lutter contre la vulgarité, la violence et l’injustice, servir l’amour et la nature, la beauté et Dieu », tels sont les objectifs du théâtre 13. Soulerjitski, auquel Stanislavski a donné de droit pleins pouvoirs sur le Studio, laisse la marque de ses convictions sur son travail artistique. Sans jamais signer lui-même, il revoit toutes les mises en scène du Studio, leur imprimant un tour optimiste et humanitaire 14.