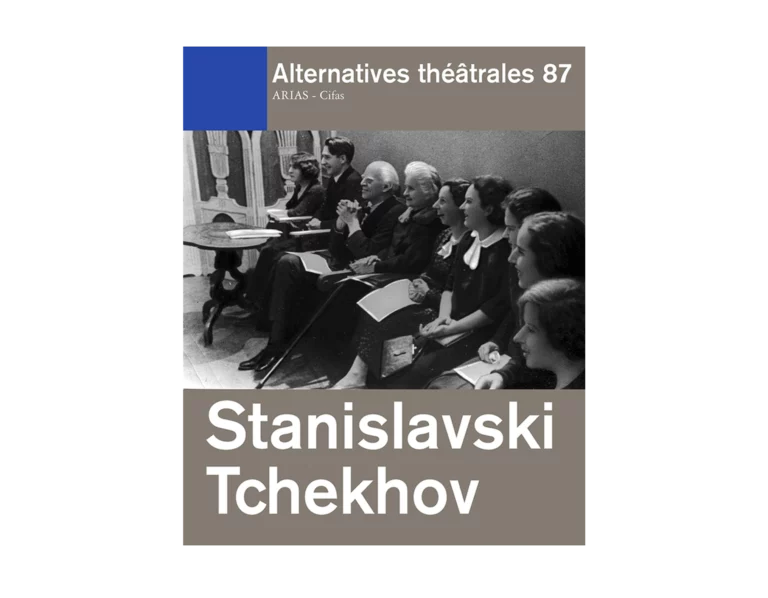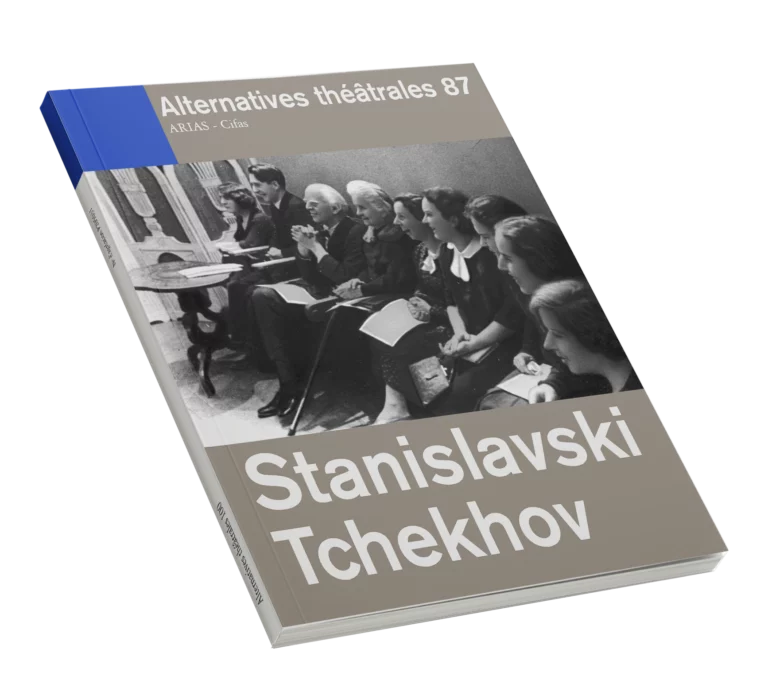CONSIDÉRÉ par le monde théâtral anglo-saxon comme un maître dans le domaine de la pédagogie de l’acteur, Mikhaïl Tchekhov, neveu du dramaturge, ne fut pas seulement l’introducteur de la « méthode » de Stanislavski en Angleterre et aux États-Unis, il fut aussi, tout au long de sa vie, un fidèle disciple de Steiner dont les enseignements dans le domaine de l’eurythmie ne cessèrent d’influencer son travail d’acteur et de pédagogue. Cet aspect de sa pratique artistique, longtemps occulté par la critique soviétique, continua, après son exil en 1928, à colorer de façon très singulière sa transmission de l’héritage stanislavskien.
L’adhésion de M. Tchekhov à l’anthroposophie n’est nullement un cas isolé. Nous devons la resituer dans le contexte des mouvements spiritualistes qui, depuis la fin du dix-neuvième siècle, ont fortement influencé le symbolisme puis l’expressionnisme et d’autres courants des avant-gardes historiques, et contribué à la création d’une véritable « contre-culture » artistique marquant aussi bien le monde de la danse avec R. Laban, que celui de la peinture avec V. Kandinsky, de la musique avec A. Scriabine ou de la littérature avec A. Biely. Le plus important de ces mouvements est sans conteste la théosophie, officiellement fondée en 1975 par Helena Blavatsky, un mouvement qui a exercé son influence sur l’Europe tout entière, regroupant en 1900 près de 10 000 membres et fait de nombreux adeptes en Russie, parmi lesquels les écrivains symbolistes V. Soloviev, V. Brioussov et A. Biely. Ce vaste système de pensée en lutte contre l’hégémonie du matérialisme visait à fusionner la philosophie, la science et la religion dans un seul courant transhistorique allant des cultes à mystères de l’Antiquité aux religions orientales, en passant par le mysticisme chrétien. Il se trouva concurrencé, à partir de 1910, par la montée de l’anthroposophie fondée par Rudolph Steiner, ancien secrétaire de la branche allemande de la société, qui rompit avec les nouveaux dirigeants du mouvement théosophique sur la question de la place à accorder au christianisme, et regroupa bientôt autour de lui un très grand nombre d’adeptes prêts à accompagner ses conférences à travers toute l’Europe, puis à le suivre dans l’aventure prométhéenne de construction du Goetheanum de Dornach, près de Bâle. La multiplicité des champs d’application de l’anthroposophie explique en partie son succès dans le monde artistique. Scientifique de formation, Steiner avait consacré une thèse à Goethe dont il fut l’infatigable commentateur ; mais il se passionnait aussi pour la médecine, l’éducation et les arts, et en particulier, dès 1910, pour le théâtre (il écrivit sous l’influence de E. Schuré plusieurs drames-mystères). Il conçut enfin, à partir de 1912, un nouvel enseignement baptisé « eurythmie » qui se développa considérablement jusqu’à sa mort en 1925, et connut à travers le monde un succès qui ne s’est pas encore totalement démenti.
Appliquant au langage le principe goethéen selon lequel le microcosme est une image réduite du macrocosme, Steiner tenait le langage humain pour une image du Verbe créateur divin, ultime lien rattachant encore l’homme au Cosmos. Voyant dans les consonnes, regroupées par types, une correspondance avec les douze signes du zodiaque et la représentation du monde extérieur tel que l’homme le perçoit, et dans les voyelles, l’expression d’une vision plus subjective, Steiner élabora avec ses collaboratrices successives un ensemble de mouvements corporels aptes à rendre visibles les propriétés universelles de ces sons. Ainsi la voyelle « a » s’accompagnait-elle d’un mouvement d’ouverture des bras vers l’espace, le son « o » d’un geste d’embrassement, bras arrondis, etc. Développée en un ensemble beaucoup plus complexe entre 1915 et 1922, soutenue par un système de correspondance avec les couleurs inspiré de Goethe, l’eurythmie connut un grand retentissement en Europe et des développements éducatifs et thérapeutiques aussi bien qu’artistiques. Parallèlement à la rythmique dalcrozienne qui cherchait à exprimer par le corps les émotions suscitées par la musique, tout en visant elle aussi l’élévation spirituelle de ses praticiens, l’eurythmie participait du rêve nietzschéen de retour aux origines divines du chœur antique. Cette pratique corporelle visant à exprimer « la danse qui vit dans les mots » se trouva rapidement enseignée aussi bien à Paris qu’à Moscou et fut parfois même pratiquée par des élèves de Dalcroze. Toutefois, l’enseignement du maître passait surtout par ses innombrables écrits et par les conférences que lui-même et ses disciples prodiguaient inlassablement dans les capitales européennes.
De retour de Dornach en Russie, A. Biely exposait dès 1917, dans des conférences brillantes et devant un parterre qui pouvait atteindre mille personnes, les vues de Rudolph Steiner. Sabachnikova donnait des cours officiels d’eurythmie au Proletkult de Moscou et l’historien d’art T. Trapeznikov, lui aussi revenu de Dornach, dirigeait officiellement la conservation du patrimoine. Lounatcharski lui-même, commissaire du peuple à l’Instruction publique, ne cachait pas son intérêt pour les livres du fondateur de l’anthroposophie. La situation changea vite cependant puisque l’anthroposophie fut officiellement interdite en 1924 et que les mises en garde se firent de plus en plus pressantes jusqu’à la persécution des sympathisants à partir de 1928 1.