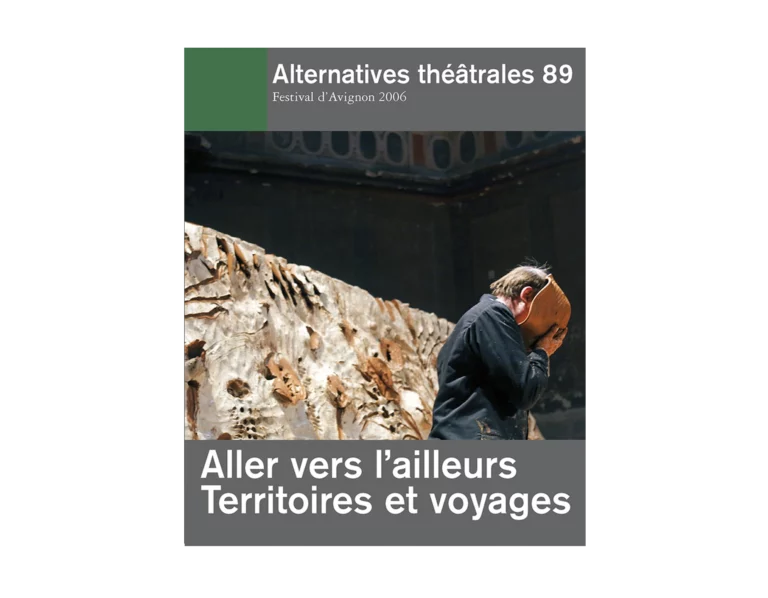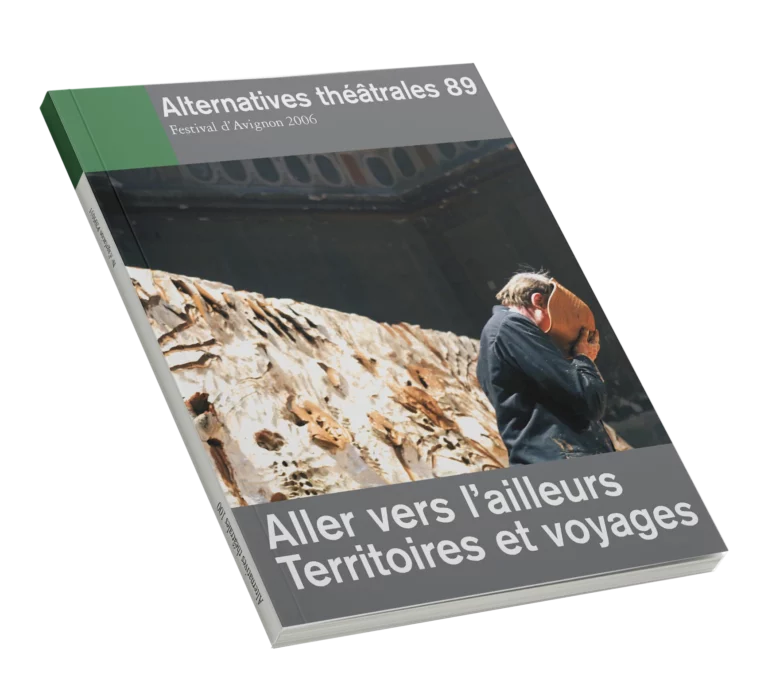AU RETOUR du Japon, au printemps 2005, il raconte la première histoire ; celle d’un vieil artisan de Tokyo qui insiste pour l’inviter chez lui et lui offrir le thé cérémoniel. Après avoir bu plusieurs gorgées du breuvage, l’hôte lui fait signe de tendre l’oreille. Une chute retenue de gouttes d’eau, éclatant sur des pierres, compose une mélodie dont l’oreille, distraite ou attentive, se délecte. À côté de la pièce du minuscule appartement, au rez-de-chaussée de tours de quinze étages et dans la courette grande comme un mouchoir de poche, un dispositif, imaginé par le Japonais philosophe, procure l’illusion sonore de La cascade dans une nature vierge. À Jodhpur, dans le jardin du regretté Komal Kothari, le musicologue indien du Rajasthan, Bartabas demeure assis de longues heures, tétanisé par tous ceux qui arrivent du désert de Sind et font une halte dans la maison amie. Parmi eux, sous leurs volumineux turbans de voile de coton, les musiciens Langas et Manganiars qui jouent pour leur maître-protecteur et se tuent sut les marches des palais lorsque leur chant a cessé de lui plaire. Par un léger signe de main ou un battement de paupières, il ne peut s’empêcher de dévoiler sa préférence pour le son le plus étranger, pour la voix la plus lointaine. Sans doute se livre-t-il, sur Le champ, à une expérience de dépouillement de ce qui constitue son champ de sensations intimes.
Il laisse croire qu’il ne connaît ni les modes indiens, ni les micro-tons ni la complexité des mélismes, ni les rythmes aux temps incongrus pour les occidentaux. Pourtant ses choix deviennent des révélateurs, dans la mesure où le son engendré provoquera des questionnements chez les futurs auditeurs occidentaux. Dans les espaces desséchés du Nord de l’Inde, les voix, les cordes des kamancha, les claquements des kartal de bois, font naître des ondes liquides qui désaltèrent et rafraîchissent les peaux, les muscles, les sangs. Les musiciens, qui viennent du fond des temps, et dont les rêves se forgent autour d’oasis et de lacs, le reconnaissent comme un chef et, sur le champ, le nomment Barta Khan.
Où se situe le lointain dans la musique coréenne ? Les timbres des instruments à vent ou des cordes subtiles d’un ensemble sirawi, dont les très larges ambitus projettent, par saut ou glissements démesurés, la conscience de l’espace vers des territoires en gestation, mettent Bartabas dans un état d’attente. Cette espérance du moment révélateur va se dévoiler lorsque la chanteuse de p’ansori entonnera une mélodie de sa « voix de sang ». Comme tous les musiciens qui se destinent à exécuter un p’ansori, cet « opéra à un seul acteur » et qui peut durer six heures, elle a subi un apprentissage que beaucoup qualifieraient d’inhumain ; celui d’exercer sa voix devant une chute d’eau et d’essayer d’en dominer le vacarme. Les cordes vocales s’irritent, gonflent, cèdent sous l’effort et finissent par saigner. La cicatrisation qui laisse des traces confère au chanteur ou à la chanteuse un timbre très particulier où l’enrouement n’empêche pas de jouer avec d’infinies subtilités de passages de voix de poitrine à fausset. Ce son, à la fois mélodique et brisé qui semble jaillir d’un monde des origines, développe un pathos qui fait jaillir Les larmes des auditeurs.
Le froid envahit les cellules du monastère accroché à une paroi rocheuse de la montagne du Bhutan. Une odeur de beurre rance flotte dès le matin, alors que les sons métalliques des cloches tintent et que résonnent les éléments osseux des tambours à boules fouettantes formés de deux calottes crÂniennes humaines accolées. Les moines, vêtus d’une robe grenat, se rendent en file dans la salle de prière et s’installent, assis en tailleur devant des livres aux pages de bois. Leurs bras nus se croisent sans frisson sur leurs genoux tandis qu’un bourdon sonore semble s’élever des pierres, du vent tournant dans les anfractuosités ou les poitrines. La bouche des renonçants devient source de vie car elle laisse passer les souffles les plus étranges, dans la puissance comme dans la subtilité. Les deux émissions vocales simultanées des gens de l’Asie Centrale, Mongolie, Altaï, Touva et Tibet, appelées, ici et là, diphonie, khomei, « voix de guimbarde » ou « voix de gorge » restent le signe de la pluralité des mondes dans l’unité cosmique, perdue aujourd’hui par les civilisations de la technologie. Plus tard, le son des trompes télescopiques dungchen ébranle la montagne. « Le toit du monde » frémit car des créatures monstrueuses viendront tourmenter ou apaiser les humains. La musique organique des moines tibétains établit un indéfectible lien entre tous les éléments de l’univers. Bartabas se retrouve dans une atmosphère chamanique. Celle-ci lui est devenue presque familière. Peut-être a‑t-il appris lui aussi à communiquer avec les bêtes et les plantes ? En mai 2005, la Transylvanie et la Moldavie le tiennent en éveil. Juché sur un tabouret entre les bosquets et les charrettes du village de Cuevas, près des violonistes tsiganes qui sentent l’ail et le feu de bois, ou appuyé contre un tronc d’arbre tout près de l’embouchure des cuivres pour s’éclabousser des éclats tonitruants de la fanfare moldave Shukar de Zezé Prajini, il respire cette musique nomade qui, depuis des siècles, agglutine les courants sonores des terres de l’Asie et de l’Europe traversées par des groupes migrateurs, et qui semble le régénérer.
Une anecdote significative en Roumanie. L’encom- brante voiture où nous nous entassons cahote sur un chemin de terre. Une pouliche, attachée à un pieu par un long lien de corde, traverse la piste et, affolée, barre la route en refusant de bouger. Bartabas descend du véhicule et avançant la main, il lui sourit. La pouliche vient mettre son nez dans le cou de cet étranger qui la conduit sur le talus en face. Un langage d’impalpables signes se met en place en un instant. Il fonctionne.
Difficile de dire si Bartabas éprouve des émotions. « Une émotion et tout est dit, comme si l’émotion était une fin », s’exclame Jean Duvignaud dans LA RUSE DE VIVRE. Et il cite « le jeune Sartre dans un texte que sa notoriété ultérieure a fait oublier : l’émotion n’est pas une banale affection des sens, elle est une conduite qui anime tout l’être, prisonnier d’une situation ou de ces pièges que tend le hasard — une « conduite magique », la genèse d’une mutation créatrice de comportements divers. Un changement de soi et de l’univers, bien entendu, inefficace, comme toute magie ».
Il ressent plutôt les légères secousses d’auto- approbation lui signifiant qu’il ne s’égare pas. Où mène le chemin qu’il suit ? Il se détecte à peine dans sa vie, mais se dessine dans les spectacles qu’il crée avec les écuyers, les danseurs, les voltigeurs, les palefreniers et toute la gente au service des seigneurs-chevaux, énigmatiques créatures, points de repère dans l’errance de tous les nomades, animaux-gardiens des chamanes, témoins impassibles de l’Ur-Welt. Eux qui reposaient, voici des millions d’années, sur la plante de leurs pieds, ne touchent plus le sol que du bout de l’ongle.
Ils mutent lentement vers la légèreté du danseur, indispensable à la spiritualité de Nietzsche. Et Bartabas voudrait bien goûter à ce monde des origines où tous les chaos, toutes les béances deviendraient des jaillissements à l’existence. Comme beaucoup de ses contemporains, il en éprouve une nostalgie, car tous savent que le point de non-retour est atteint. À la manière des mystiques, il cherche la clef d’un paradis perdu. Et ce sésame, il le trouve parfois, grâce aux musiques de l’univers qui tournoient autour de lui et lui envoient des signes. Elles lui montrent les couleurs de peau et les gestes, la chaleur du ventre et l’allure des déplacements des êtres vivants, les vêtements et les parures, les nourritures et les boissons, les colères et les tendresses, les sourires et les pleurs.
Ainsi, depuis plus de quinze ans, viennent à l’existence les spectacles de CABARET ÉQUESTRE, d’OPÉRA ÉQUESTRE, de CHIMÈRE, d’ÉCLIPSE, de T’RIPTYK, de LOUNGTA et de BATTUTA. Les chevaux attendent à Aubervilliers celui qui apportera régulièrement l’inspiration corsetée par les musiques qui vont imprégner leurs oreilles pendant les mois de répétition. Peut-être guettent-ils l’intermédiaire aux mains douces qui les mènera sur la piste des songes. L’intermédiaire, le medium, celui qui incite à la méditation ou entrée dans les mondes cachés, le médecin toujours d’origine sacrée, qui restaure les esprits et Les corps. des noms que Bartabas pourrait porter au retour de ses chasses sonores !

Bartabas explore, par Le son, l’autre, celui qui se trouve près de lui ou celui qu’il va chercher loin de sa caravane. Les bruits, les musiques, les soupirs, les silences lui fournissent des informations riches. Lorsqu’elles se font langoureuses, elles soulignent la joie ou l’élan d’amour, lorsqu’elles jouent à se montrer entrafnantes, elles cultivent le doux-amer, cet étrange pavot qui trouble l’entendement.