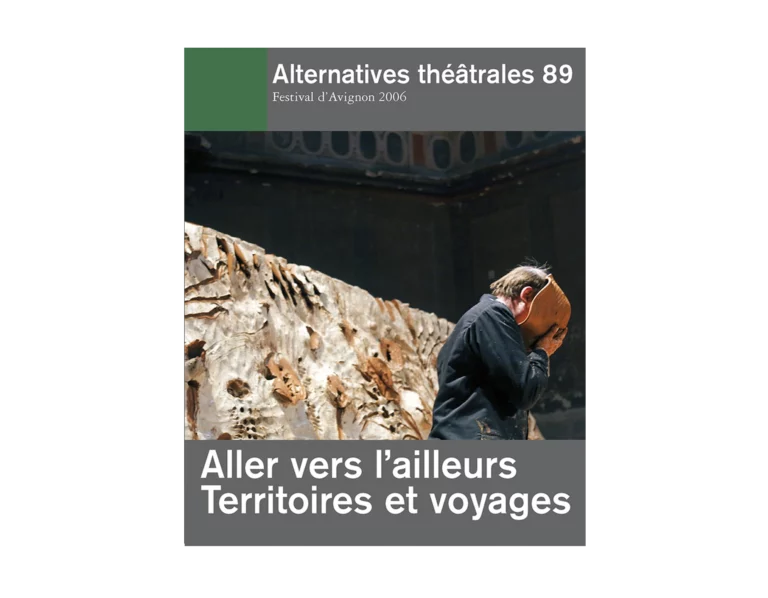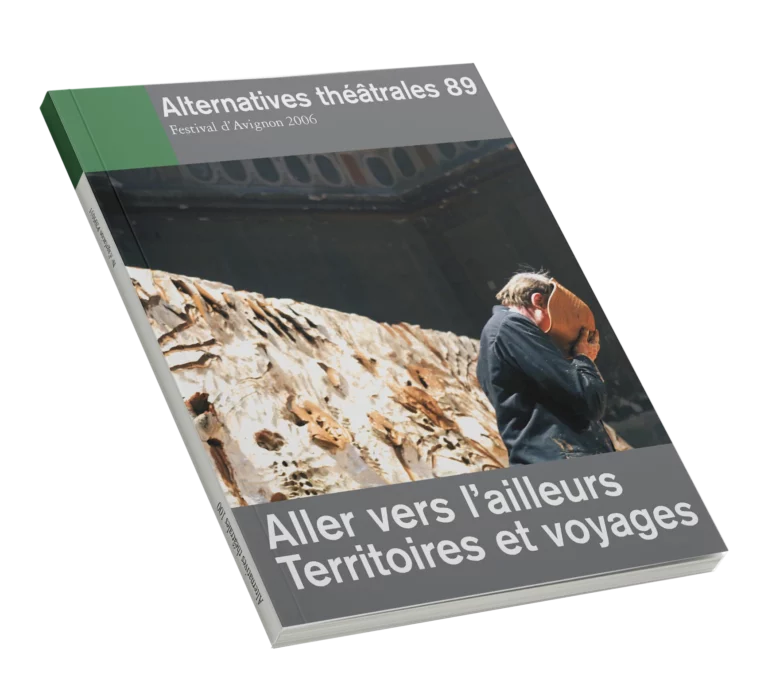Alternatives théâtrales : Ce qui frappe dans l’édition de cette année, c’est la réunion de toutes les générations du théâtre. Des gens très jeunes jusqu’à Peter Brook. Il y a tout un arc de générations et d’identités différentes.
Vincent Baudriller : Je pense qu’une des singularités du Festival d’Avignon, c’est qu’il rassemble depuis longtemps du côté des artistes comme celui du public, plusieurs générations. C’est un des rares événements culturels où l’on trouve trois générations de spectateurs dans les mêmes salles pour partager une envie de théâtre. Cela s’est peut-être accentué depuis deux ans avec un rajeunissement important du public et l’arrivée d’une nouvelle génération qui cotoie les spectateurs fidèles du festival.
Pour construire cette 60e édition nous nous sommes beaucoup interrogés avec Josef Nadj sur la question de la modernité. Comment un artiste peut trouver une écriture qui soit moderne et singulière sans forcément se couper des traditions dont il a pu hériter ? Nous avons aussi parlé de l’importance des maîtres dans l’apprentissage. Idée peut-être incarnée ici par la présence de Peter Brook ou Anatoli Vassiliev. Un des paradoxes de l’édition 2006 est d’être l’une des plus contemporaines en termes de textes qui y seront présentées dans des mises en scène qui parfois se rattachent à de grandes traditions théâtrales. Il n’y a qu’un seul texte du répertoire, peu connu, Les Barbares de Gorki que mettra en scène Eric Lacascade.
A. T. : La question d’équilibre ou de tension vient du fait qu’on a l’impression qu’il y a d’un côté les « metteurs en scène » dans le sens noble et réputé du terme et de l’autre les « écrivains du plateau ». Cette tension entre ces deux directions n’est-elle pas le photogramme du paysage théâtral européen ? Est-ce que cette édition ne retrouve pas cette dimension de la mise en scène sans renoncer aux acquis des écrivains du plateau ?
V. B. : Ce qui me gêne dans la question, c’est que nous n’avons jamais mis en opposition ces deux approches du théâtre que nous souhaitons au contraire faire dialoguer. Beaucoup d’artistes d’ailleurs peuvent se retrouver dans ces deux catégories à la fois, si catégorie il y avait. Ceux qui ont analysé le festival de l’année dernière en voulant nous faire opposer deux formes de théâtre, ont oublié notre première édition qui mettait vraiment en avant l’artiste metteur en scène à travers la présence notamment de Thomas Ostermeier, Frank Castorf ou Ludovic Lagarde… Ce théâtre était aussi présent dans l’édition 2005, en même temps qu’une présence forte d’ « écrivain du plateau » ou plutôt de « poète du théâtre » avec une vision plus globale de la création théâtrale. Ce qu’il y a de commun aux trois éditions, c’est que ce sont toujours des écritures singulières, des démarches authentiques qui se retrouvent chez les artistes que nous invitons. Le processus qui conduit à la programmation 2006 est le même que celui qui nous a fait aboutir à celles de 2004 et de 2005. A partir de discussions avec l’artiste associé, de son regard sur le théâtre, sur le monde, sur la création, nous avons dessiné un territoire artistique sur lequel je bâtis la programmation. Donc, cette notion d’équilibre n’intervient jamais lorsqu’on travaille, je parlerai plutôt d’une recherche de cohérence.
Hortense Archambault : Ainsi une idée qui nous a semblé importante, en regardant l’œuvre de Josef Nadj, est celle du besoin de la rencontre avec l’autre, l’altérité. Comment l’artiste, pour créer, intègre cette rencontre, se nourrit des différences pour trouver sa propre écriture, sa propre identité. Une chose frappante avec Josef Nadj, c’est que depuis une vingtaine d’années pour créer un spectacle, il se plonge souvent dans l’univers d’un autre artiste pour développer le sien. Ça a été celui de Borgès, Kafka, Schulz, cette année il s’agit d’Henri Michaux.
V. B. : En écho à cette démarche, nous proposons trois parcours artistiques qui témoignent d’une relation forte entre un metteur en scène et un auteur : Alain Françon avec Edward Bond, Eric Vigner avec Marguerite Duras, Marcial Di Fonzo Bo avec Copi.
A. T. : La rencontre entre artistes de genre différent se passe souvent sur les plateaux comme le montre votre affiche, signée Barceló et Nadj.
V. B. : Une partie importante du programme témoigne d’un dialogue entre différents langages artistiques. En effet ce dialogue est symbolisé par la rencontre entre Josef Nadj, metteur en scène, chorégraphe et danseur et Miquel Barceló, peintre et sculpteur. La rencontre se retrouve aussi dans la démarche de nombreux artistes qui vont se nourrir d’autres formes : Jan Lauwers, François Verret ou Christophe Huysman qui poursuit son travail entre son écriture et les arts du cirque.
Il y a aussi cette année un rapport très fort à la musique, que ce soit chez Alain Platel, Bartabas, Josef Nadj, tous les trois invitant une dizaine de musiciens sur le plateau, ou chez Anatoli Vassiliev qui développe son théâtre musical en compagnie du compositeur Vladimir Martynov. Enfin, un cycle de jazz et de musique improvisée va venir ponctuer l’ensemble du programme. Ces concerts seront souvent l’occasion d’une rencontre entre deux musiciens d’origine ou d’instrument différents, qui, grâce à la maîtrise de leur art, sont capables de dialoguer librement. Le temps d’une soirée, nous verrons ainsi Archie Shepp, jazzman américain en concert dans la cour d’honneur avec le Dresch Quartet de Budapest.
H. A. : C’est une autre question de cette édition : la maîtrise du geste dans l’art, souvent fruit d’un long travail, permet à l’artiste de créer librement et souvent d’inventer une forme. On la retrouve chez les musiciens de jazz, les danseurs, le calligraphe Nakajima, et bien sûr chez les cavaliers de Zingaro. Pour Battuta Bartabas évoque la liberté ou plutôt le danger de la liberté avec la virtuosité des cavaliers dans un spectacle au galop.
V. B. : Deux spectacles vont raconter ce moment concret de l’artiste face à son travail : le spectacle de Thierry Baë qui raconte la solitude de l’artiste, ses doutes, le vieillissement de son corps. Et le lever de soleil où Bartabas invite les spectateurs à l’aube pour regarder ce moment de travail intime et magique entre le cavalier et son cheval qu’il pratique tous les matins.
A. T. : Cette idée de la rencontre avec l’autre prend tout son sens avec Nadj, artiste lié à son territoire et en même temps très ouvert à des pratiques d’écriture étrangères. Il y a donc une relation complexe entre territoire et découverte de l’autre. L’enracinement et le besoin d’air frais, d’aller ailleurs.