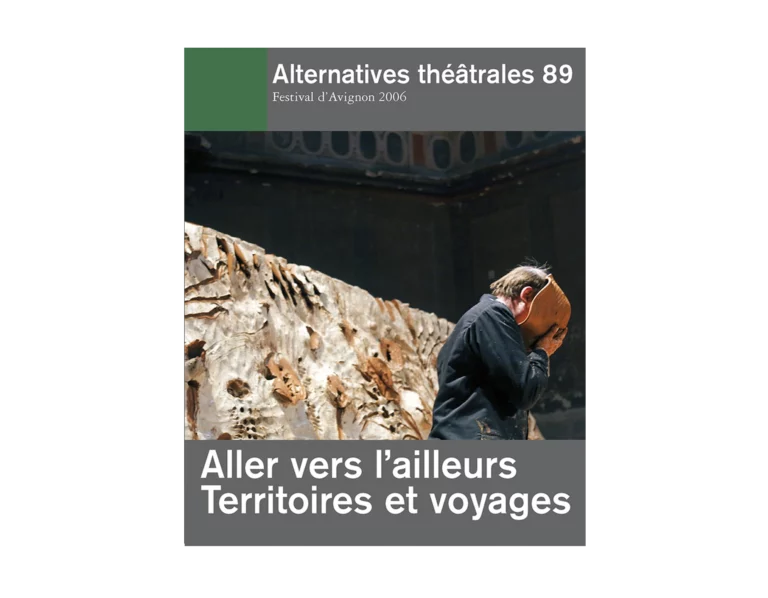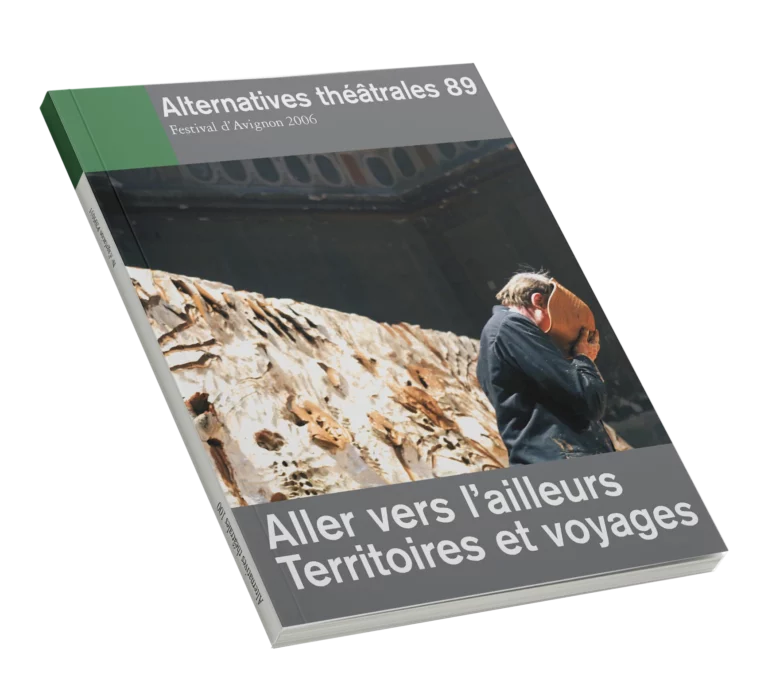BERNARD DEBROUX : Pour toi, le théâtre est intimement lié aux voyages…
Richard Demarcy : Bien sûr. C’est très vrai, vu les divers parcours qu’en tant qu’auteur-metteur en scène et responsable de Compagnie j’ai effectués. Notre démarche artistique est au fond intimement liée à cette notion, mais sans volontarisme aucun. Après coup, je m’aperçois que ce fut une véritable nécessité pour écrire, inventer scéniquement, bâtir une troupe. L’insertion dans d’autres univers fut un des moteurs.
L’écriture c’est le premier geste fondateur : sur une trentaine de pièces que j’ai écrites, une bonne moitié fut inspirée par des événements et des réalités d’autres pays, mais toujours immédiatement liés au nôtre. Ce répertoire, s’il est ouvert sur le monde, est en même temps articulé à la société dont je suis partie prenante. Certes, une pièce comme L’ÉTRANGER DANS LA MAISON, que nous avons jouée plus de deux ans, parle de la société française, mais il s’agit d’un Maghrébin dans la société française. Ou Jarry revisité en Afrique avec UBU TOUJOURS où UBU DÉCHAÎNÉ, ou plus récemment, LES MIMOSAS D’ALGÉRIE ayant trait à la guerre d’Algérie.
Si j’ai pu écrire quatre pièces sur la révolution portugaise, c’est évidemment en restant là-bas plus d’un an, à cette période, mais c’est aussi parce que je me disais en partant que sans faire un « théâtre-document » à la Peter Weiss, j’allais essayer d’écrire des pièces de fiction inspirées de l’histoire àchaud.
B. D.: N’est-ce pas difficile d’écrire sur des événements au moment même où ils se passent ?
R. D.: Ce fut difficile au départ et puis un jour le déclic apparaît, la forme est trouvée pour décoller du réel, pour être libre dans l’invention. Et ici, comme là-bas, nous avons joué toutes ces pièces en mêlant des acteurs des deux pays (avec Teresa Motta qui avait participé
à la naissance du Naïf Théâtre), passant d’un théâtre très officiel, Avignon ou le Festival d’automne, à des théâtres indépendants, ouvrant àEvora lepremier théâtre de décentralisation, juste après la révolution des Œillets… Ceci peut paraître loin mais aujourd’hui encore Les pièces font date, et celles sur la réforme agraire par exemple intéressent les Brésiliens en ce moment.
B. D.: C’est en Afrique essentiellement que tu as poursuivi ton travail.
R. D.: En effet, depuis dix ans, c’est avec le continent africain que des liens se sont tissés : six ou sept pays d’Afrique, le Cap-Vert, l’Algérie pour la saga UBU, OYÉ LUNA, les HISTOIRES DU MONDE ; et tout dernièrement, comme l’aboutissement d’une étape, VIES COURTES que nous venons de créer au Grand Parquet dans le 18e arrondissement de Paris, pièce parlant de l’Afrique urbaine aujourd’hui, de cette Afrique qui a tant partie liée avec l’Europe. Et il faut rappeler que les Afriques sont ici aussi, même si bon nombre de Français font semblant de ne pas le voir et n’ont pas encore compris que notre société est multicolore, que la composition diversifiée de notre population est sa richesse ; et que dans cette diversité, il y a la part africaine — noire — qu’il faut même affirmer comme telle pour ne plus masquer les réalités. Chers Françaises et Français, souvenez-nous — où informez-vous —: l’auteur le plus best-seller que vous chérissez tant, Alexandre Dumas, est bien noir, comme Édith Piaf est d’origine berbère, etc. Il s’agit d’extra-Européens. Et que dire de Beckett, Ionesco, etc. La France fut terre « d’accueil ». Tous les étrangers qui s’y sont installés lui ont beaucoup apporté. C’est un fait sociologique qui rend les choses bien plus positives et qui devrait permettre aux Français en quête identitaire de se mettre en accord avec leur mondialité si évidente de nos jours. Parlant de tout ceci, on peut avoir l’impression que je m’éloigne de la question, mais je crois au contraire que le théâtre plus que tout autre art est lié à la vie contradictoire des sociétés, les unes articulées aux autres. Le théâtre parle tant de l’homme dans son « intime » que dans son « être de la cité ». En ce moment, pour les acteurs noirs en France, sur les plateaux de théâtre, comme au cinéma, c’est très difficile. On a même, je pense, vraiment régressé par rapport aux années de Jean-Marie Serreau, Garran, Vitez, Chéreau. Alors que la société, elle, a beaucoup bougé dans l’autre sens. La télévision est même bien plus en avant que le théâtre. C’est une vraie question pour les gens de théâtre, pour un art qui fut si important en regard des mouvements de société.
B. D.: Qu’est-ce qu’une troupe diversifiée comme la tienne peut apporter de plus au spectateur ?
R. D.: Après l’écriture et la mise en scène, il y a cette part déterminante du théâtre qu’est la troupe, et sa composition. Il y a un très joli titre de film : LE VOYAGE DES COMÉDIENS. Comédiens et voyages, quel sujet riche et poétique. Le Naïf Théâtre fut, dès sa création il y a trente ans, composé d’artistes aux origines multiples. Aujourd’hui, ce sont cinq ou six artistes de pays d’Afrique, rencontrés pour la plupart là-bas, Portugais, Français, asiatiques. Le « voyage » est bien inhérent à ce groupe, même quand la troupe est immobile (Pessoa se définit comme un « voyageur immobile »), puisque nous sommes maintenant Compagnie associée au Grand Parquet dans le 18° où soixante-dix nationalités coexistent.
Je dirais qu’actuellement, ce sont les spectateurs qui profitent de nos voyages et des œuvres qui en résultent. L’identité plurielle et pluri-artistique de ce nouveau lieu se fit dès le départ avec notre troupe multiculturelle et notre spectacle OYÉ LUNA créé au Cap-Vert, qui tourne encore, puis viennent HISTOIRES DU MONDE et ma dernière pièce VIES COURTES.
Tout alors se conjugue et les talents multiples de ces artistes peuvent être largement mis à contribution. François Grosjean, le jeune directeur du lieu nouveau, est, quant à lui, tourné vers l’Inde et en apporte la présence.
Pour moi, la grande satisfaction après toutes ces années est de voir tous ces publics d’horizons culturels différents au rendez-vous de notre répertoire. De l’autre côté, l’étau se resserre terriblement en France sur la présence des étrangers, et nombre d’artistes d’origine étrangère sont menacés d’expulsion. Créer, c’est alors aussi résister.