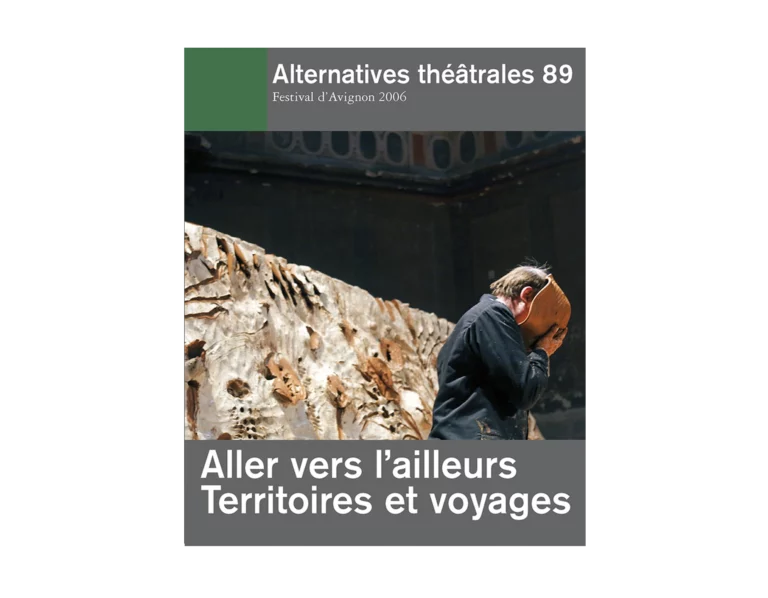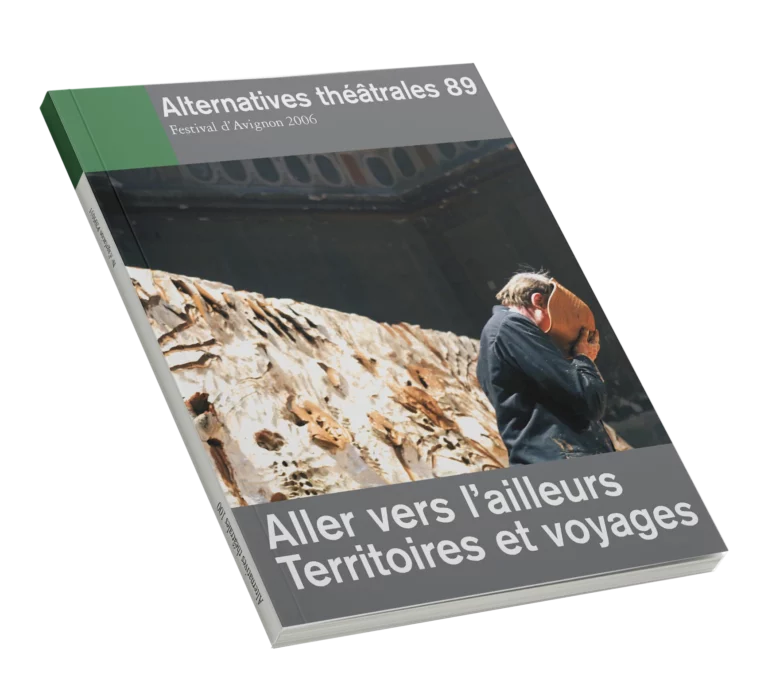De l’ailleurs le théâtre éprouva l’attrait à retardement, bien après la peinture ou la musique, mais lorsqu’il se produisit il eut le pouvoir d’une déflagration. Un nouvel horizon, imprévisible et inespéré, s’ouvrait. Nous n’allons pas refaire le cheminement de ce long processus…d’autres l’ont suivi dans les moindres détails. En particulier en Italie Nicola Savarese, en Amérique de très nombreux chercheurs, en France, moi aussi…mais, en guise de prologue, il fallait rappeler cet éblouissement premier.
Ce sont les tournées des artistes orientaux que se trouvent à l’origine de la découverte qui bouleversa tant d’hommes de théâtre de Londres, Moscou ou Paris. L’ailleurs c’est en l’Europe que l’on rencontra, mais son impact s’explique par la réponse qu’il apporta à la critique implicite exercée par des révoltés qui, enfin, trouvaient des appuis concrets, des confirmations et outils. Sada Yacco, danseuse japonaise qui présenta les premières bribes, perverties et impures, de kabuki, se trouve à l’origine de la révélation d’un langage autre.
De Craig qui l’a saluée avec enthousiasme à Meyerhold qui a avoué la fascination qu’elle exerça sur lui, la scène européenne toute entière assimila son apparition à un événement hors-pair. Plus tard, des tournées de vrai kabuki sont venues confirmer le choc premier et l’école russe ou allemande ont commenté les performances de Ichikawa Sadonji et sa troupe. Ensuite le théâtre balinais présent en 1931 à l’Exposition universelle de Paris servit à la cristallisation du discours d’Artaud sur le théâtre de même que le célèbre acteur chinois Mei Lan fang a produit en 1935, à Moscou, un choc sur des artistes aussi importants qu’Eisenstein, Brecht ou Meyerhold. Leur esthétique et leurs réflexions portent la marque de cette révélation. Elle s’est accomplie sur fond d’attente et d’insatisfaction critique. C’est pourquoi l’Orient leur a parlé…
Le théâtre oriental, dans un premier temps, est apparu comme le principal appui dans la rébellion anti-naturaliste menée par des metteurs en scène qui contestent l’assimilation du théâtre à un reflet mimétique de la vie défendue par le Théâtre Libre d’Antoine ou le Théâtre d’Art de Stanislavski et Dantchenko. Les comédiens chinois, japonais ou balinais se montrent en possession d’un langage propre, codé et élaboré pour la scène : ils représentent une alternative à la domination du naturalisme auquel, de Craig à Meyerhold, tant d’artistes tentent de s’opposer. L’Orient est un allié stratégique. Il sert dans le procès intenté à la scène occidentale.
Un constat relie ces prises de positions, il concerne les pannes de mémoire du théâtre européen qui, tous le déplorent, n’a pas su assurer une transmission correcte de ses traditions de jeu. “ Le pont ” est brisé et seules perdurent les habitudes récentes dominées par la priorité de la physionomie et “ le geste de bois ”. Un ramassis de stéréotypes étrangers aux pouvoirs plastiques et physiques du langage théâtral que l’Orient a su préserver et qu’il expose face aux metteurs en scène éblouis. Ils découvrent des “ langues ” anciennes de la scène, ici perdues et là-bas conservées. Elles répondent au déficit mnémonique propre à la scène occidentale.
L’Orient, dans ces premiers temps, captive pour toutes les ressources techniques dont ses acteurs disposent. Ils en sont les héritiers, chargés de leur transmission impeccable mais en même temps ils assurent leur exercice parfait au présent. Exercice où se confondent beauté et maîtrise des signes. Victoire de la théâtralité assumée et exposée. En effet c’est elle qui captive les metteurs en scène sous le choc de sa splendeur, mais ils savent aussi qu’elle s’appuie sur les ressources d’un langage longuement appris que seul l’entraînement prolongé permet d’acquérir. Dès lors, l’Orient se constitua en appel au corps dont l’acteur occidental était désormais voué à exploiter et cultiver les ressources. L’Orient fut d’emblée assimilé à une invitation au travail de formation technique.
L’ailleurs oriental a été, dans les premiers temps, assimilé à un territoire du théâtre en tant qu’art en possession de moyens propres ayant une mémoire et exigeant un grand effort pour se les approprier. C’est ce qui manque à la scène occidentale, constat unanime des metteurs en scène en quête de forme. A partir du modèle oriental il s’agissait d’engager le renouveau du théâtre européen. Ce fut le prologue auquel ont succédé ensuite, à partir des années 60, d’autres démarches plus ouvertes à l’au-delà de la technique, aux pensées orientales et à la vision de l’homme qu’elles comportent. C’est ce dont parle ici même Monique Borie. Aujourd’hui les contextes sont autres, les rencontres opèrent sur un mode différent, mais l’ailleurs est toujours nécessaire. Le festival d’Avignon confirme cette conviction et ses artistes invités, dans les entretiens accordés , déclinent, expliquent, avouent les motifs de cet attrait jamais assouvi. Au-delà des techniques et des pensées c’est plutôt d’une rencontre des êtres qu’il s’agit. Mais peut-on les dissocier ? Qu’apporte l’être d’ailleurs… c’est la question !