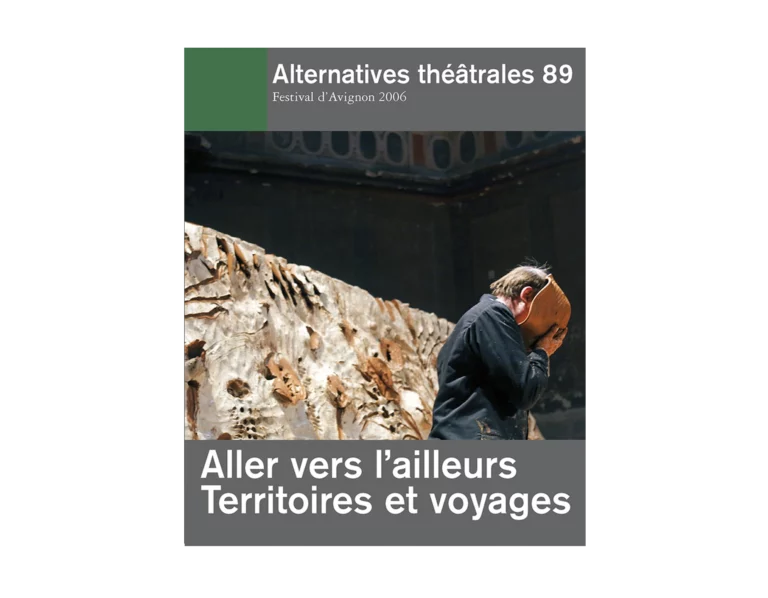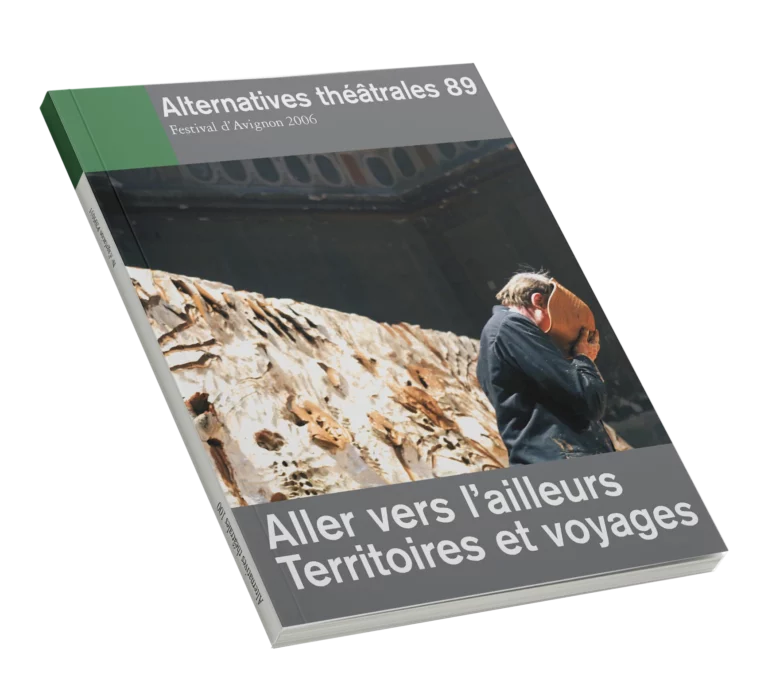Du cercle de personnages « en quête de bonheur » à l’exil de Médée, en passant par l’épopée d’Achille à l’âme éprise d’ailleurs et insatiable de Baudelaire ou de Pouchkine/Onéguine, le voyage traverse l’œuvre de Vassiliev tel un filigrane. Il ne s’agit cependant pas tant d’un thème littéraire ou de déplacements géographiques que d’une métaphore du projet théâtral lui-même. Dans les années 80, le metteur en scène russe obtient ses premiers succès à Moscou et en Europe avec Cerceau de Victor Slavkine, texte déjà manifeste de la quête utopique qu’il ne cesse de mener depuis. Son activité théâtrale perdure en effet depuis près de quarante ans sur un chemin passionné et sans cesse mouvant. « Chemin en art » dit-il sans cacher la démesure du projet et de l’ambition. La base ne reste pas moins fixe, celle du théâtre laboratoire et d’une véritable fascination de la relation entre théorie et pratique et du « théâtre total » comme tâche et idéal. Tâche du pédagogue, idéal de l’éthique rigoureuse de ses acteurs au sein du Théâtre Ecole d’art dramatique à Moscou, « mission » du metteur en scène qui tend à embrasser un pan toujours plus enfoui de la littérature, des idées, et de l’aspect syncrétique de la création. Au fil de son travail sur le jeu de l’acteur et à travers les œuvres montrées ou non au public, Vassiliev garde intact son rêve de voir surgir ne serait-ce qu’une heure ou un instant l’illusion « vraie » d’un autre possible.
Stéphanie Lupo : A Avignon vous montrez Le 23eme chant de l’Iliade d’Homère et Mozart et Salieri d’après Pouchkine. Pourquoi choisir des textes non dramatiques ?
Anatoli Vassiliev : Que je ne montre pas des textes dramatiques, c’est un fait réel et récemment je me suis posé la question de combien ma carrière en comptait. Bien sûr il y a longtemps j’ai travaillé sur Pirandello mais déjà je coupais des morceaux. Et même avant avec Cerceau, le texte était inventé collectivement pendant les répétitions avec l’auteur, et c’est devenu un texte tout à fait différent. Pour Tchekhov par exemple je n’ai jamais monté un texte complet, j’ai monté une œuvre qui s’appelait La Mouette IVe acte. Et de même pour Amphitryon. Bien sûr à la Comédie française j’ai monté le texte entier, mais en Russie le spectacle s’intitulait Huit dialogues tirés d’Amphitryon. J’ai aussi monté beaucoup de romans mais ça ne signifie pas que je fais des adaptations, jamais. Pour le roman de Dostoïevski Le songe de l’oncle, j’ai sélectionné quelques chapitres et je les ai utilisés sans rien changer ni réécrire, sans rien non plus découper dans le morceau choisi. Bien sûr ce serait possible de mettre en scène le texte entier mais ça ne m’intéresse pas. Qu’est-ce que je monte ? Je me suis posé moi-même la question.
S. L. : Les deux spectacles présentent une composition complexe mêlant texte littéraire, interludes musicaux, chant et parties chorégraphiées. Peut-on dire que le choix des textes est lié au thème qui vous est cher de la polyphonie ?
Anatoli Vassiliev : C’est probablement sur ce terrain que se trouvent les racines. Pour Mozart et Salieri par exemple, on peut dire que c’est un texte dramatique, une tragédie, mais j’y ai inclus un requiem et aussi quatre poèmes de jeunesse de Pouchkine. J’appelle la scène centrale où Mozart boit le poison et où sont inclus des poèmes de jeunesse, l’atelier d’artiste. Le théâtre polyphonique, ou « synthétique » pour nous les Russes, c’est une vraie question. Je pense que les fondements on peut les trouver dans ceci : je maîtrise les structures dramatiques mais mon intérêt concerne des formes qui n’appartiennent pas aux drames. Ce que je souhaite c’est transmettre des structures dramatiques à ces autres textes. Transformer le monde de textes non dramatiques en drame. Mais surtout, la nature comme telle est polyphonique. Le monde et notre nature à nous êtres humains sont fondés sur une loi universelle et c’est à travers la polyphonie que cette loi se révèle. C’est en suivant cette voie que je suis arrivé au théâtre du mystère.
S. L. : Prendre d’autres textes comme une autre matière, n’est-ce pas aussi une manière d’ aborder le thème du potentiel utopique du théâtre ?
Anatoli Vassiliev : Je ne sais dire s’il s’agit ou non de théâtre. Ce qui est sûr c’est que je me suis toujours intéressé à des mondes qui peuvent faire l’épreuve du monde dramatique. Avec la métaphysique, avec l’homme, avec son âme, avec la conscience. Par exemple on a répété Eugène Onéguine de Pouchkine. C’est un roman, et le défi le plus grand a été de créer une œuvre dramatique qui du point de vue de la structure serait identique au roman. Depuis Cerceau déjà, je m’intéresse aux structures du roman. J’ai écrit un texte à ce sujet. Parce que dans le drame les espaces sont fermés. Et j’ai commencé à m’intéresser aux espaces ouverts, puis aux instruments qui permettent de trouver une expérience adéquate pour les traverser. Et même quand j’ai pris des textes à espaces plutôt fermés comme pour Mozart et Salieri j’ai cherché à les ouvrir. Prendre le monde fermé du drame et essayer de l’ouvrir, prendre le monde ouvert du roman et trouver le moyen de le fermer comme dans le drame, on peut dire que c’est un chemin.
S. L. : Celui de confondre ces deux mondes ?
Anatoli Vassiliev : Oui, bien sûr.
S. L. : Depuis vos premières mises en scène la musique et le chant jouent un rôle très important. En 1996 vous avez même présenté à Avignon Les lamentations de Jérémie d’après un oratorio du compositeur russe Vladimir Martynov. Cette collaboration continue aujourd’hui et le chœur semble avoir pris une part prépondérante dans vos spectacles. Comment s’est développé cet aspect de la pratique ?
Anatoli Vassiliev : En général je ne pense pas que je sois un homme d’un thème. Par exemple l’énoncé narratif, raconter des histoires, ne m’intéresse pas. Très rapidement j’ai été capable de faire ce travail et j’en ai perdu l’intérêt. Je suis plutôt un homme d’un drame comme tel, ou d’art comme tel. Je suis fasciné par les idées de la création, par la pratique comme théorie et par la théorie comme pratique. Je suis fasciné par la pratique pour un thème, ou au contraire à l’idée qu’un thème soit utilisé pour la pratique. Il y a longtemps que je m’intéresse plutôt à des thèmes métaphysiques. Cela signifie que chaque nouvelle expérience doit être liée avec un des aspects de la théorie du théâtre. Chaque nouveau spectacle, on le fait pour le théâtre comme tel et c’est de cette façon que naissent des œuvres nouvelles. Par exemple en ce qui concerne l’action. J’ai commencé par travailler sur l’action psychique puis j’ai considéré que c’était achevé. Alors je me suis penché sur l’action comme jeu. J’ai maîtrisé ça, et je me suis orienté vers l’action dans la parole, l’action dans la parole parlée puis chantée. De nouveau j’ai fait encore un pas et je me suis tourné vers l’action physique. Puis si on prend quelque chose qu’on appelle l’action psychique, il y a des choses qu’on peut transmettre à travers le psychisme et pas à travers la parole, de même il y a des choses que l’on peut transmettre à travers le chant. Et voilà la polyphonie, tous ces intérêts se combinent dans une seule œuvre. Et encore une fois la notion de chemin, un pas en avant et encore un autre.
S. L. : Une collaboration similaire semble avoir été entreprise avec des chorégraphes. A Moscou, vous avez montré récemment un spectacle en deux parties à partir du Dom Juan ou le convive de pierre de Pouchkine. La deuxième partie intitulée « Dom Juan ou le voyage aux enfers » est très proche du ballet ? Comment avez-vous travaillé ?
Anatoli Vassiliev : Expliquer le travail avec les danseurs, c’est assez compliqué. Il y a un chorégraphe, quelqu’un qui a dirigé ce travail. Les premières idées pratiques datent de l’année 1996. Je pensais qu’il était possible de créer une œuvre où l’on trouverait un équilibre entre l’action dans la parole et l’action chantée. La deuxième idée c’était de combiner l’action dans le chant et l’action comme action physique. Le thème a été suggéré, celui des Caprices de Goya. On a évoqué une manière de traiter ce thème, puis les danseurs ont commencé à travailler avec le chorégraphe. On a essayé de déterminer les idées fondamentales de toute cette œuvre, on a accumulé beaucoup de morceaux de travaux différents jusqu’à ce qu’on essaie de combiner tous ces travaux ensemble en utilisant la même loi théorique ou le même style, dans un seul énoncé. Dans tout ça se trouve le même intérêt envers ce qu’on peut appeler la vie capable de coordonner le chant et l’action physique. Le thème de l’enfer par contre, il n’arrive pas avant l’idée théorique, c’est bien après.
S. L. : Est-ce le même processus concernant la pratique des Arts martiaux ? Ils sont très présents dans l’Iliade. Il ne s’agit par ailleurs pas là d’un simple effet de mise en scène, mais d’un training quotidien que suivent les acteurs de votre théâtre.
Anatoli Vassiliev : Oui. Cela concerne l’action physique, l’énergie, l’action rituelle aussi que j’ai essayée d’aborder il y a longtemps. De tout ce chemin, une forme émerge : ça devient l’Iliade.
S. L. : Cette année les Français ont pu voir deux mises en scène tirées de l’œuvre de Pouchkine. Ces deux spectacles sont issus d’un travail de laboratoire commencé il y a déjà plusieurs années. Pouchkine semble tenir une place particulière dans votre répertoire.
Anatoli Vassiliev : J’ai commencé à travailler sur Pouchkine en 1992. Les idées sont très simples. Il me semblait que je pouvais monter un drame occidental. Les racines elles, sont très profondes. Au début des années 80, j’ai commencé à répéter le Roi Lear, et simultanément Lioubimov m’a demandé de travailler sur Boris Goudounov de Pouchkine, il était en Europe et moi j’étais à la Taganka. Ce fut la première expérience sérieuse sur Pouchkine. Déjà j’ai compris qu’il me manquait la méthode juste pour travailler sur ce texte. Puis j’ai travaillé sur Platon, et au début des années 90 j’ai repris le travail sur Pouchkine. D’abord il m’a fallu élaborer la méthode des structures ludiques, puis travailler sur l’action dans la parole et seulement après utiliser cette méthode sur les poèmes de Pouchkine. J’ai beaucoup d’ambition. Je voulais trouver une méthode qu’on pourrait utiliser pour monter le texte russe sur le plateau. Parce que pour Tchekhov par exemple, il y a une expérience scénique qui existe, mais il y a d’autres textes qui restent seulement comme littérature, ceux de Pouchkine, de Gogol, de Dostoïevski. Ils n’ont aucune version scénique adéquate, parce que la plupart du temps on les approche dans la technique du drame psychologique et c’est impossible.
Mais après tout, ce travail est surtout lié à ma vie. En 1975, je répétais une pièce sur Pouchkine au Théâtre d’Art de Moscou. Oleg Efremov m’avait proposé ce projet, et lui-même jouait le rôle de Pouchkine. Si on remonte encore, en 1961 déjà à l’université je jouais dans une pièce consacrée à la vie de Pouchkine et ce fut une expérience vraiment sérieuse. Et avant encore, lorsque j’étais enfant et que j’ai commencé à écrire de la musique je le faisais sur les poèmes de Pouchkine. Vraiment il y a ce fil qui me lie à Pouchkine, et cet intérêt perdure depuis maintenant près de 45 ans.